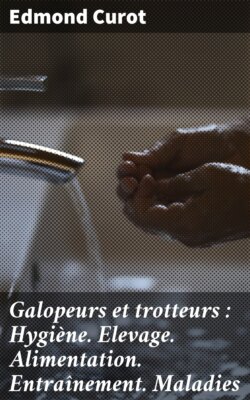Читать книгу Galopeurs et trotteurs : Hygiène. Elevage. Alimentation. Entraînement. Maladies - Edmond Curot - Страница 41
SOINS IMMÉDIATS AUX NOUVEAU-NÉS
ОглавлениеLIBÉRATION DES ENVELOPPES FŒTALES. — LIGATURE, SECTION ET DÉSINFECTION DU CORDON OMBILICAL. — ROLE PRÉVENTIF DE L’ANTISEPSIE OMBILICALE DANS LA MORTINATALITÉ. — MORT APPARENTE DU NOUVEAU-NÉ.
Les soins immédiats au nouveau-né, dont quelques-uns tiennent sous leur dépendance son existence, comprennent les interventions hygiéniques suivantes:
1° Libération du nouveau-né de ses enveloppes;
2° Section et ligature du cordon ombilical;
3° Désinfection du cordon et de la région ombilicale;
4° Etablissement de la respiration; soins spéciaux dans le cas de mort apparente;
5° Recherche des anomalies congénitales;
6° Soins particuliers au nouveau-né dans les parts dystociques.
Libération du nouveau-né. — La membrane de l’amnios, tout en étant assez fragile, résiste cependant un peu plus que celle de l’allantoïde; elle peut même ne pas se rupturer et être expulsée intacte avec le fœtus.
La première indication à remplir en ce cas, c’est évidemment de briser la prison, dans laquelle le nouveau-né périrait bientôt étouffé sans cette précaution. Du moment que ses rapports avec la mère sont rompus, il faut, en effet, qu’il puisse respirer, qu’il trouve dans l’air extérieur le principe vivifiant emprunté auparavant au sang maternel.
Rupture du cordon ombilical. — Chez les juments qui accouchent debout, le cordon se rompt au moment où le fœtus tombe à terre. Pour celles qui mettent bas couchées, c’est au moment où elles se lèvent que s’effectue cette rupture. Parfois, cependant, le cordon offre assez de ténacité et d’élasticité pour résister à ces secousses, et, dans ce cas, il n’est pas rare que ce soient les adhérences du placenta qui se détachent et que le délivre reste adhérent au nouveau-né.
Souvent alors, poussée par un instinct remarquable, la mère, en léchant son petit, coupe elle-même avec ses dents le cordon ombilical. Qu’il se rompe spontanément ou qu’il soit coupé par la mère, la séparation s’effectue toujours à quatre ou six centimètres.
Hémorragie ombilicale. — Le résultat immédiat de la rupture du cordon est la thrombose des vaisseaux ombilicaux et l’obstruction de l’ouraque. Les deux artères ombilicales ne donnent qu’exceptionnellement lieu à des hémorragies assez graves; il convient donc, dans ces cas, particuliers, de faire une ligature solide assez éloignée de l’extrémité pour qu’il soit possible, en cas de nouvelle hémorragie, d’en appliquer une autre.
Technique opératoire de la ligature et de la désinfection du cordon. — Aussitôt le nouveau-né séché par la mère, on fera à trois centimètres environ de l’anneau ombilical une ligature du cordon avec un fil préalablement bouilli; la partie du cordon située au delà de la ligature sera sectionnée; le moignon restant, soigneusement lavé à l’eau bouillie ou avec de l’eau boriquée, et enveloppé ensuite avec une plaquette de coton iodoformé — sera maintenu en place à l’aide d’une petite sangle abdominale.
Le cordon se desséchera un peu moins vite qu’à l’air libre, mais sera à l’abri de toute infection. Ce procédé très simple, préconisé par MOUSSU, permet d’élever les nouveau-nés même en milieu contaminé.
Le pansement ombilical à demeure exerce un double effet préventif: 1° en empêchant l’infection directe du cordon pendant les deux ou trois premiers jours qui suivent la naissance; 2° en rendant impossible l’infection se produisant du huitième au dixième jour, lors de sa chute à la faveur de la plaie ombilicale.
Se conformer à la technique suivante pour pratiquer la désinfection du cordon ombilical:
a) Faire la ligature avec un fil stérile, préalablement bouilli;
b) Laver le moignon et la région ombilicale au sublimé alcoolique (2 ‰);
c) Tamponner l’extrémité du cordon avec la teinture d’iode;
d) Appliquer un pansement abdominal à demeure ou utiliser le collodion, le goudron.
Chez les jeunes mâles, où le pansement ventral à demeure peut être souillé par l’urine, on remplace la sangle abdominale par un badigeonnage de teinture d’iode suivi de l’application d’un mélange de poudre de charbon et d’alun calciné.
Mécanisme physiologique de la chute du cordon. — La portion extrafœtale du cordon qui reste appendue à l’ombilic se dessèche, se rétracte; le tout subit une espèce de nécrose, se délimite comme une escarre sèche et s’élimine en huit à dix jours, laissant à la place l’ombilic qui doit être à demi cicatrisé quand le cordon est tombé.
Si toutes les modifications indiquées se passent normalement, la cicatrisation de l’ombilic se fait régulièrement. Mais malheureusement, l’élimination du cordon ne se fait pas toujours aussi simplement et il y a lieu, pendant les huit premiers jours qui suivent la naissance, de surveiller attentivement la région ombilicale.
Certaines juments en léchant le nombril font saigner et entretiennent. la plaie ombilicale qui, souillée par les fumiers, le purin, se met à suppurer, et dès lors, l’infection étant réalisée, peuvent subvenir des accidents divers: phlébite ombilicale, septicémie, etc., qui constituent la dominante de la mortinatalité.
Enlèvement de l’enduit sébacé. — La première condition à remplir est d’enlever l’enduit sébacé ou caséeux, qui recouvre le corps du nouveau-né, de le sécher et de le réchauffer. Il suffit d’approcher le jeune sujet de sa mère, afin qu’elle puisse, poussée par l’instinct maternel, le sécher en le léchant tout à son aise.
Il est rare que la jument n’effectue pas d’elle-même cet acte; cependant il y a quelques exceptions, principalement chez les primipares, surtout quand elles ont beaucoup souffert pendant la mise bas. Il est bon alors de vaincre leur indifférence en répandant sur le nouveau-né un corps pulvérulent et sapide, comme du son, et surtout du sel marin. C’est même une précaution bonne à prendre dans tous les cas.
Que si la mère, malgré cela, se refusait à lécher son petit, il faudrait y suppléer et le sécher promptement, en frictionnant doucement toute la surface de son corps à l’aide d’une éponge, puis avec un tissu de laine, et, après ce léger massage, on le couvrira et on le laissera seul avec sa mère.
Il est en effet des primipares que la présence de l’homme inquiète, et qui se montrent indifférentes à leur nourrisson tant qu’elles voient quelqu’un autour d’elles. Laissées à elles-mêmes, elles s’en approchent, le flairent, se familiarisent avec lui, l’appellent d’une voix caressante, et bientôt le prennent en affection et deviennent d’excellentes mères; tandis que si on les tourmente, elles le prennent en aversion, s’écartent de lui, le frappent même et le laissent périr.
Lorsqu’une demi-heure après le part on revient faire boire la mère, on trouve généralement le poulain debout cherchant la mamelle, et déjà occupé à téter.
Mort apparente du nouveau-né. — Au moment de la naissance, il est des nouveau-nés qui sont souffrants, ou même ne font aucun mouvement ne respirent pas et paraissent morts. Avant de les sacrifier, il faut par l’auscultation s’assurer si le cœur bat encore, car tant qu’il fonctionne, il n’est pas impossible de les rappeler à la vie. Mais il faut se hâter, car si l’état prolonge, si la respiration ne s’établit pas promptement, c’est la mort fatale.
La première indication à remplir consiste donc à provoquer la respiration; c’est surtout par des réflexes cutanés qu’on doit chercher à établir les contractions des muscles des parois thoraciques. L’un des meilleurs moyens consiste à tremper dans l’eau fraîche, même un peu froide, un linge avec lequel on flagellera le nouveau-né, sur différentes régions du corps, mais surtout sur la face et sur la poitrine. Des frictions un peu rudes avec une brosse ou un chiffon de laine peuvent avoir aussi de bons effets. Enfin, on pourra chercher à provoquer l’éternuement en titillant la pituitaire avec les barbes d’une plume, ou en insufflant dans les naseaux une fumée irritante, de la fumée de tabac par exemple, ou encore en faisant des aspersions de vinaigre dans les narines.
Lorsque ces moyens paraissent devoir rester insuffisants, il faut recourir à la pratique de la respiration artificielle. La traction rythmée de la langue consiste, en écartant les mâchoires, à attirer fortement cet organe au dehors et à lui faire exécuter des mouvements énergiques d’avant en arrière.
L’effet et l’importance de cette manœuvre résident principalement dans l’action puissante que l’excitation et surtout la traction de la base de la langue exercent sur le réflexe respiratoire. Cette traction doit d’ailleurs être réalisée d’une façon rythmique correspondant au rythme de la fonction qu’il s’agit de rétablir.
Pratique de la respiration artificielle. — La technique opératoire est des plus simples: la langue est saisie avec la main et attirée fortement au dehors et en avant (il ne faut pas craindre de la saisir avec force et de tirer hardiment sur elle). Immédiatement un hoquet énergique se manifeste, et après une courte série de tractions, les hoquets deviennent de plus en plus bruyants, puis la respiration s’établit, d’abord précipitée, et bientôt régulière. Pour la production des premiers réflexes, il faut manœuvrer énergiquement, pour les suivants, une faible pression des doigts sur la partie libre de la langue ou même le simple contact de la main détermine une réaction brusque et violente.
Si ces soins paraissent avoir quelque succès, on les continue jusqu’à ce que la respiration soit bien établie et s’exécute selon un rythme régulier et non par secousses convulsives.
Dans le cas contraire, on les continuera jusqu’à ce que l’arrêt définitif des contractions cardiaques démontre que le nouveau-né est un cadavre.
Si la respiration artificielle est inefficace, c’est que les éléments anatomiques étaient morts depuis longtemps ou qu’il existe une malformation des organes essentiels à l’existence.
De toutes les prescriptions concernant le nouveau-né, indiquées dans le cours de ce chapitre, la plus importante est celle relative à l’hygiène de la région ombilicale (section, ligature et désinfection du cordon).
Nous ne saurions trop recommander aux éleveurs de pratiquer d’une façon systématique la désinfection du cordon en se conformant strictement à la technique indiquée.
Si elle est faite d’une façon incomplète, — et le cas est malheureusement fréquent dans la pratique, — si une faute lourde a été commise dans l’asepsie ou l’antisepsie, les effets préventifs seront douteux ou nuls; effectuée d’une façon méthodique, elle jouera un rôle préventif dans les affections (phlébite ombilicale, septicémie, polyarthrite des nouveau-nés, etc.), qui constituent la dominante de la mortalité.
Tenant compte du prix élevé des dernières ventes de yearlings à Deauville (moyenne supérieure à 40.000 francs), il serait puéril d’insister plus longuement sur l’importance des pertes dues à la mortinatalité et sur le rôle primordial dévolu à la prophylaxie des affections septicémiques des nouveau-nés.