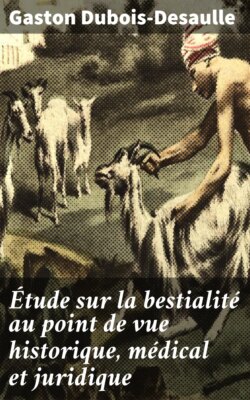Читать книгу Étude sur la bestialité au point de vue historique, médical et juridique - Gaston Dubois-Desaulle - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPROCÈS DE DIDIER LANGARAT
Table des matières
— 1604 —
La grosse Fanchon, servante du sieur de Sirvancourt, passait, le mercredi 14 octobre 1604, dans la rue Basfroi, par derrière l’église de Joinville pour quérir ses provisions, lorsqu’elle s’arrêta, coite: dans un renfoncement des contreforts, se passait une scène bien singulière et qui intéressa fortement la curieuse. Un homme, qui paraissait monter un cheval, se livrait à des mouvements désordonnés qui parurent bizarres à la curieuse servante.
Après avoir regardé le mieux qu’elle pouvait, la Fanchon crut comprendre et, se retirant doucement, s’en fut appeler des témoins pour leur faire voir ce spectacle extraordinaire.
André Dupont, maître apothicaire, Pierre Thourg, compagnon maréchal, Bastien Languedoc, garçon tanneur, Alexandre Dumontel, serrurier, furent vite ramassés par la commère. Ils s’avancèrent prudemment, en longeant les murs de l’église, et purent constater que l’homme était «accouplé et en copulation charnelle et détestable avec une jument».
L’homme les entendit, se dégagea et voulut s’enfuir, mais les voisins le rejoignirent et voulurent s’emparer de lui; la lutte fut vive; le tanneur Languedoc reçut dans la jambe un coup de pied lui enlevant «la chair vive jusqu’à l’os», mais force resta aux défenseurs de la morale, le bestial fut capturé, ligotté et remis entre les mains de la maréchaussée, représentée par Charles Nozelay, exempt, Thibaud Legendre, François Frappin, Gautier Lesueur et Jean Trompette, archers de la brigade de Joinville, qui conduisirent leur prisonnier devant Jules-Henry d’Armause, écuyer, sieur de la Berthe-Hironger et bailly de Joinville. Interrogé sur-le-champ, il dit se nommer Didier Langarat, être âgé de 37 ans, natif de Sancerre, dans le diocèse de Bourges, être arrivé à Joinville depuis six semaines seulement, où il exerçait la profession de garçon cordonnier chez Etienne Taillard.
Quant à l’accusation qui pesait sur lui, Tangarat la dénia complètement, assurant que «s’estant mis pour lâcher de l’eau auprès de la cavalle, plusieurs bourgeois étaient accourus et l’avaient accusé de ce à quoi il n’avait jamais pensé ».
Le bailly n’usa pas de la question pour obtenir l’aveu «du crime», les témoignages lui suffirent pour rendre sa sentence, et le vendredi 16 octobre 1604, Didier Langarat était condamné à être pendu et étranglé à une potence dressée à cet effet dans la grand’place de Joinville, son corps brûlé avec celui de la jument, préalablement étranglée, les cendres jetées au vent, ses biens confisqués, dix livres d’amende envers le Roi, soixante-dix livres de dommages et intérêts à Nicolas Rousseau, vigneron, auquel appartenait la cavale; cette somme était le prix de la bête exécutée.
Le Parlement de Paris rejetant l’appel, par son arrêt du 27 octobre 1604, ajouta que Langarat serait «conduit la corde au col et tenant au poing une torche de cire jaune du poids de deux livres, devant l’église principale de Joinville», et là ferait amende honorable, déclarant que «méchamment, il avait souillé et pollué les murs de la dite église».