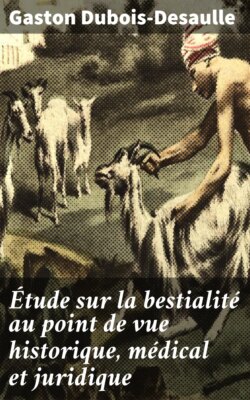Читать книгу Étude sur la bestialité au point de vue historique, médical et juridique - Gaston Dubois-Desaulle - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPROCÈS DE JEAN SARDON
Table des matières
— 1608 —
Par un beau dimanche de mai 1608, les cloches de l’église de Château-Regnault appelaient à la messe les retardataires. Quelques villageoises avec leurs enfants étaient accourues précipitamment et sans examiner les alentours de l’église y étaient entrées, se plaçant dans les bas-côtés, près de la chaire..
La place de l’église était vide, autour régnait un grand silence, des maisons voisines ne sortait aucun bruit, tous les habitants étaient à l’église et dans toutes les demeures était observé le repos dominical.
Catherine Rouget accourait précipitamment; elle se savait en retard et soucieuse de ne pas manquer le service divin elle ne prenait pas garde aux rayons brûlants du soleil qui chauffait la place de l’église. Passant derrière l’abside elle jeta autour d’elle un regard inquiet, il lui semblait entendre des soupirs, lorsque ses yeux furent frappés par un spectacle si épouvantable qu’elle se sauva en poussant des cris perçants. Dans sa fuite éperdue, elle rencontra une de ses voisines, Gillette Harang, qui l’arrêta et, s’inquiétant de la voir si émue, la questionna pour connaître la cause d’un tel émoi, ne voyant autour d’elles aucun danger qui le légitimât et connaissant Catherine Rouget pour une femme posée et calme. Catherine ne sachant comment s’y prendre pour satisfaire la curiosité de Gillette, le sujet lui paraissant difficile à aborder, revint sur ses pas accompagnée de la curieuse. Elles traversèrent la place de l’église et virent un homme «vêtu de toile à carreaux gris et blancs avec un bonnet de laine rouge» accouplé et en copulation charnelle avec une vache blanche et rousse «qui d’un air placide supportait les assauts furieux du quidam».
Les deux commères indignées ne ménagèrent pas les injures et les imprécations, sans se soucier d’être entendues par les fidèles qui étaient dans l’église; elles ne trouvaient pas d’expressions assez fortes pour exprimer leur colère. Leurs exclamations furent entendues de Rolland Lenain, vigneron, qui venait chercher sa vieille mère à la fin de la messe; derrière lui accoururent Marc-Antoine Haugard, Jean-Baptiste-Michel-Ange Boileau compagnon serrurier, Augustin Brouillard, l’épicier le mieux achalandé du pays et chandelier attitré de l’église, Marguerite Plumet, veuve de Pierre Moron, qui troublés dans leurs prières par le bruit fait derrière l’abside sortirent précipitamment de l’église croyant qu’un incendie dévorait leurs demeures ou que la mort avait frappé inopinément un des habitants.
A eux se joignit Georges Thomassin taillandier, qui se disposait à entrer dans l’église; tous s’approchèrent du groupe singulier formé par le quidam, sa vache, Catherine Roget et Gillette Harang.
Tous pressaient les deux femmes de questions: que faisait là cette vache? pourquoi insultaient-elles si grossièrement le jeune gars qui à la hâte rajustait ses vêtements? Sans ménager la pudeur des assistants, elles racontèrent ce qu’elles avaient vu; toutes les commères qui avaient été effrayées du tapage en ignorant la cause ne lui épargnèrent ni les lazzis ni les malédictions, les hommes se gaussèrent de lui. On le tournait en dérision, chacun venait avec un mot de mépris ou un quolibet insulter à son abominable passion.
Enfin le taillandier Thomassin, qui jouissait d’une certaine autorité dans le pays à cause de son âge et de sa position solidement établie, déclara que, soucieux de la sanction pénale, «il fallait aller chercher la justice pour châtier un crime aussi énorme».
Quelques-uns se détachèrent du groupe au milieu duquel étaient enfermés les deux coupables, l’homme et la paisible vache, et allèrent quérir la maréchaussée. Le chef de la brigade Simon du Barteau fut mis au courant des faits, il résolut d’aller arrêter le coupable et donna aussitôt l’ordre de l’accompagner à quelques-uns de ses cavaliers: Mathieu Brisebarre, Jean-Joseph-Simon Béthany, Grégoire Lefort et Hugues-François Labbé.
L’affaire fut vite connue de tout le village, les uns gouaillaient, les autres s’indignaient; les femmes étaient les plus acharnées après le misérable, chacun cherchait s’il n’avait pas eu à se plaindre de lui, car un homme capable d’aimer une vache était capable de tout. Les dévots n’avaient pour lui nulle pitié. Un acte déjà si odieux le devenait plus encore d’avoir été commis un dimanche, à l’heure de la sainte messe, près d’une église. Par cette abominable action il avait troublé les prières des fidèles, empêché des femmes d’assister à la sainte messe, scandalisé tout un village.
Cet homme, disaient-ils, avait gravement offensé Dieu et son prochain et méritait la mort qui l’attendait.
Aussi lorsque le 1er juin le coupable comparut devant le bailly de Château-Regnault, le sieur Ambroise d’Outremer, personne dans le village n’éprouvait pour lui aucune pitié, c’était un criminel dont devaient rougir tous ses parents et ses amis.
Devant son juge l’accusé déclara se nommer Jean Sardon, être âgé de vingt-sept ans, né le 6 janvier 1579 à Pont de la Rivière d’Angers.
Il ne pouvait nier, ayant été pris en flagrant délit. Il crut que son repentir lui concilierait les bonnes grâces du bailly; se jetant à ses genoux, il confessa son crime, promit de se corriger et affirma que c’était la première fois qu’il le commettait et sans cacher le profond chagrin qu’il éprouvait de se voir par sa faute traîné en justice «il demanda pardon à Dieu, au roi, à nous et à la justice», dit le procès-verbal du bailli qui ajoute:
«A quoi nous avons répondu que cette grâce ne dépendait pas de nous, tout ce que nous pouvions faire en sa faveur était de le juger suivant l’ordonnance et ensuite de le renvoyer au Parlement de Paris qui ferait ce qu’il jugerait à propos et auprès desquels juges il devait solliciter sa grâce. Après quoi Jean Sardon s’étant mis à pleurer, nous lui avons dit qu’il devait commencer par demander pardon à Dieu qu’il avait horriblement offensé et qui était cependant celui auprès de qui il obtiendrait plutôt sa grâce, s’il avait un sincère repentir ».
Lors de la confrontation qui eut lieu le samedi 6 juin, Sardon se mit encore à genoux et réitéra sa supplication, mais le magistrat lui répondit qu’il ne pouvait se dispenser «d’appliquer les lois qui seules le condamnaient».
Il importe de souligner cette réponse d’un magistrat du XVIe siècle. Elle montre que la notion de la loi a des racines beaucoup plus profondes qu’on ne se l’imagine ordinairement et que bien avant la Révolution française les hommes obéissaient à l’expression d’une volonté collective, représentée à cette époque par l’Ordonnance et maintenant par le Code. L’expression volonté collective n’est pas un lapsus calami. On remarque en effet que le bailli ne parle que du recours au Parlement ; pour lui, le Roi n’existe pas juridiquement, le Prince est une puissance politique, mais la puissance judiciaire est, dans l’esprit de ce magistrat subalterne, tout entière dans la Cour du Parlement; de même actuellement si un prévenu demandait à un Président de tribunal correctionnel d’échapper à la peine impliquée par le délit, le juge lui répondrait: Je ne peux que vous appliquer la loi avec toutes les restrictions qu’elle permet. Demandez aux juridictions supérieures l’appel de mon jugement ou sa cassation.
A cette époque, l’ordonnance n’admettait pas de circonstances atténuantes pour le crime de bestialité. Ambroise d’Outremer rendit sa sentence le lundi 15 juin 1606; elle condamnait Sardon à l’amende honorable devant l’église avec une torche du poids de deux livres dans la main, puis à être brûlé vif avec la vache préalablement étranglée; ses cendres jetées au vent, ses biens confisqués au profit de qui il appartiendra.
Le Parlement de Paris, par son arrêt du 6 juillet 1606, confirma la sentence en ajoutant toutefois que Sardon serait conduit à l’amende honorable dans un tombereau et étranglé avant d’être brûlé.