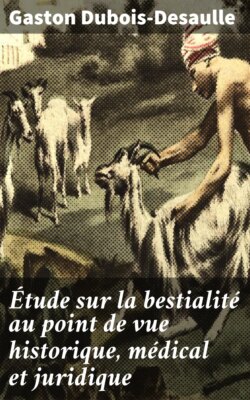Читать книгу Étude sur la bestialité au point de vue historique, médical et juridique - Gaston Dubois-Desaulle - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
La Bestialité et la Mythologie
ОглавлениеTable des matières
LUCRÈCE a dit: «La peur a fait les Dieux.» Ce qui est certain c’est que dans les religions anciennes la Force a été la divinité prépondérante. Dans le paganisme, le culte de la Force se confondit avec celui de la Volupté.
Les dieux primitifs furent les véritables embryons des dieux plus parfaits qui leur succédèrent.
Les hommes imaginèrent des Dieux qu’ils conçurent à leur image et ressemblance et il ne pouvait en être autrement. Les Dieux progressent en quelque sorte avec les besoins, les aspirations des hommes qui les enfantent. A mesure que se développe, s’affine le cerveau de l’homme, la conception qu’il se fait des dieux s’épure, s’idéalise. Lorsque les hommes ont atteint un certain degré de développement intellectuel, ils ne peuvent plus adorer un bœuf Apis quelconque, ou leur grand Pan.
Le sauvage qui ne voit rien, ne sait rien, dont l’intelligence sommeille, adore le soleil parce que rien ne lui paraît aussi grand, aussi beau que cette lumière et cette chaleur. Le primitif construira une idole monstrueuse à laquelle il donnera les formes ou la figure des animaux qu’il redoute, il compliquera ce dieu de symboles représentatifs d’idées.
Dans ces grossiers manitous, dans les très anciennes idoles de l’Inde, la nature divine parcourt toutes les formes de la nature inférieure, on reconnaît les traits rudimentaires de la formation.
Aujourd’hui pour nos idées, pour les yeux que la civilisation nous a faits, ces dieux primitifs sont bizarres, informes, monstrueux, avortés, que les Dieux se nomment Bouddha, Vichnou, Jupiter, Zeus, Allah, Jehovah, Kreistos, tous recevront l’empreinte de la race qui les créa, tous symboliseront les aspirations nouvelles des hommes qui les imaginèrent, puis, régnant par la toute puissance morale, les Dieux, armés du pouvoir qu’on leur attribue, pèseront fatalement sur l’humanité, entraveront la marche du progrès intellectuel, courberont les hommes.
L’imagination antique, voluptueuse et poétique, a conçu le paganisme.
Les Grecs raffinés, subtils, passionnés de la beauté, imaginent Vénus, Minerve, Junon, Jupiter, le terrible Jupiter, toujours amoureux, en quête de nouveautés, le plus coureur des dieux, à qui les déesses ne suffisent pas. Il ne dédaigne pas les mortelles lorsqu’elles sont jolies; pour les posséder, rien ne l’arrête. Si sa forme de Jupiter Olympien le gène, il l’abandonne et devient pluie d’or, cygne, aigle, coursier. Si sa transformation est impossible, il métamorphosera son amante. Il aime Io en vache et se change en taureau pour posséder Europe.
L’exemple est bientôt suivi. Neptune, pour mieux tromper la fille de Bisaltus, la métamorphose en brebis et se change lui-même en bélier.
Phébus se métamorphosera en vautour ou en lion «aux larges flancs» pour posséder Issé, la fille de Macarée.
La mythologie grecque ne craint pas de montrer parmi ses dieux anthropomorphes quelques exemples de bestialité ; on peut donc sûrement en conclure que cette passion existait parmi les peuples de l’antiquité, mais on ne peut certifier qu’elle leur inspirât l’horreur et le dégoût qu’elle revêt aux yeux des peuples modernes. On ne peut, lorsqu’on parle de bestialité et de mythologie, ne pas citer les légendes universellement connues de Pasiphaë, de Léda et d’Io.
Pasiphaë, fille d’Apollon et de la nymphe Perséis, devint la femme de Minos, roi de Crète, il eut d’elle Deucalion, Glaucus, Androgée.
Vénus irritée, paraît-il, contre Apollon qui avait eu l’indiscrétion de la faire surprendre en conversation criminelle avec Mars, ne trouva rien de mieux pour se venger que d’inspirer à Pasiphaë, une passion non moins criminelle pour un taureau.
Ecoutons Virgile plaindre la victime de Vénus courroucée:
«Triste Pasiphaë, heureuse si jamais il n’eût existé de troupeau pour te consoler, il offre à ton amour un taureau plus blanc que la neige. Fille infortunée! Quel est ton égarement? Si les filles de Praetus remplirent les campagnes de faux gémissements, aucune d’elles, du moins, ne rêva un aussi monstrueux hymen, bien que plus d’une fois elles eussent redouté, pour leur cou, le joug de la charrue, et cherché, sur leur front uni, des cornes imaginaires.
«Fille infortunée! maintenant tu erres sur les montagnes; et lui, de ses flancs d’albâtre, pressant la molle hyacinthe, il rumine à l’ombre d’une yeuse les herbes pâlissantes, ou poursuit, parmi de grands troupeaux, une génisse, ta rivale.
«Fermez, Nymphes! Nymphes de Dictée, de ce bois fermez toutes les issues! Là peut-être, du taureau qui me fuit, s’offriront à mes yeux quelques vestiges. L’attrait de l’herbe fraîche ou quelques génisses l’amèneront peut-être, à la suite d’un troupeau, jusqu’aux étables de Gartyne.»
Pasiphaë assouvit sa passion et donna naissance au Minotaure, monstre moitié homme et moitié taureau. Elle eut de son mari d’autres enfants: Deucalion, Androgée, Glaucus, Hécate, Ariane, Phèdre, Xenodite. On a voulu expliquer ces fictions païennes. Platon, Plutarque, prétendirent que l’amant de Pasiphaë était un général crétois appelé Taurus, dont Dédale avait favorisé l’intrigue.
Le Minotaure se dédoubla en ses facteurs simples, deux jumeaux dont l’un ressemblait à Minos, le mari, l’autre à Taurus, l’amant.
La mythologie grecque est une source de joies plus ou moins pures pour les «escholiers» ; elle les repose de la métaphysique et de la subtile théologie des catéchismes chrétiens qui renferment eux aussi des mystères incompréhensibles sans l’aide du merveilleux et d’une intervention surnaturelle.
Voltaire a aiguisé sa plume sur la fable de Pasiphaë et les façons diverses de l’interpréter.
«Non seulement, écrit-il, Platon et Aristote attestent que Minos, ce lieutenant de police des Enfers, autorisa l’amour des garçons, mais les aventures de ses deux filles ne supposent pas qu’elles eussent reçu une excellente éducation.
«N’admirez-vous pas les scoliastes qui, pour sauver l’honneur de Pasiphaë, imaginèrent qu’elle avait été amoureuse d’un gentilhomme crétois, nommé Taurus que Minos fit mettre à la Bastille de Crète sous la garde de Dédale?
«Mais n’admirez-vous pas davantage les Grecs qui imaginèrent la fable de la vache d’airain ou de bois dans laquelle Pasiphaë s’ajusta si bien que le vrai taureau dont elle était folle y fut trompé ?
«Ce n’était pas assez de mouler la vache, il fallutqu’elle fût en chaleur, ce qui était difficile. Quelques commentateurs de cette fable abominable ont osé dire que la reine fit entrer d’abord une génisse amoureuse dans le creux de cette statue et se mit ensuite à sa place. L’amour est ingénieux, mais voilà un bien exécrable emploi du génie.»
Voici la légende de Léda moins grossière que celle de Pasiphaë. Le mythe doit sa grande célébrité aux représentations artistiques dont il fut l’objet en particulier dans l’école attique de sculpture et à l’époque de la Renaissance. Léda, fille de Thestius, roi d’Etolie, ou suivant d’autres traditions, de Glaucus et de Leucippe, fut mariée à Tyndare, roi de Sparte. Malheureusement pour son mari, Léda était très belle, Jupiter en devint amoureux et voulut la posséder. Il alla supplier Vénus de lui prêter assistance. Celle-ci consentit à se changer en aigle, Jupiter en cygne, et l’aigle, avec de grands cris, devait poursuivre le cygne dans les airs. Le pauvre cygne persécuté, se réfugia dans les bras de Léda, qui accueillit fort bien ce tendre suppliant; elle le consola, le réchauffa dans son sein et ne s’en trouva pas plus mal. Seulement elle accoucha, neuf mois après, de deux œufs; du premier naquirent Pollux et la belle Hélène; de l’autre: Castor et Clytemnestre. Le premier couple fut attribué à Jupiter, le second à Tyndare.
La malheureuse Io, fille d’Inaclius, avant de devenir déésse et d’être adorée sous le nom d’Isis, connut les infortunes de l’amour. Jupiter s’était épris d’Io qui ne resta pas insensible à la passion que lui témoigna le maître des Dieux. Junon, irascible et jalouse, en apprenant cette nouvelle infidélité de son volage époux, résolut de se venger. Pour soustraire Io à cette vengeance, Jupiter la changea en vache.
Cette métamorphose n’empêcha pas les deux amants de goûter aux joies de l’amour, mais Junon parvint à s’emparer de la vache, sa rivale, et la donna à garder à Argus.
Mercure protégeait les amants. Il facilita la fuite d’Io qui, après avoir erré au hasard, tant sur terre que sur mer, toujours poursuivie, finit par aborder en Egypte.
Jupiter retrouvant sa puissance divine et maritale fit reprendre à Io sa première forme. Elle introduisit en Egypte le culte de Cérès sous le nom d’Isis. Plus tard Io fut également adorée et d’Io devint Isis.
Ovide raconte aussi les amours des dieux se métamorphosant en bêtes pour mieux séduire les déesses, les nymphes et les mortelles, dont ils étaient épris.
«Arachné représente aussi Astérie dans les serres d’un aigle vainqueur, Léda reposant sous les ailes d’un cygne, Jupiter caché sous la forme d’un Satyre, pour rendre mère de deux enfants la belle Antiope ou sous celle d’Amphitryon, pour te séduire, ô Alcmène! Elle le peint changé en pluie d’or, pour tromper Danaé ; en feu, pour gagner la fille d’Asopus; en berger, pour triompher de Mnémosyne; ou en serpent, pour surprendre la fille de Cérès.
«Là, Neptune, sous les traits d’un taureau menaçant, tu presses de tes flancs la fille d’Eolus; tu deviens l’Enipée, pour donner l’être aux Aloïdes; et bélier pour séduire la fille de Bisaltus.
«La bienfaisante mère des moissons, Cérès aux blonds cheveux, s’abandonne à tes ardeurs, quand tu es changé en coursier: sous la forme d’un oiseau, tu les fais partager à la mère du coursier ailé, à Méduse dont le front est hérissé de vipères; et à Mélanthe, sous celle d’un dauphin. Là, on voit Phébus sous l’extérieur d’un pâtre grossier, ou couvert du plumage d’un vautour, et métamorphosé, tantôt en un lion aux larges flancs, tantôt en berger, pour séduire Issé, la fille de Macarée.»
Virgile dans sa troisième églogue, fait dire à Damœtas,
Parcius ista viris tamen objicienda memento.
Novimus et qui te, transversa tuentibus hircis,
Et quo, sed faciles Nymphæ risere, sacello.
C’est par allusion à ce passage que Voltaire écrit:
«Sous l’empire florissant d’Auguste qui fit régner les lois et les mœurs, à ce que dit Horace, les chèvres ne furent pas absolument méprisées dans les campagnes: les boucs en étaient jaloux.»
Chez les Esquimaux on trouve l’histoire d’une jeune fille mariée à une baleine. Ses frères résolurent de l’enlever à ce mari singulier et construisent une barque d’une vitesse magique au moyen de laquelle ils font fuir leur sœur. Avant de partir ils avaient eu soin de laisser attachée à un rocher la corde au moyen de laquelle la baleine traînait sa femme au fond de la mer. L’animal s’aperçut de sa fuite, poursuivit la barque d’autant plus facilement que la fugitive semait sur sa route tous les objets qu’elle pouvait attraper, finalement la baleine retrouva la belle, s’en empara et ils purent de concert échapper aux frères furieux .
Ce fait n’est qu’une légende; la baleine ayant longtemps revêtu pour les peuples du pôle un caractère surnaturel presque divin.