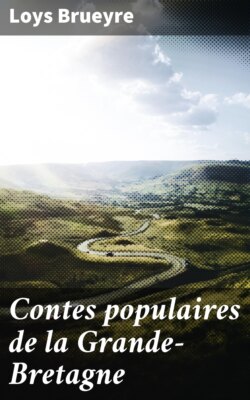Читать книгу Contes populaires de la Grande-Bretagne - Loys Brueyre - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIII.
ОглавлениеTable des matières
Jack fut bientôt fatigué du repos et alla au-devant de son dernier triomphe. Il arriva à une grande montagne, au pied de laquelle s’élevait une maison solitaire. La porte lui fut ouverte par un vieillard dont la tête était blanche comme neige, et qui le reçut très-courtoisement. Pendant le souper, le vieillard lui dit: «Mon fils, je sais que vous êtes un tueur de géants; or donc, vous saurez que sur cette montagne s’élève un château enchanté, demeure du géant Galligantus, qui, par l’aide d’un magicien, retient prisonniers un grand nombre de chevaliers qu’il a transformés en bêtes de toutes sortes. Parmi ces prisonniers se trouve une princesse que le magicien a enlevée de chez son père dans un chariot aérien traîné par des dragons de feu. Il l’a enfermée ici, sous la forme d’une biche. Aucun chevalier n’a pu jusqu’ici la délivrer, à cause de deux terribles griffons qui gardent l’entrée du manoir; pour vous, mon fils, grâce à votre manteau, vous passerez près d’eux sans être vu, et vous apercevrez gravée sur les portes du château une inscription en grands caractères, qui vous apprendra comment l’enchantement peut être rompu.
Le lendemain Jack revêtit son manteau et parvint au sommet de la montagne. Il passa invisible auprès des deux griffons, et quand il fut à la porte du château il aperçut une trompette sur laquelle étaient écrits ces mots:
«Celui qui soufflera dans cette trompette vaincra bientôt le géant et rompra aussitôt l’enchantement.»
Jack aussitôt souffla dans la trompe de manière à faire retentir les échos des collines. Le château trembla dans sa base, le géant et le magicien furent frappés de crainte. Jack eut bientôt tué le premier; quant au magicien, il s’éleva dans l’air comme un tourbillon et on ne le revit plus.
L’enchantement étant brisé, tous les seigneurs et dames reprirent leur forme naturelle.
Jack le Tueur de géants revint alors à la cour du roi Arthur, où il fut uni à la princesse, non-seulement à la joie des seigneurs, mais de tout le royaume.
Jack et Tom-Pouce sont les deux personnages dont les aventures sont les plus populaires dans toutes les parties de l’Angleterre. Tel que nous le donne l’édition de 1711, ce récit est composé de plusieurs épisodes relatifs à des luttes contre les géants, épisodes manifestement soudés ensemble tant bien que mal à différentes époques, et dont Jack est devenu le héros unique. Dans les nombreuses éditions de ces contes, qui depuis des siècles, font frémir les enfants anglais, on ne trouve en général qu’une partie des épisodes relatés ici. W. Scott pense qu’une tradition historique a pu s’y mêler .
La chronique latine de Geoffroy de Monmouth, moine gallois du XIIe siècle, d’où a été tiré le fameux roman de Brut, contient plusieurs épisodes que nous transmet le récit de Jack. On y lit, entre autres, la lutte du prince troyen Brutus avec le géant Gogmagog et le géant Corineus . Le roi Arthur passe à son tour pour un tueur de géants, il combattit également le géant du Mont Saint-Michel et le tua comme il avait tué auparavant le géant Rithor, qui présentait cette particularité, que sa robe était faite avec les barbes des rois qu’il avait vaincus.
D’autres versions de Jack insistent surtout sur ses ressources d’esprit. Ainsi, dans la version erse relatée par Campbell, et qui ressemble au valeureux petit tailleur des Contes de Grimm, Jack est berger, un géant paraît et menace de le tuer, mais l’enfant lui donne à comprendre qu’il est très-vigoureux quoique petit. Le géant, pour l’éprouver, prend une pierre et, fermant la main, il la réduit en poussière; puis il dit à Jack d’en faire autant. Or Jack avait dans sa poche quelques grumeaux de lait caillé ; en les roulant dans la poussière, il donne à cette boule l’apparence d’une pierre, puis il les presse entre ses doigts, et fait couler un ruisseau de petit-lait. Le géant se reconnaît incapable d’en faire autant . Comme seconde épreuve, le géant lance un lourd marteau à une grande distance, et invite Jack à l’imiter. «Je suppose, lui dit l’enfant, que vous ne tenez pas à votre marteau, et que peu vous importe de le revoir ou non! — Qu’est-ce que cela veut dire? grogna le géant. — Cela signifie que si je lance le marteau, il ira s’engloutir dans la mer en un clin d’œil. — Ah! mais non! s’écrie le géant, je tiens à mon marteau qui me vient de mon grand-père.» Le géant préféra alors renoncer à la lutte.
Une autre histoire gaélique de Campbell, Mac-A-Rusgaich, appartient au cycle de Jack, et relate des tours plus ou moins ingénieux du héros à son fermier, dans le genre de ceux qui précèdent. Ce conte contient un trait intéressant. Mac-A-Rusgaich met une paille dans sa bouche et s’en va à la foire pour se louer. Le fermier fait avec lui plusieurs conventions et il est arrêté que celui des deux qui rompra le marché devra avoir une lanière de peau arrachée de la tête aux talons. Cet épisode est fréquent dans les contes norwégiens; il se trouve entre autre dans le Pipeau d’Osborn (Abjörsen, traduction Dasent). M. Morin cite la même tradition, en Bretagne, de l’enlèvement d’un ruban de peau rouge. La convention de Shylock avec Antonio est analogue à celle-ci. Shakespeare l’avait-il empruntée à la tradition populaire ou ailleurs? On ne saurait le dire. Ce qu’il y a de certain, c’est que des contrats de cette nature sont rapportés dans le roman de Dolopathos, le Gesta Romanorum, le Pecorone, de Fiorentino, et ailleurs.
Observations sur l’épisode N° III. — L’aventure qui y est relatée est la reproduction d’un passage du Voyage de Gylfe, poëme eddaïque conservé par Snorrœ Sturleson: «Thor, de son marteau divin Miöllner frappa le géant Skrymer endormi. Le géant se réveilla et demanda si une feuille d’arbre était tombé sur sa figure. Vers minuit, Thor entendit ronfler Skrymer et le frappa sur le crâne avec son marteau. Skrymer s’éveilla, disant:
«Un gland serait-il tombé sur mon front?» Une troisième fois Thor frappa, et son marteau s’enfonça jusqu’au manche. Skrymer se leva, passa la main sur sa joue et dit: «Il m’a semblé que de la fiente d’oiseau était tombée de ce chêne.» Et plus loin: Thor apprend qu’il n’a frappé qu’un rocher invisible que, par son art, Skrymer a placé entre lui et le marteau Miüllner». Les Gaëls d’Écosse ont conservé une tradition semblable, rapportée dans le conte intitulé Cuchullin de la collection Campbell.
Dans ce même épisode n° III, le géant trompé, par la supercherie de Jack, s’ouvre lui-même le ventre. Hunt nous donne un exemple analogue de stupidité de la part du fameux géant Bolster. Ce géant était amoureux de sainte Agnès. Ne pouvant se débarrasser de ses obsessions, la sainte lui demanda comme preuve de son amour de remplir de son sang un trou de rocher. Le géant s’ouvre une veine, le sang coule, mais l’excavation ne se remplissait pas, car elle communiquait avec la mer. Bolster périt ainsi, victime de sa trop grande crédulité.
Observations sur l’épisode N° IV. — Nous y trouvons plusieurs machines appartenant au fonds commun des récits âryens: 1° l’épée merveilleusement tranchante; 2° le manteau d’invisibilité ; 3° les souliers de vitesse.
1° L’épée que le géant donne à Jack est de celles que, dans la Saga de Vœlundr, fabriquait le célèbre forgeron Vœlundr. De la même famille sont aussi: l’épée de Sigmund, dont les morceaux servirent plus tard à forger l’épée Gram de la Vœlsungasaga, l’épée Balmung du héros des Niebelungen, Siegfried; l’épée d’Olaf de Norwége, l’épée Caliburn, qui apparut un jour au roi Arthur tenue par un bras qui s’élevait au milieu d’un lac, et dont Merlin lui fit présent; l’épée gaélique de Fingal, l’épée Mimung de Dietrich de Berne, la Durandal de Roland, l’épée Floberge (d’où notre mot flamberge) dans le roman de Garin le Loherain, puis les célèbres épées: Galland, Hauteclère, Joyeuse, etc. Le nombre des contes où se rencontrent des armes douées de facultés merveilleuses est incalculable. L’épée qui ne manque jamais son coup devient même souvent une épée qui frappe d’elle-même les ennemis et qui retourne ensuite dans la main du héros. Ainsi l’Edda donne cette propriété merveilleuse au glaive de Freya, et, dans la fable grecque, le javelot magique de Céphale, fatal présent de Diane, fit de Procris une victime prédestinée; dans la légende de Robin des Bois, les balles enchantées ne manquent jamais leur coup.
Voici quelques contes en dehors de ceux qui se trouvent dans ce livre, dans lesquels on rencontre des épées merveilleusement tranchantes, ou agissant d’elles-mêmes.
FRANCE. — Contes bretons de Luzel: le Poirier aux poires d’or (arc atteignant le but qu’il vise); le roi Serpent. Foyer breton d’Émile Souvestre: Peronik l’Idiot. (Boule de fer qui, après avoir frappé, revient d’elle-même à sa place, et une lance de diamant qui tue ou brise ce qu’elle touche.)
ALLEMAGNE. — Contes de Grimm: Le Roi de la Montagne d’or. (Le roi possède une épée qui coupe les têtes sans bouger de la main, au seul mot: «Têtes à bas!»)
PAYS SLAVES. — Contes de Chodzko: le Nain, le Tapis volant (massue agissant d’elle-même). Impérissable (glaive tuant tout seul). Nappe nourricière (verge fouettant d’elle-même). Esprit des steppes (massue invisible et merveilleuse).
NORWÉGE. — Abjörsen (traduct. Dasent): Shortshanks.
INDE. — Mais les armes merveilleuses de tous les contes ci-dessus, que sont-elles à côté de celles qui figurent dans les grands poëmes indiens? De pâles reflets. Ainsi le Ramayâna nous montre des armes douées de vie; elles parlent à Rama, prennent ses ordres et s’inclinent respectueusement devant le héros. Dans le Harivansa (traduct. Langlois), l’éclatante poésie indienne se déploie dans toute sa magnificence. Les armes des dieux sont des traits animés et vivants; c’est d’abord le disque terrible de Vichnou; puis la foudre qui gronde dans le temps sec, et celle qui éclate dans le temps humide; le trident redoutable; l’os de mort de Siva, dont le cou est orné d’une guirlande d’os humains, les traits formés de feu, de froid, de vent, de frimas; les armes qui causent l’évanouissement, qui dessèchent, qui brûlent, qui font pleurer, bâiller, etc. Ailleurs (p. 169 et autres) une lutte s’engage entre Sambara et le fils de Crichna. Le premier tire de son arc et envoie à son rival des traits qui se changent en lions, en léopards, en éléphants furieux, en sangliers, en hyènes, en ours, en singes, etc.; ensuite il lui lance des flèches qui, à son ordre, deviennent des serpents enflammés et entraînent le char, les chevaux et l’écuyer du fils de Crichna. Celui-ci riposte par des flèches qui se transforment en animaux à huit pieds, s’élancent sur les serpents et les anéantissent!
2° et 3° Le manteau d’invisibilité et les souliers de vitesse appartiennent aussi aux traditions de tous les pays aryens. La plupart du temps, le même récit contient le vêtement qui rend invisible et l’objet qui permet au héros des contes de franchir l’espace. Le mythe symbolisé semble être le vent. Dans la fable grecque, les cyclopes fabriquent pour Hadès (Pluton) un casque qui rend invisible. Mercure, la tête couverte de ce casque, aida Jupiter dans sa lutte contre le géant Encelade. Une autre fois, les nymphes prêtent à Persée ce fameux casque, ainsi que des talonnières de vitesse pour fendre les airs; de son côté, Vulcain lui confie l’épée Harpé. Ainsi armé, Persée se rend auprès des Gorgones, et, invisible pour elles, il tranche la tête de Méduse. Nous voyons aussi dans l’Odyssée Minerve chausser à ses pieds des sandales d’or afin de traverser l’espace. Les mythologies scandinaves et germaniques contiennent également les mêmes mythes; ainsi Loki s’échappe du Walhalla avec des souliers de vitesse; dans le poëme des Nibelungen, le nain Alberich remet à Siegfried le fameux Nebelkapp, grâce auquel il peut aider le roi Gunther dans des tâches bien différentes, entre autres celle de dompter sa femme! Les traditions celtiques, à leur tour, nous offrent ces mêmes merveilles; ainsi les vieilles légendes du pays de Galles citent, dans l’énumération des treize miraculeuses productions de la Bretagne, le char de Morgan, qui porte où il le désire et en un instant celui qui y prend place, et le voile qu’Arthur n’avait qu’à poser sur sa tête pour devenir invisible. Si nous passons dans l’Inde, les Mille et une nuits nous présentent le tapis enchanté du prince Ahmed; dans le recueil indien du Kathasaritsagara par Somadeva Batta, le roi Poutraka porte des pantoufles qui transportent à travers les airs; dans les contes tartares de Sidi Kur, on voit à la fois un chapeau d’invisibilité et des bottes de vitesse; dans le Gesta Romanorum, conte CXX, il est question d’un tapis de même nature; dans les pays slaves, Chodzko rapporte plusieurs contes où se rencontrent des machines similaires, entre autres: — nappe nourricière, chapeau fulminant; le tapis volant. En Bretagne, Luzel nous montre des guêtres de cent lieues et un chapeau d’invisibilité dans le Poirier aux poires d’or; enfin notre petit Poucet complète le cycle avec ses fameuses bottes de sept lieues. Inutile de continuer cette énumération, qui serait indéfinie, surtout si des vêtements d’invisibilité nous passions aux anneaux semblables à ceux de Gygès. Bien d’autres figures que le tapis volant et les souliers de vitesse étaient employées encore pour exprimer la rapidité du vent. L’une des plus répandues est celle des chevaux héroïques, et le cycle s’étend de la fable grecque: le cheval Pégase, au cheval de bronze des Mille et une nuits.
Épisode N° VII. — Il est probablement tiré des romans de chevalerie du moyen âge, où on le rencontre fréquemment; voir entre autres: l’Arioste, Roland furieux. Le magicien qui a transformé les prisonniers en animaux rappelle Médée et plusieurs personnages des Mille et une Nuits.
CONTE II BIS.