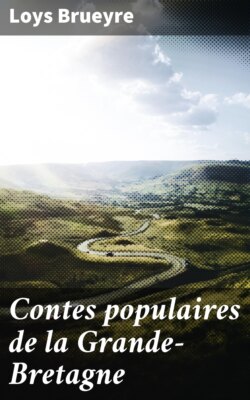Читать книгу Contes populaires de la Grande-Bretagne - Loys Brueyre - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
POËTES DE L’ANGLETERRE
ОглавлениеQUI SE SONT INSPIRÉS DES TRADITIONS POPULAIRES.
Avant d’être reproduites dans leur forme populaire par les écrivains dont nous venons de parler, les traditions du peuple s’étaient cependant fait jour dans les œuvres des romanciers et des poëtes anglais du moyen âge et de la Renaissance. C’est ainsi que, dans les poëmes homériques, dans les récits d’Hérodote et d’autres écrivains de l’antiquité, nous retrouvons des traces précieuses, au point de vue de la comparaison des mythes, des superstitions de leur temps. Les personnages des contes d’origine aryenne ont assez peu fourni à la littérature poétique, mais les croyances aux Fairies ont eu des destinées plus brillantes, elles ont eu la bonne fortune d’inspirer les poëtes les plus illustres de l’Angleterre: Chaucer, Spenser, Shakespeare, etc.
L’éducation classique de l’Angleterre était, à la fin du moyen âge, et au début de la Renaissance entièrement consacrée à l’étude de la littérature grecque et latine. Il était alors de mode, dans l’aristocratie anglaise et dans la société polie, de disserter, non sans pédantisme, sur les beautés et les finesses des écrivains de l’antiquité. Les femmes même se piquaient de lire le grec, et il faut voir avec quelle emphase le précepteur de la reine Élisabeth parlait de la facilité de sa royale élève à s’instruire dans cette langue, et avec quel ravissement comique il écrivait que la reine «lisait plus de grec en un jour que les chanoines de Windsor ne lisaient de latin en une semaine!» Faut-il donc s’étonner si les poëtes mêlaient volontiers dans leurs récits les démons familiers dont ils avaient tant entendu parler dans leur enfance aux gracieux souvenirs de la mythologie antique? Ils sacrifiaient au goût du jour en faisant vivre les personnages populaires côte à côte avec les sylvains et les nymphes d’Ovide et d’Horace, et en introduisant, sans souci des dates et des lieux, les chevaliers de la Table Ronde à la cour de Jules César et d’Alexandre le Grand. En outre, usant de la licence poétique, ils donnèrent à la fois à leurs lutins les attributs des déités champêtres de la Grèce, l’amour de la musique et de la danse des Elfes populaires et les coutumes chevaleresques des fées de romans qui, elles-mêmes, avaient emprunté après les croisades une partie des traits des péris de la Perse et des génies de l’Inde. C’est ainsi que les peintres de la Renaissance ne craignaient pas de représenter les plus austères personnages de la Bible et de l’Évangile sous le pourpoint de la cour de France et le manteau des nobles vénitiens. Ne nous étonnons donc pas lorsque, dans Chaucer, par exemple, Conte du Marchand, nous voyons Pluton, qui est «roi de féerie,» parler à Proserpine de Salomon et de Jésus, et la reine des enfers lui répondre en jurant par sa mère Cérès; ou dans le Songe d’une nuit d’été, Shakespeare choisir pour scène des amours de Titania et d’Obéron les jardins du palais de Thésée et les clairières des bois consacrées aux nymphes grecques; ou dans Drayton figurer à la fois Tom Pouce, Obéron, Mab, Proserpine et le Lélhé. Ces anachronismes étaient fréquents alors à ces époques de renaissance, où les germes des lettres et des sciences, cultivées avec ardeur par les moines du moyen âge, se trouvaient, ainsi qu’en un printemps de l’esprit, éclore tous à la fois.
Il est d’ailleurs fort important de remarquer que cette fusion quelque peu hybride opérée par les poëtes entre des mythologies différentes n’a altéré en rien les traditions populaires. Pour modifier celles-ci il faut des événements considérables qui remuent profondément les masses, comme les changements de religion, les mélanges de races, etc... Les inventions des poëtes ou les incidents ordinaires de la vie des nations glissent sur elles sans y laisser de traces.
L’introduction de la langue française à la cour d’Angleterre est due à Édouard le Confesseur, qui, élevé en Normandie auprès de son oncle Richard, voulut que les officiers de la couronne qui l’approchaient parlassent français. Vingt-trois ans après l’avénement d’Edouard, Guillaume faisait la conquête de la Grande-Bretagne et imposait l’obligation de la langue française à sa cour et dans les tribunaux; ses successeurs tinrent la main à ce que ces prescriptions fussent obéies et ils réussirent si complétement dans cette tâche que les premiers romans composés en Angleterre le furent en français, et que, même du temps de Chaucer, son ami Gower écrivit un ouvrage en notre langue. On peut même dire avec les critiques anglais les plus sérieux: Ritson, Warton, Tyrwhitt, etc., que les auteurs qui ont précédé Chaucer sont des traducteurs, ou tout au plus des imitateurs des écrivains français. L’émancipation littéraire ne commence en Angleterre qu’avec Chaucer et elle ne devient complète qu’à partir de Shakespeare.
C’est seulement à la fin du règne d’Édouard III que l’usage du français commença à tomber en désuétude. La littérature de la France, qui répandait d’ailleurs un vif éclat dans toute l’Europe, était fort goûtée dans l’aristocratie anglaise, en grande partie d’origine normande, et chez les lettrés. Aussi, quand, aux XIIe et XIIIe siècles, parurent nos romans de chevalerie, furent-ils bientôt à la mode en Angleterre; les romans féeriques du cycle d’Arthur et des chevaliers de la Table Ronde qui, reproduisant les traditions de la vieille Armorique mêlées à des récits considérés comme historiques, rappelaient aux habitants des Highlands d’Écosse, de Cornouailles et de Galles les souvenirs patriotiques de leurs luttes contre les envahisseurs saxons, au Ve siècle, devinrent même plus populaires en Angleterre qu’en France. En réalité, ils font partie intégrante de la littérature anglaise par l’importance qu’ils y ont acquise; ce fut d’ailleurs à la cour d’un Plantagenet (probablement Henri III) que furent composés les lais poétiques de Marie de France, dont les sujets étaient empruntés à des traditions également chères aux habitants de même race de la Bretagne française et de la Grande-Bretagne.
Nos romans de chevalerie devinrent donc la source principale à laquelle ont puisé les écrivains de la féerie anglaise. Le lai de Lanval et une de ses variantes, le lai de Graëlent, de Marie de France, furent les principaux matériaux dont Chestre se servit pour son roman en vers du Sire de Lanval, et Chaucer donna pour conclusion à son conte le Rêve les conclusions du lai d’Eliduc, que Marie de France avait elle-même tiré d’une vieille fable grecque. Chaucer emprunta aussi à cette poétesse le fabliau le Coq et le Renard, qui devint son conte des Nonnes.
Les aventures de Lancelot du Lac, de Perceforest, de Parthenopeus de Blois, de Merlin l’Enchanteur, de Floir et Blancheflor, d’Ogier le Danois fournissent en outre des traits nombreux à Chaucer, à Spenser, à Shakespeare et à nombre d’auteurs du moyen âge. Il est juste d’ajouter que si notre littérature devenait ainsi le thème sur lequel brodait l’imagination des plus illustres écrivains de l’Angleterre et de l’Italie, elle en avait à son tour puisé les sujets aux deux célèbres recueils d’apologues indiens: le Dolopathos et le Pantchatantra, ou dans les très-nombreuses versions et imitations de ces livres.
Parmi les romans du cycle d’Arthur, le plus apprécié peut-être en Angleterre fut Huon de Bordeaux, attribué, mais sans aucune preuve, à Huon de Villeneuve. C’est de lui que Spenser, et après lui Shakespeare et Ben-Jonson, empruntent le nom et une partie des traits d’Obéron, pour lequel les Anglais se sentaient d’autant plus d’affinité que cet Obéron était un nain évidemment apparenté aux lutins hauts comme le pouce de leurs croyances populaires.
Le premier en date des auteurs qui se sont inspirés de la mythologie féerique est Chaucer dans ses Contes de Canterbury, qu’il écrivit dans la deuxième moitié du XIVe siècle sur un plan analogue à celui du Décaméron de Boccace et de l’Heptaméron de la reine de Navarre. Toutefois les types de la féerie populaire ne lui fournissent que des allusions passagères; sa plume incrédule ne mentionne les Elfes et leurs danses légères sur les vertes prairies que comme un souvenir effacé des croyances du temps d’Arthur: Pluton et Proserpine sont pour lui les vrais souverains du pays de Féerie. Lorsque Spenser viendra, et après lui Shakespeare, il ne faudra plus qu’un simple coup de baguette pour transformer les terribles monarques de l’enfer grec en ces aimables lutins qu’on nomme Obéron et Titania.
Il nous faut après Chaucer franchir deux siècles pour trouver le grand poëte, son continuateur et son imitateur dans la littérature féerique: j’ai nommé Spenser. Ce fut à la fin du XVIe siècle, quelques années avant que Shakespeare composât le Songe d’une nuit d’été, que Spenser écrivit son poëme intitulé la Reine de Féerie, dédié à la reine Élisabeth. Spenser, dans ce poëme remarquable, mais un peu long (il compte 35,000 vers) compose une mythologie féerique de pure fantaisie et presque sans rapport avec les croyances populaires. Le premier livre est intitulé : Légende de l’enlèvement du chevalier à la Croix-Rouge ou de sainteté ; c’est un souvenir des changeling, c’est-à-dire de ces substitutions faites par les Fairies de leur propre enfant à celui d’une paysanne. Tel est à peu près le seul emprunt qu’ait fait Spenser à la féerie populaire. — Le reste de l’ouvrage est d’ailleurs rempli d’allusions se rapportant aux traditions plus ou moins historiques des cycles de Charlemagne et d’Arthur avec force enchanteurs, géants et autres accessoires des romans de chevalerie. Quant au titre de Fairy Queen (Reine de Féerie), il a été vraisemblablement suggéré à Spenser par le titre donné par Chaucer à la maîtresse de sir Thopas, dont le type rappelle un peu celui de Don Quichotte.
Mais c’est dans les comédies de Shakespeare que la mythologie féerique du peuple apparaît réellement pour la première fois dans toute sa fraîcheur et tout son éclat. Le type choisi par l’illustre poëte parmi les croyances populaires qui avaient entouré son berceau est celui de ces gentils lutins venus de la Scandinavie et qui, sous le nom d’Elfes, défraient tant de contes anglais. Dès que le soleil a disparu derrière les collines, ces gracieux nains s’assemblent dans les bruyères, sur les gazons fleuris ou sous le vert branchage d’un frêne, et là, à la clarté de la lune qui sourit à leurs ébats, ils se livrent à la musique et à la danse jusqu’au chant du coq ou aux premières lueurs de l’aube naissante.
Les Elfes champêtres vivent en monarchie, les nains des grottes et des cavernes en république. Shakespeare, ne s’étant occupé que des premiers, leur donne pour souverains, dans le Songe d’une nuit d’été, Obéron et Titania, et comme, selon la coutume, il fallait aux rois un bouffon, il place à côté d’eux l’espiègle Puck. Obéron, nous l’avons dit, est le héros de la légende bretonne de Huon de Bordeaux; il rappelle à la fois le Korrigan des landes de la Bretagne, le nain Elbérick de la légende allemande de l’Empereur Otnit, par Wolfram de Eschembach, et le célèbre nain Albérich des Niebulengen. Shakespeare le transporte à son tour parmi les Elfes anglais. Pour la belle Titania, elle est, comme Phœbé, si elle n’est pas Phœbé elle-même, la personnification de la lumière argentée de la lune; et les Elfes ses sujets en sont les doux rayons. Puck, dont le nom, avec des acceptions très-diverses (comme nous le verrons dans maintes légendes de ce livre) est choisi par Shakespeare pour représenter le démon familier à la fois malicieux et bienveillant qui, sous le nom de Robin-Bon-Enfant, (Good Fellow), de Goblin et Hob Goblin en Angleterre, de Brownie en Écosse, de Goubelin en Normandie, de Niss en Suède, de Kobold en Allemagne, est le génie du foyer domestique.
«N’êtes-vous pas, dit une fée (Songe d’une nuit d’été) celui qui effraie les filles du village, celui qui écrème le lait, celui qui égare les voyageurs nocturnes en riant de leurs mésaventures? Ceux qui vous appellent Hob Goblin et gentil Puck, vous faites leur ouvrage et leur portez bonheur!..» Puck lui répond: «Tu as trouvé juste, j’amuse Obéron et je le fais sourire lorsque je trompe quelque cheval bien nourri de fèves en imitant le hennissement d’une pouliche en rut. Parfois je me blottis dans la coupe d’une commère sous la forme d’une pomme cuite, je fais paf contre ses lèvres et je répands la bière sur sa gorge parcheminée.»
Avant Shakespeare, Spenser, en son Epithalamium, avait déjà mentionné Puck:
«Ne nous laissons pas effrayer de choses qui n’existent pas, ni par Pouke, ni par un autre fantôme ni par les Hob Goblins, appellations dont le sens est incompréhensible.»
Titania, dans Roméo et Juliette, est remplacée par la reine Mab. Ben-Jonson, dans le divertissement du Satyre, qu’il composa en l’honneur de la reine Anne, femme de Jacques Ier, fit souhaiter la bienvenue à la reine par Mab et sa cour, composée de satyres et de fées. Mab n’est point cependant comme Titania la reine des Elfes, mais elle personnifie les esprits des songes et les rêves agréables; elle se présente alors dans un équipage dont l’adorable description est connue de tous: «MERCUTIO. — Allons, je le vois, la reine » Mab vous a rendu visite cette nuit. Elle est l’ac- » coucheuse des fées; et elle vient, pas plus grosse » que l’agate de la bague que porte à son doigt un » alderman, traînée par un attelage de petits êtres, — » effleurant le nez des gens endormis; — les rayons des » roues sont de longues pattes d’araignée; le dessus » est couvert d’ailes de cigales, — les traits sont les fils » les plus fins de l’araignée, — les harnais, les rayons » humides de la lune; — son fouet est fait d’un os de » grillon, la lanière d’une petite bande de peau; — son » cocher est une petite mouche rose vêtue de gris; — son » char, une noisette vidée par un écureuil son menui- » sier et par la vieille larve qui fabrique les voitures » de fées depuis un temps immémorial. — C’est dans » cet équipage qu’elle galope de nuit, etc....»
La description donnée par Drayton de la reine Mab n’est pas moins curieuse: «Les chevaux qui traînent son char sont quatre coursiers agiles et leurs harnais sont des fils de la Vierge; — le cocher est une petite mouche posée sur le siège. — Le char est une éclatante coquille d’escargot, — le siège est fait du duvet moelleux d’un bourdon, — la capote est l’aile d’un papillon; — les roues sont construites avec des os de grillons élégamment recourbés, et pour éviter le bruit qu’elles feraient en roulant sur les pierres, elles sont entourées du coton de la fleur de chardon.»
Les filles d’honneur viennent derrière leur reine,
«montées sur des cigales qui vont l’amble ou le trot, et s’il survient quelque brise, elles jettent sur leurs épaules une toile d’araignée .»
Tom Pouce (Tom Thumb) aussi appartient à la race des Elfes et comme eux vient du Danemark; il en a la taille et figure à leurs côtés dans maints récits. Scott (Discoverie of Witchcraft) le range parmi les lutins; son nom se rencontre chez presque tous les écrivains de féerie du XVIIe siècle, et Drayton, dans ses Nymphidia, en fait un page chargé de porter un message d’amour et un bracelet fait d’yeux de fourmis à la reine Mab, de la part de son maître, le chevalier Pigwiggen; d’autres le font figurer à la cour du roi Arthur. Nous le verrons ailleurs sous son caractère populaire, et quittant la mythologie féerique pour entrer dans la légende sous la forme, non d’un esprit mais d’un être tout à fait humain, sauf sa taille, haute d’un pouce, qui rappelle son origine d’Elfe. Tom Pouce (voy. Conte I), ne rappelle que par son nom notre Petit Poucet. Le vrai Poucet de nos voisins est Jack le Tueur de géants (voy. Conte II.) Depuis des siècles, les jeunes enfants anglais frémissent à l’exclamation terrible, à ce qu’il paraît, que poussent les géants quand ils aperçoivent Jack: Fi, fi, fo, fum! (Je sens le sang d’un Anglais, je vais écraser tes os pour en faire du pain!) Shakespeare, véritable enfant du peuple et aimant tout ce qui en vient, s’empare de ce: «Fi, fi, fo, fum!» et le met dans la bouche d’Edgar (Roi Lear, acte III, scène V.)
Dans ses autres comédies, Shakespeare nous montre d’autres traits des moeurs des Elfes. Dans les Joyeuses Commères de Windsor, il nous dépeint les espiègleries des esprits domestiques qui sautent dans les cheminées, pincent les filles «noir et bleu» lorsque la maison n’est pas tenue proprement et que les âtres n’ont pas été balayés, ou lorsqu’elles se sont endormies sans faire leurs prières. Dans la Tempête, Prospero a le caractère d’un magicien des Mille et une Nuits. Il tient sous sa domination les Elfes et les appelle à son aide: «Vous, Elfes des collines, des ruisseaux, des lacs dormants et des bosquets, et vous qui de vos pieds qui ne font pas d’empreinte, courez sur le sable, et vous, qui au clair de lune tracez en dansant ces cercles qui laissent l’herbe amère et que la brebis ne broute pas, et vous dont le passe-temps est de faire naître à minuit les champignons.....»
Quant à Ariel, il diffère assez peu de Puck; il en a la malice et l’espièglerie. Prospero le charge de jouer à Caliban un tour qui rappelle une tradition populaire en honneur chez tous les peuples âryens et jusque chez les Bulgares de Macédoine (voy. Conte XXIII). Au son d’un instrument magique, chez les Grecs c’était la lyre d’Orphée ou celle d’Amphion; ailleurs, c’est un pipeau, un cor, un violon; ici, c’est un tambourin, les hommes, les animaux, les arbres, les poissons, la mer même se mettent à danser frénétiquement jusqu’à ce que la musique cesse de se faire entendre. «ARIEL. — Alors j’ai battu mon tambourin et aussitôt, pareils à des poulains sauvages, ils ont dressé les oreilles et relevé le nez comme pour flairer la musique. J’ai tellement charmé leurs oreilles que je les ai fait courir comme des veaux à travers les ronces aux dents aiguës, les fougères aux dards effilés et les ajoncs piquants; à la lin, je les ai laissés barbotant dans l’étang et s’enfonçant jusqu’au menton dans la vase puante du lac.» Dans une autre scène de la Tempête, Shakespeare fait dire à Prospero: «Tu te rappelles ce jour où j’écoutais une sirène exhalant des sons si doux et si harmonieux que ma revêche devint courtoise et que certaines étoiles s’élancèrent follement hors de leurs sphères pour écouter la musique.»
On le voit, certaines figures exagérées reprochées à Shakespeare par les commentateurs trouvent leur explication dans le souvenir des traditions populaires auxquelles le poëte faisait allusion pour plaire à ses spectateurs. Du reste, dans une vieille ballade écossaise du recueil de Jamieson, la harpe du héros Glenkidie a une bien autre puissance que le tambourin d’Ariel. Pour entendre ses accords enchanteurs, les poissons sautaient hors de la mer, l’eau s’élançait des pierres; enfin le lait jaillissait de la poitrine d’une jeune fille qui n’avait pas eu d’enfant!
Les seuls types de la féerie rustique qu’ait immortalisés le génie de Shakespeare sont les Elfes champêtres et les Lutins familiers; il n’adépeint qu’en les effleurant les aventures des gracieuses filles des eaux qui, sous la figure de cygnes, de phoques, viennent s’ébattre sur terre, parfois s’y laissent surprendre par un amant, puis un jour retrouvent leurs ailes et s’envolent, ou reprennent leur peau de phoque et plongent dans la mer. (voy. IIe partie, Contes sur les Mermaids). C’est à elles que fait allusion Shakespeare dans ce passage du Conte d’hiver: «ANTOCHYUS. — Voici une autre ballade sur un poisson qui apparut à la côte le 80 d’avril; on pensa que c’était une femme changée en poisson froid pour n’avoir pas voulu faire échange de chair avec un amant.» Dans cette même comédie, Shakespeare fait aussi allusion, mais en passant seulement, à la croyance si répandue dans les campagnes des changeling.
Dans plusieurs histoires de ce recueil nous verrons que les Elfes donnent une pommade ou une liqueur qui a la propriété merveilleuse de faire voir les fées; dans le Songe d’une nuit d’été, c’est la fleur dont le suc versé sur les paupières de Titania la rend amoureuse de Bottom. Chaucer, dans Palamon et Arcite, avait déjà rappelé ce conte populaire; et l’Arioste et Boiardo avaient donné la même propriété à la fontaine des Ardennes. Tel est le contingent fourni à Shakespeare par les superstitions populaires.
Parmi les imitateurs de la poésie féerique de Spenser et de Shakespeare, et il en est d’illustres: Milton dans son Démon pimpant, Dryden dans la Feuille et la Fleur, Pope enfin, et de nos jours Tennyson, ne mettent en scène que les personnages déjà célébrés par les poëtes leurs prédécesseurs.
Après ces grands noms il nous reste à citer les poetœ minores qui ont puisé des inspirations aux sources des croyances populaires. Dans ces œuvres d’inégale valeur, mais dont plusieurs sont des plus remarquables et mériteraient d’être connues en France, nous ne trouvons non plus aucun trait que nous ne connaissions déjà des mœurs des lutins champêtres, et dans la Fidèle bergère de Fletcher, dans la bucolique d’Amyntas, œuvre aimable mais bizarre moitié latin moitié anglais, de sir Randolph, dans les petits poëmes féeriques si goûtés des délicats par Herrick, le Catulle anglais; enfin dans les gracieuses Nymphes de Drayton, c’est toujours Obéron, Titania, Mab, Puck, Tom-Pouce et leur joyeux cortège d’Elfes malicieux et espiègles, mêlés aux déités antiques, qui gambadent au clair de la lune et mènent leurs rondes fantastiques sur les prés verts jusqu’à l’aurore.