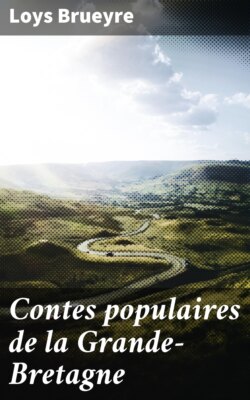Читать книгу Contes populaires de la Grande-Bretagne - Loys Brueyre - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCTION
ОглавлениеTable des matières
Regrettez-vous le temps où le ciel sur la terre
Marchait et respirait dans un peuple de dieux?
Où quatre mille dieux n’avaient pas un athée
ALFRED DE MUSSET.
Sciences auxiliaires de l’histoire. — Géologie, Anthropologie, Philologie comparée. — Mythologie comparée.
David Hume, au début de sa célèbre Histoire d’Angleterre, s’exprime ainsi: «Les esprits curieux et oisifs portent volontiers leurs recherches dans l’antiquité. Les commencements des nations barbares, s’ils étaient connus, paraîtraient insipides aux gens nés dans un siècle plus éclairé.» — Tel était naguère encore le sentiment général des plus graves historiens sur les problèmes que soulèvent les questions relatives à l’origine des races dont nous sommes descendus. — Depuis lors, on en a bien appelé de ce jugement, et les savants de tous pays se sont au contraire efforcés de porter la lumière dans les ténèbres épaisses qui enveloppent les questions ethnologiques. — Malheureusement les anciens tenaient en profond dédain les événements qui s’accomplissaient chez les nations étrangères; aussi les rares documents qu’ils nous ont transmis, tout en contenant de précieux renseignements, témoignent-ils de leur ignorance extrême de l’histoire et de la géographie des peuples barbares, c’est-à-dire de nos pères. Strabon, dont l’ouvrage est pourtant postérieur à la conquête de César, n’écrivait-il pas que les Pyrénées courent du sud au nord et parallèlement au Rhin? Selon lui, la Seine, la Saône, le Doubs prennent leur source dans les Alpes, et la Garonne, la Loire et la Seine coulent du midi au nord? D’un autre côté, les Celtes et les Germains n’écrivaient pas, et c’était même un précepte de la religion druidique que de conserver dans la mémoire seule et de confier à la tradition orale la transmission des dogmes religieux et des hauts faits des ancêtres.
Les documents écrits faisant défaut ou ne pouvait être acceptés qu’après un contrôle sévère, il a fallu rechercher si d’autres sciences ne pouvaient y suppléer, et l’on a trouvé en effet des lumières inattendues dans des sciences qui au premier abord semblent étrangères à l’histoire.
En premier lieu, c’est la géologie qui, par la découverte de l’homme fossile, reporte à des milliers de siècles la présence de l’homme sur la terre; c’est l’anthropologie qui, par la comparaison des caractères physiques des squelettes humains rencontrés dans les antiques sépultures et principalement par la forme et les dimensions de leurs crânes, s’efforce, jusqu’ici d’ailleurs sans résultats bien concluants, de déterminer les races auxquelles ils ont appartenu; c’est aussi la philologie comparée qui, grâce à l’étude du sanscrit, a pu rattacher par le lien des racines et des principes grammaticaux communs de leurs langues, les nations européennes à celles de l’Inde et de la Perse. Enfin, on s’est demandé si les fables primitives et les mythes religieux des peuples anciens ne fourniraient pas à leur tour quelques éléments du problème. On s’est aperçu alors, non sans exciter d’abord la surprise et le doute, que les récits qui charment les veillées d’hiver dans les campagnes, que les contes avec lesquels les nourrices amusent les enfants de génération en génération, que les chansons qui courent les chemins étaient le véhicule d’événements historiques et religieux remontant souvent aux âges les plus reculés.
Origine des traditions communes chez les peuples expliquée par les émigrations et les invasions
Les migrations dans l’antiquité n’avaient pas lieu individuellement comme de nos jours; chassés par une inondation, refoulés par l’invasion de hordes conquérantes ou contraints de fuir un fléau quelconque, les peuples anciens: hommes, femmes, enfants, vieillards, réunissaient un jour leurs troupeaux, entassaient leurs biens dans des chariots, puis commençaient des exodes qui se prolongeaient des années, quelquefois des siècles, pour s’arrêter enfin dans une contrée dont ils expulsaient ou absorbaient les habitants. Le récit que César nous a laissé, dans ses Commentaires, de l’émigration des Boïens et des Helvètes; ceux que Plutarque nous a transmis de cette irruption torrentielle des Cimbres en Gaule, en Espagne, en Italie, que le génie de Marius arrêta aux champs d’Aix et de Verceil; et tant d’autres encore nous fournissent des exemples de ces invasions d’un pays par une nation tout entière.
Mais ce n’était pas seulement leurs biens qu’emportaient avec eux ces conquérants, et dans les contrées qu’ils écrasaient en les traversant, ils laissaient l’empreinte de leurs mœurs, de leur langue, de leurs traditions. Soit que nous considérions les migrations des Aryens des hauts plateaux d’Asie aux extrémités de la Gaule, les invasions des Visigoths en Provence et en Espagne, ou les conquêtes des Normands en Angleterre, en France, en Sicile, les contes que ces peuples ont semés sur leur route sont pour nous les cailloux blancs du Petit-Poucet qui nous font reconnaître les traces de leur passage.
N’est-ce pas une merveilleuse chose, pour prendre un exemple entre mille, que notre conte de Cendrillon se retrouve à la fois dans les traditions de tous les peuples de la race aryenne, aussi bien sur les bords des golfes de Naples et de Venise que sur ceux de la Baltique, et qu’on puisse le suivre dans son idée principale comme sur une piste ininterrompue depuis l’extrémité de l’Europe jusque dans l’Inde et la Perse, dans les contes gaéliques de Campbell, dans les récits de Perrault, dans plusieurs Mærchen de Grimm, chez les Slaves et chez les Russes? Comment ne pas être frappé de rencontrer chez les peuples le plus séparés par la distance, par la langue, par les labeurs quotidiens, la vieille fable de Midas et de ses oreilles d’âne ou des récits rapportés dans l’Ane d’or d’Apulée, il y a plus de quinze cents ans, comme les tâches imposées par Vénus à son fils Éros (voir conte XIII) et mieux encore dans l’Odyssée, il y a près de trois mille ans, comme la légende d’Ulysse dans l’antre de Polyphème, et cette facétie, à ce qu’il paraît toujours jeune, du héros grec prenant le nom de «Personne?» (Voy. Conte XVI.)
objections a la théorie qui rapporte aux migrations des peuples les traditions communes des nations âryennes
D’illustres savants ont conclu de la similitude des traditions populaires des peuples indo-européens qu’à une certaine époque, ils avaient dû subir l’influence de conquérants qui avaient fait pénétrer chez eux leur civilisation et qui peut-être même les avaient absorbés en tant que races. — Deux objections principales ont été élevées contre cette théorie:
1° L’esprit humain est limité dans ses inventions;
2° Les contes européens nous sont venus de l’Inde au moyen âge, principalement à la suite des croisades et par l’intermédiaire des Arabes.
Examinons ces objections:
1° Il est vrai que le cercle de l’imagination de l’homme ne peut s’étendre indéfiniment. L’homme étant, au moral, partout pareil à lui-même, qu’il soit blanc, jaune, rouge ou noir, les événements historiques, sociaux ou autres, nés des mobiles identiques des passions humaines, doivent, en effet, produire des résultats semblables; il n’y a donc pas lieu de s’étonner que des récits analogues soient éclos sous des ciels et chez des peuples différents, ainsi qu’en témoignent les contes trouvés chez les Indiens du nouveau monde, chez les noirs zoulous, etc. Au surplus, les rapprochements qui existent entre ces contes et les nôtres sont en si petit nombre, tandis que les dissemblances en sont si considérables, que l’objection perd toute sa valeur. Enfin, si, plus tard, une étude plus approfondie devait révéler entre nos contes. âryens et ceux d’autres races, entre leurs langues et les nôtres des points de contact réels, il faudra en conclure qu’il fut une époque perdue dans la nuit des temps où ces races avaient elles aussi vécu en commun de la même vie intellectuelle et matérielle jusqu’au jour où un événement, que la Bible rattache à l’érection de la tour de Babel, a causé leur dispersion.
Ajoutons que, dans l’état présent des choses, il ne faudrait pas s’exagérer cette pauvreté d’invention, même lorsqu’elle ne s’exerce que dans les limites du merveilleux. Les contes d’imagination pure, absolument étrangers aux fictions de la littérature populaire, tels que les récits de Swift, d’Hoffmann, d’Edgard Poë et de tant d’autres sont là pour en témoigner.
2° La seconde objection est plus sérieuse, et elle est même exacte par certains côtés. Les pèlerins de terre sainte, les troubadours, les trouvères, les jongleurs parcouraient au moyen âge les châteaux et les villages, chantant ou déclamant des lais et des contes merveilleux. D’un autre côté, les deux célèbres recueils de fictions indiennes, le Pantchatantra et les apologues de Sendabad, se sont répandus par toute l’Europe; parvenus entre les mains des lettrés du moyen âge et de la Renaissance, dans des versions plus ou moins altérées, connues sous les noms de Fables de Bidpaï, de Kalila et de Dimna, de Gesta Romanorum, de Dolopathos, etc., etc., ils ont passé dans la littérature de la France et de l’Italie et ont inspiré les écrivains les plus illustres de l’Europe. Mais de ce que les classes lettrées ont connu, apprécié et fait leurs les récits orientaux, il est tout à fait erroné de conclure que les masses populaires en aient subi la moindre influence, à plus forte raison s’en soient imprégnées et les aient conservés à ce point vivaces qu’elles en aient fait les récits de leurs veillées d’hiver, aussi bien sur le sommet des montagnes d’Écosse que dans les steppes de la Russie ou les landes de la Bretagne. D’ailleurs, il faut bien le dire, est-ce que les œuvres des écrivains d’un pays, quel qu’en soit le mérite, peuvent pénétrer dans les masses et s’y perpétuer dans leurs souvenirs? Quel est le paysan français qui racontera un conte de Nodier ou les Aventures du voyage dans les empires de la Lune et du Soleil, par Cyrano de Bergerac, ou autres contes jadis célèbres? quel est le paysan allemand qui connaît les Contes fantastiques d’Hoffmann? ou le tenancier irlandais au courant des Aventures de Gulliver, par son compatriote Swift? Aucun assurément. C’est qu’il faut distinguer d’une façon absolue les contes réellement populaires des récits d’imagination. Ces derniers ne sont connus que des lettrés; les autres ont à une période de l’histoire fait partie d’un système religieux et mythologique. Une fois entrés dans le fonds populaire, ils ont continué à se transmettre de bouche en bouche, soit pour l’amusement des enfants, soit pour égayer le foyer domestique. De même, dans quelques milliers d’années, si, par impossible, la religion chrétienne venait à s’éteindre, on retrouverait dans des nations éloignées les unes des autres des souvenirs profonds laissés par l’Évangile et les livres saints, et la conclusion qu’il y aurait lieu d’en tirer serait précisément celle que nous invoquons par rapport aux récits âryens: à savoir que ces traditions ont fait partie du fonds commun populaire de nations ayant professé jadis la même foi et qui partageaient les mêmes idées. Nous ajouterons que si les objections auxquelles nous venons de répondre peuvent expliquer la présence de quelques contes isolés chez des peuples différents, elles cessent de se comprendre lorsqu’il s’agit d’un ensemble de traditions reliées par un système d’idées communes et exprimant des mythes de même nature, traditions dont on peut retrouver la trace dans les mythologies indienne, grecque et scandinave bien avant que les relations avec l’Inde eussent pu se renouer par l’intermédiaire des Arabes ou des Maures d’Espagne.
Nous sommes donc amené à conclure que les traditions populaires d’un pays y ont été apportées par les diverses races qui se sont fixées sur son sol et que les contes communs à toutes les nations indo-européennes sont, pour la majorité, ceux que leurs pères possédaient en commun lorsqu’ils vivaient dans la Bactriane.
Cette conclusion, qui eût pu paraître hardie au siècle dernier avant que la philologie comparée eût démontré la parenté originelle des peuples indo-européens, n’est plus maintenant qu’un corollaire naturel de cette découverte. Elle la complète d’autre part en nous révélant, dans une certaine mesure, le côté poétique et religieux de l’antique nation aryenne.
Division des contes populaires en trois groupes.
La comparaison des contes populaires de tous les pays indo-européens nous a conduit à les répartir en trois groupes que nous allons analyser successivement:
1° Contes mythiques de l’époque aryenne.
1° Il existe une couche, on pourrait dire géologique, de fictions qui avaient cours dans l’Aryane avant la séparation, et que les tribus émigrantes ont emportées avec elles en Europe et en Asie.
Ces contes, qui commencent et se terminent par des formules presque toujours semblables, avaient à l’origine un sens symbolique; en général, c’étaient des mythes relatifs au cours journalier ou annuel des astres et-aux phénomènes périodiques de la nature, tels que le retour des saisons ou tout autre phénomène analogue. Les récits de ce genre ont une double action, l’une se passe dans les cieux sous la forme des phénomènes célestes qu’on symbolise; l’autre a pris corps sur la terre dans le récit qu’on raconte.
Dans les grands poëmes indiens, les luttes formidables des Devas et des Détyas, les dix avatars de Vichnou, ne sont que des allégories météorologiques relatives aux phases successives de la création de la terre et de l’univers.
Ces mythes solaires ne sont pas toujours faciles à reconnaître dans les contes tels qu’ils nous sont parvenus, à cause des corruptions et des interpolations qui sont venues troubler la marche du récit primitif et dès lors le développement du mythe initial. En outre, les personnages des mythologies antiques: indienne, grecque, Scandinave, les deux premières surtout, avaient à l’origine une variété d’aspects et d’attributions qui en rendent l’étude très-difficile, habitués que nous sommes à nous les représenter sous le type définitif qu’ils ont pris chez les écrivains de la Grèce et de Rome. — Les événements sanguinaires ou contraires à la morale, les personnages féroces, les monstres des récits mythiques n’y sont le plus souvent que des fictions ou des images, ainsi que l’ont démontré Max Müller et Alfred Maury pour les fables de la mythologie grecque. Il en est de même pour les contes aryens. Mais si ces contes n’ont en eux rien d’immoral, ils ne se proposent pas non plus pour but d’instruire les hommes ni d’inviter à la vertu. Lorsque leur objet est tel, ce qui présente assez souvent, c’est que les narrateurs ayant fini dans la suite des siècles par perdre de vue le caractère primitif purement mythique de ces contes, leur ont donné un sens et une conclusion qu’ils n’avaient très-probablement pas à leur point de départ, afin de faire servir les traditions populaires à la propagation de doctrines morales, philosophiques ou religieuses.
Les contes aryens peuvent être ramenés à un nombre de types peu considérable dont les versions différentes sont répandues dans les nations indo-européennes.
Les épisodes qui composent ces contes mythiques sont eux-mêmes des mythes. Pendant que le récit général symbolise sous la forme de travaux ou de luttes accomplis par un héros terrestre un grand phénomène périodique, par exemple le soleil du matin qui, se levant dans un ciel orageux, dissipe les vapeurs et les nuages, les épisodes de leur côté symbolisent les phénomènes partiels dont se compose l’action générale. Ainsi les vapeurs et les nuages seront des dragons ou des géants; les rayons ardents du soleil deviendront les flèches d’or d’Apollon ou des armes qui ne manquent jamais leur but; d’autres fois pour dépeindre la vitesse du vent, on représente le héros chaussant des bottes de sept lieues, comme notre Petit Poucet ou se plaçant sur un tapis volant à l’exemple du prince Ahmed des Mille et une Nuits. Ces épisodes, ramenés par l’analyse à leur idée première, se réduisent à un petit nombre. Ils ne sont pas plus de quatre-vingts . Les différences qu’on remarque entre les contes âryens dans toutes les nations indo-européennes ne proviennent que des combinaisons différentes des épisodes qui les composent avec les événements historiques, sociaux ou religieux, des pays où ils subsistent, et avec la couleur locale donnée par le narrateur. C’est ainsi que M. P. Kennedy, dans sa préface aux Contes irlandais, dit avec beaucoup de justesse d’expression qu’il pourrait intituler son ouvrage: Récits âryens tels qu’ils sont racontés par les Celtes d’Irlande.
Contes mythiques d’origine âryenne dans la grande-Bretagne
En ce qui concerne spécialement la Grande-Bretagne, les contes mythiques dont nous venons de parler subsistent en Irlande, dans les Highlands d’Ecosse et dans le pays de Galles, c’est-à-dire dans les contrées de langue gaélique et galloise où les éléments celtiques et kymriques sont restés le plus purs. Ces contrées sont peuplées des descendants des malheureuses populations du sud de l’Angleterre qui se sont réfugiées, lors des invasions romaines, dans les retraites inaccessibles des hautes terres, et qui, soustraites parleur manière de vivre et leur langage différent, à l’influence subie par leurs autres compatriotes, sont demeurées les dépositaires fidèles des plus vieilles traditions nationales. Dans le reste de l’Angleterre, ces contes d’origine aryenne semblent s’être effacés sous l’action du temps.
1° — Traditions provenant des mythologies locales nées après l’invasion âryenne. — En Angleterre, ce sont les contes de Fairies.
Au-dessus de cette première couche on rencontre les contes tirés des développements locaux des religions naturalistes communes, à l’origine, aux races âryennes. Chez les Grecs et les Romains, c’étaient ces milliers de divinités locales, éponymes, domestiques, etc. que nos études classiques nous ont rendues familières. Ce sont, èn Angleterre, les récits relatifs aux Elfes des bois, des prés, des cavernes, ce qu’on appelle les contes de Fairies. Ces superstitions ont été apportées, pour la plupart, par les conquérants saxons et scandinaves. En effet, lorsque Rome, forcée de défendre ses frontières contre les barbares qui les envahissaient, laissa la Grande-Bretagne résister avec ses propres forces aux envahisseurs saxons, ceux-ci, après des luttes terribles, finirent par dompter les anciens Bretons, déjà pliés au joug romain. Un grand nombre des habitants émigrèrent: les uns se réfugièrent dans la Bretagne française; les autres s’enfoncèrent dans le nord ou se retirèrent dans les montagnes. Des colonies venues de la Germanie prirent la place des anciens Bretons, et ainsi se forma, principalement dans le sud de l’Angleterre, une nouvelle population où l’élément anglo-saxon l’emporta sur l’élément celtique. Les invasions scandinaves ultérieures renforcèrent encore, au point de vue de la race et des traditions, l’élément germanique. Sous ces efforts, les traces laissées par la civilisation latine disparurent presque complétement, et la mythologie du Nord, avec ses Elfes, ses Mermaids, ses esprits de toutes sortes, vint se mêler aux traditions locales, et constituer les croyances aux divers esprits connus sous le nom générique de Fairies. Les relations entre les diverses parties de l’Angleterre ont d’ailleurs disséminé sur son sol les contes appartenant au groupe des Fairies: on les rencontre dans toutes les parties de la Grande-Bretagne. Nous ajouterons que les superstitions de cette nature doivent se retrouver, comme cela arrive en effet, chez les nations apparentées à ces races, c’est-à-dire en Danemark, en Norwége, en Allemagne et dans les pays où se sont fixés des conquérants d’origine scandinave ou saxonne, comme les Visigoths dans le nord de l’Espagne et la Provence, et comme les Normands et les colons saxons de Bayeux, dans la Normandie.
3° — Traditions modernes. Légendes, ballades, chansons, etc.
La troisième couche est formée des légendes religieuses, ballades, chansons, proverbes, etc.,... engendrés par les faits historiques, généraux ou locaux, par les événements religieux survenus depuis la chute de l’empire romain et l’avénement du christianisme, faits qui ont remplacé le vieux monde par un monde complétement différent. Cette catégorie de traditions est par cela même spéciale à chaque pays.
Telles sont les trois catégories bien tranchées dans lesquelles il faut répartir les récits de la race indo-européenne.
Néanmoins, il va de soi que cette distinction, si nette en théorie, présente dans la pratique de nombreuses exceptions et que dans les récits populaires, les souvenirs des contes âryens de l’époque mythique et ceux des deux autres périodes se mêlent et se confondent souvent. La transformation des anciens récits en légendes religieuses est surtout frappante. Mais le principe n’en subsiste pas moins et si la distinction des éléments d’un conte n’est pas toujours facile à faire à cause de ces mélanges, à plus forte raison le classement des contes dans les trois catégories que j’ai indiquées a quelque chose d’artificiel. J’ai cru pourtant devoir l’adopter, malgré son imperfection, comme correspondant à la nature des choses.