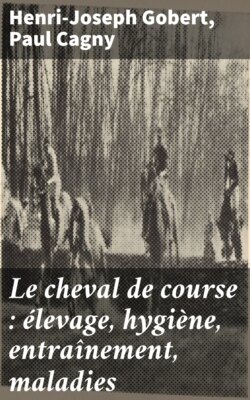Читать книгу Le cheval de course : élevage, hygiène, entraînement, maladies - Paul Cagny - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
§ VI. — AFFECTIONS, MALADIES ET ACCIDENTS DES POULINIÈRES.
ОглавлениеTable des matières
Nous laisserons de côté les divers accidents, plaies, entorses, etc., qui peuvent résulter de chutes, glissades et des mouvements désordonnés auxquels se livrent parfois les poulinières dans l’herbage.
Quand on prend les précautions que nous avons indiquées antérieurement, les accidents qui peuvent se produire pendant la saillie sont facilement évités. Les erreurs de lieu sont rares; l’étalonnier doit veiller cependant à l’introduction du pénis de l’étalon dans le vagin de la jument et l’aider au besoin.
On constate parfois des déchirures du plafond du vagin qui sont déterminées par la verge de l’étalon trop brutal; la paroi peut être entièrement perforée; mais cet accident est fort rare et se produit plutôt pendant la mise-bas, lorsque les membres antérieurs du fœtus ont une direction défectueuse. Généralement, quand la muqueuse seule a été déchirée, l’accident passe inaperçu; il peut y avoir cependant une gère hémorragie qui provoquera l’examen des organes génitaux de la jument et la constatation de la lésion. S’il y a déchirure, l’accident peut avoir des conséquences graves. On traitera par les injections antiseptiques tièdes et le tamponnement de la plaie à la teinture d’iode ou au glycéré tannique, effectués avec soin ainsi que nous l’indiquons plus loin. S’il y a déchirure, le vétérinaire doit intervenir et pratiquer la suture.
Nous allons examiner maintenant les causes de la non-fécondation, les accidents de la gestation et ceux de la mise-bas.
1° Stérilité. — Les causes de la stérilité sont très nombreuses. Elles sont de deux ordres; les unes sont de purs accidents pathologiques, d’autres des défauts d’hygiène; souvent ces défauts d’hygiène entraînent des maladies et ont ainsi un effet complexe.
La stérilité de la jument peut tenir à l’infécondité de la liqueur séminale du mâle. Celle-ci est due soit à un trouble de la sécrétion, soit à un trouble de l’excrétion du sperme. Elle est assez rare d’ailleurs. Cependant, chez les étalons entretenus dans de mauvaises conditions hygiéniques, chez ceux qui sont envahis par la graisse, ou au contraire chez les surmenés, l’aptitude fécondante du sperme est ordinairement diminuée. Il est toujours indiqué de faire l’examen du sperme de l’étalon que l’on vient d’acheter ou bien de tout étalon qui a sailli sans succès plusieurs juments. Examiné à un grossissement de 500 diamètres, le sperme devra montrer des spermatozoïdes en nombre suffisant et très vivants, c’est-à-dire dont la mobilité sera manifeste.
La stérilité peut être due à un défaut congénital, à un développement incomplet des organes génitaux de la jument; mais cette cause est rare. Parfois elle est consécutive à une affection des organes génitaux de la poulinière: vaginite, métrite, salpingite; à une tumeur de ces mêmes organes polypes du vagin, tumeur de la matrice ou kyste de l’ovaire, etc. Dans ces derniers cas, le produit de sécrétion de la muqueuse utérine et vaginale est trop acide et constitue un milieu dangereux pour la vitalité des spermatozoïdes. D’autres fois, la stérilité provient de ce que le col utérin est fermé et ne peut livrer passage au sperme, soit par suite d’une contraction spasmodique de ses fibres (surtout chez les jeunes juments très nerveuses), soit par suite de l’existence de brides fibromembraneuses ou de cicatrices qui sont le vestige de blessures du col déterminées lors d’un part antérieur. On a cité aussi quelques cas d’infécondité due au développement excessif et à la persistance de la membrane hymen.
Le diagnostic de ces diverses affections peut être assez facilement porté ; il suffira de faire une exploration méthodique des organes génitaux externes pour connaître très souvent la nature des lésions. Quand celles-ci sont curables, il est naturellement indiqué de les traiter et d’en obtenir la guérison avant de livrer la jument à la reproduction. C’est ainsi qu’on devra soigner d’abord le catarrhe vaginal, la vaginite ou la métrite, avant de faire saillir la jument. Mais; quand il existe une tumeur de la matrice ou de l’ovaire (et dans ces cas le diagnostic est plus difficile à porter; il faut pratiquer l’exploration rectale qui permet parfois de déceler la présence de la tumeur) ou d’autres affections ou malformations incurables, naturellement la jument devra être retirée du haras.
Il est encore d’autres causes de stérilité, d’ordre plus général, et qui sont sous la dépendance de l’état général de la jument ou de son système nerveux. L’hygiène de la poulinière grosse influence sur son aptitude à être fécondée. Nous avons, à maintes reprises, insisté sur la nécessité de soumettre les juments à un régime rafraîchissant, surtout durant les semaines qui précèdent la saillie. Les deux grandes causes de la stérilité chez la jument de pur sang sont, d’une part, la suralimentation, d’autre part, sa nervosité, et on peut facilement éviter l’une et l’autre, en soumettant durant longtemps la poulinière à un régime à la fois alibile et rafraîchissant longtemps continué. On substituera donc aux grains qui constituaient le fonds de la ration de la jument sortant de l’entraînement des aliments doués de propriétés nutritives et rafraîchissantes, grains cuits, mashes, carottes, aliments sucrés, vert. Si la jument est trop pléthorique, on aidera l’action décongestionnante ou anémiante de ce régime en pratiquant une ou plusieurs saignées de 2 à 3 litres. Souvent, chez les juments de pur sang, l’état pléthorique, la suralimentation ont pour conséquence un état d’éréthisme des organes génitaux qui peut aller jusqu’à la nymphomanie et qui constitue une cause fréquente de stérilité. C’est encore à ce régime rafraîchissant longtemps suivi que l’on aura recours pour combattre ces troubles génitaux. Il faut s’efforcer, par l’application d’une bonne hygiène alimentaire, d’atténuer peu à peu cette prédominance au tempérament nerveux dans l’organisme de la jument. Il faut tenter d’obtenir au contraire un certain état de mollesse, de lymphatisme, qui est le plus favorable pour la fécondation de la poulinière.
Certaines substances injectées dans le vagin un temps variable avant la saillie peuvent favoriser la fécondation de la jument; telles sont les solutions de chlorure de manganèse, de-bicarbonate de chaux, dans l’eau de mer, bicarbonate de soude, phosphate de soude, etc.
C’est ainsi que, dans les cas où la stérilité est causée par l’acidité des milieux vaginaux et utérins (cause fréquente), il est indiqué de pratiquer durant une quinzaine de jours avant la saillie des injections intravaginales journalières faites proprement et aseptiquement, avec une solution de bicarbonate de soude à 2-3 p. 100. Deux heures avant la saillie, on pratique de même une injection avec une solution de phosphate de soude à 2-5 p. 100.
P. Fournier recommande l’injection d’un produit spécial qu’il a dénommé l’ovulase et qui aurait donné d’excellent résultats. L’injection se pratique le jour même où a lieu la chaleur, après désinfection préalable du vagin à l’aide d’une injection d’eau tiède bouillie. On fait saillir la jument le lendemain. Il semble que ces diverses solutions modifient les sécrétions des muqueuses génitales et augmentent le degré de vitalité des spermatozoïdes qui y sont déposés pendant le coït.
On peut recourir, dans certains cas où la stérilité est due à un spasme du col de la matrice, à la dilatation artificielle du col. Cette intervention ne peut guère être tentée que par le vétérinaire. On peut tenter au préalable d’obtenir la dilatation du col en y appliquant de la pommade à l’atropine ou un peu d’extrait de belladone.
La fécondation artificielle a été essayée timidement, il y a plusieurs années, sur de rares juments, et, devant les résultats heureux qu’elle a donnés, on tend de nos jours à l’appliquer à la plupart des juments stériles ou difficiles à remplir. Il va de soi, cependant, qu’il ne faut pas demander à ce procédé de fécondation plus qu’il ne peut donner, et qu’il ne faut pas songer à féconder artificiellement une jument affectée d’une maladie organique grave de l’appareil génital, de malformation des organes génitaux, surtout quand la déformation, si elle n’empêche pas la fécondation, peut gêner considérablement la parturition, etc.
Pour que la fécondation artificielle donne des résultats certains, il faut d’abord s’assurer de la cause de la stérilité absolue ou relative de la jument et traiter cette cause: régime rafraîchissant pour les juments suralimentées; lavages antiseptiques ou alcalins fréquents et longtemps continués pour celles atteintes de métrite ou de vaginite; dilatation progressive du col pour celles qui sont affectées d’atrésie de ce dernier, etc. Ensuite il faut opérer, eh prenant les précautions nécessaires pour que les spermatozoïdes injectés dans les organes génitaux de la femelle aient gardé toute leur vitalité et y trouvent des conditions nécessaires à leur vie propre. Il est indispensable, surtout, que le sperme, dans toutes les manipulations qu’il subit depuis sa sortie de la verge de l’étalon jusqu’à son arrivée dans l’utérus de la jument, soit entretenu constamment à une température uniforme, comprise entre 37 et 40°. Enfin on devra opérer avec la plus grande propreté Possible.
Il est donc préférable, pour la bonne réussite de l’opération,
«d’avoir une couveuse artificielle contenant environ 8 litres d’eau chaude, dont on entretiendrait la température uniforme a 40° C., au moyen des deux veilleuses. La disposition de l’appareil pourrait être telle que le calorique développé serait exactement égal au refroidissement des surfaces, ce qui donnerait une température toujours constante. Au centre de l’appareil, se trouverait une caisse rectangulaire qui permettrait de placer en lieu sec les instruments nécessaires à l’opératio et dont voici la nomenclature: un thermomètre très sensible, un spéculum, l’injecteur ou la seringue choisie, une fine capsule de verre violet pouvant recevoir, dans les cas spéciaux, un préservatif contenant la semence, afin de l’abriter momentanément contre une déperdition de chaleur et pour Je soustraire à la lumière; et enfin une houppe de ouate armée d’un fil, destinée à obturer le col après l’injection. Avant la saillie, l’opérateur introduit le spéculum pour vérifier l’état du vagin, qu’il nettoie et assèche proprement avec du coton hydrophile. Il enlève le spéculum, et le cheval est amené. Aussitôt après la saillie, l’opérateur recueille la semence dans le vagin, où elle est naturellement déposée; pour cela, il prend l’injecteur et assèche tout le vagin de la semence qu’il y trouve; c’est alors qu’il introduit le bout de la canule de l’injecteur et le fait pénétrer aussi profondément que possible, sans toutefois blesser la jument; il injecte ainsi une certaine quantité de sperme, en s’assurant qu’il reste dans l’utérus; après quelques secondes, il retire l’instrument. C’est alors qu’il coiffe le col à l’aide du tampon de coton hydrophile ou de ouate et laisse la jument au repos pendant le reste de la journée» . Fournier recommande encore, lorsqu’on a affaire à une jument affectée d’acidité vaginale trop marquée, ou quand on est en présence d’une jument qui ne peut recevoir l’étalon, de faire saillir une jeune jument saine, de recueillir le sperme dans le vagin de cette jument et de l’injecter dans les organes génitaux de la jument que l’on veut féconder artificiellement, en prenant les précautions décrites plus haut.
Cette pratique de la fécondation artificielle est assez délicate et demande un certain tour de main. Il faut s’efforcer surtout de maintenir toujours la liqueur séminale à une température de 37 à 40° et de ne jamais le mettre en contact avec un instrument malpropre ou qui n’aurait pas été préalablement porté à la température du corps. C’est ainsi que toute seringue ou injecteur qui pénètre dans le vagin, sans avoir été préalablement porté à la température de 40°, abaisse la température de 5 à 10°. En outre passer les instruments dans l’eau chaude, pour s’en servir ensuite, même étant essuyés (car il reste toujours de l’humidité dans la seringue), c’est ne plus se rappeler que l’eau est l’agent le plus actif de la destruction des spermatozoïdes (Fournier et Duret).
On peut utiliser les inséminateurs de différents modèles, modèle «Certes», modèle Hoffmann, etc. La seringue Cholet, dont nous donnons la figure ci-dessous, semble être la plus simple et la plus pratique.
2° Accidents de la gestation. — Ils sont en général très rares sur les poulinières de pur sang.
Parfois les juments pleines maigrissent, baissent d’état, s’anémient. On s’efforcera de découvrir la cause d’amaigrissement et d’y remédier. Il faut alors surveiller leur régime hygiénique, modifier leur ration, leur donner des grains et des farineux, Constater l’état des crottins. En outre d’un régime approprié, on devra leur administrer des toniques et surtout de l’huile de foie de morue.
Fig. 7. — Manuel opératoire de la fécondation artificielle avec le fécondateur Cholet (de Chantilly).
La digestion est rarement troublée par l’état de gestation. Mais les coliques par indigestion deviennent très graves en raison des dangers d’avortement. Il faut donc surveiller de très près le régime alimentaire des poulinières pleines.
Les maladies contagieuses, toujours rares dans les haras (pasteurellose, gourme), sont souvent plus graves chez les juments pleines, surtout à la fin de la gestation.
Les crampes, caractérisées par la contracture des muscles des membres postérieurs, de nature réflexe très probablement et que l’on observe parfois chez les poulinières de race commune, se manifestent rarement sur les juments de pur sang. Ces accidents n’offrent d’ailleurs aucune gravité. Il en est de même de l’œdème du ventre et des membres postérieurs.
La mort du fœtus dans l’utérus peut survenir dans le cours normal de la gestation, avant le terme. Elle s’accompagne presque toujours d’avortement.
Lors de rétention anormale du fœtus, les symptômes sont analogues à ceux de la mise-bas ou de l’avortement; les efforts expulsifs restent vains, puis tout rentre dans l’ordre, et la femelle semble revenir à l’état normal. C’est qu’il existait une cause empêchant la sortie du fœtus: atrésie cicatrielle du col de l’utérus à la suite de blessure lors d’une parturition antérieure; adhérences vaginales anormales au niveau du col; adhérences anormales des ligaments de l’utérus ou des enveloppes; tension du col; positions vicieuses du fœtus (transversale); hernie de la matrice; etc. Après quelque temps, les efforts expulsifs reparaissent; ils sont couronnés de succès ou bien infructueux. Dans ce dernier cas, la putréfaction du fœtus entraîne une inflammation grave de la matrice et la mort par empoisonnement et épuisement de la mère. Heureusement ces accidents, assez fréquents chez la vache, sont fort rares chez la jument et surtout chez la poulinière de pur sang. Il est toujours indiqué, lorsque les premiers efforts expulsifs restent infructueux, de pratiquer l’exploration méthodique du vagin, du col de la matrice, de la matrice elle-même (par la voie rectale), de façon à se rendre compte des obstacles qui s’opposent à la sortie du fœtus et à intervenir suivant les cas.
La hernie de la matrice à travers les muscles abdominaux déchirés peut être la conséquence de coups de pied reçus à l’herbage. Elle se produit généralement dans le flanc gauche et forme une saillie bombée sous la peau. Difficilement curable, cet accident est souvent la cause de parturitions laborieuses. On se contentera, pendant la gestation, d’empêcher que la hernie augmente de volume, en disposant un bandage circulaire solide autour du ventre: généralement après la mise-bas, la hernie se réduit toute seule, mais il y a à craindre que l’intestin ne s’engage dans l’ouverture musculaire et forme ainsi une hernie intestinale.
De tous les accidents qui peuvent survenir sur les juments Pleines, le plus fréquent et le plus grave est sans contredit l’avortement.
L’avortement, c’est l’expulsion du fœtus avant la fin de la gestation, avant qu’il soit viable. Chez les juments, on peut considérer comme avortement l’expulsion du fœtus au moins quarante jours avant le terme normal. Il peut être accidentel ou épizootique.
Avortement accidentel. — Il reconnaît comme causes: les contusions des parois abdominales, coups de pied, heurts de toute nature, chutes; les fortes pressions exercées surl’utérus; les violentes secousses imprimées aux organes abdominaux; c’est ainsi que les indigestions, les coliques sont presque toujours suivies d’avortement, et les causes qui déterminent ces dernières sont par conséquent des causes d’avortement: ingestion d’eau froide, d’herbe gelée ou d’aliments en trop grande quantité, d’aliments avariés, de substances toxiques et irritantes (cantharides), etc.; l’administration d’un purgatif énergique ou de certains médicaments (émétique, digitale, caféine); les courses folles des poulinières dans les herbages après un séjour prolongé dans leurs box; l’excitation, la frayeur; les opérations, les saignées abondantes; l’excitation génitale Provoquée par la présence d’un mâle et surtout par le coït; toutes les maladies graves qui retentissent sur l’économie; la misère physiologique, l’épuisement; les affections dela matrice, métrite, métrorragie, tumeurs; certaines maladies du fœtus et de ses enveloppes (hydropisie), ses fausses positions, son volume exagéré ; quand la jument porte deux fœtus, il n’est pas rare de la voir avorter; enfin quelquefois l’avortement est l’effet de la constitution pléthorique ou lymphatique de la mère; d’autres fois, on ne peut soupçonner aucune cause.
Généralement l’avortement survient brusquement sans prodromes. Il varie dans ses symptômes suivant le développement du fœtus. L’avortement qui a lieu au début de la gestation, durant les deux premiers mois, passe très souvent inaperçu; on est simplement étonné de revoir en chaleur une jument qui avait refusé l’étalon et que l’on croyait pleine. On dit alors que la jument a «coulé ».
Quand l’avortement survient plus tardivement, il est en général également facile: tout est expulsé à la fois, fœtus et enveloppes. Quelquefois on soupçonne l’événement, car les mamelles se gonflent, la vulve se tuméfie. Il ne faut pas attacher cependant une importance très grande à ces prodromes, car il n’est pas rare de les voir se manifester vers le septième mois de la gestation; ils persistent deux ou trois jours, puis ils disparaissent sans avoir été suivis d’avortement et sans qu’on puisse rattacher à une cause quelconque leur apparition. Il suffit parfois que la jument se frotte la vulve contre une barrière pour déterminer du gonflement des lèvres de la vulve et même aussi du gonflement des mamelles.
Il est exceptionnel chez les juments de pur sang que l’avortement se complique. Dans ces cas très rares, l’accident est précédé par un état d’inquiétude: la jument perd l’appétit; sa marche est difficile; de sa vulve tuméfiée s’écoulent des matières visqueuses; ses mamelles se gonflent; puis des efforts expulsifs apparaissent et les eaux s’écoulent; ensuite le fœtus sort soit nu, soit avec ses enveloppes; parfois il est nécessaire d’intervenir pour aider sa sortie.
L’intervention. de l’homme dans les cas d’avortement est très limitée. Il est presque toujours impossible de prévoir l’accident, et souvent on se trouve devant un fait accompli. Ce n’est que lorsque l’avortement est compliqué que l’on peut aider l’expulsion du fœtus soit en dilatant le col contracté par des injections antiseptiques faibles et tièdes, ou par l’application de pommade belladonnée, soit en lubréfiant les parois du Vagin, — cas de rupture hâtive de la poche des eaux, — avec de la glycérine ou de l’huile; si la jument est épuisée, on lui administrera du bouillon, du café, du vin chaud et sucré, etc.
Dans tous les cas d’avortement, facile ou compliqué, il est toujours indiqué d’intervenir après l’accident. Si les soins indispensables que réclame toute jument ayant avorté ne sont pas donnés, il y a à craindre l’infection plus ou moins accusée de la muqueuse utérine, qui peut avoir des suites graves pour l’avenir de la poulinière. Et très souvent des poulinières qui ont avorté antérieurement ne peuvent pas être fécondées, ou remplissent difficilement, parce qu’elles ont manqué de soins après la production de l’accident. Ces soins sont simples; ils consistent en injections antiseptiques qui favorisent l’expulsion totale du délivre. Les injections devront être données deux fois par jour au début, puis, après une semaine, une fois par jour seulement, jusqu’à ce que la jument soit entièrement délivrée, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucun écoulement par la vulve. On se servira du bock en usage pour les femmes, de préférence à la seringue, qu’il est difficile de rendre aseptique. Les instruments (bock, canule) devront être nettoyés à chaque fois et passés au préalable dans l’eau bouillante.
L’opération devra se faire aussi proprement que possible: l’homme chargé de ces soins se lavera et se savonnera à chaque fois les mains et les bras; il les enduira d’huile ayant bouilli, puis, prenant la longue canule qui est fixée au tube de caoutchouc, il l’introduira avec précaution dans le col de l’utérus. Les injections seront données lentement.
On utilisera l’eau bouillie un peu chaude (45°), additionnée d’acide borique (2-5 p. 100), de sublimé (1 p. 2 000), de permanganate de potasse (1 p. 1 000), de lysol (2,3 p. 100), ou d’eau oxygénée (1 p. 5 à 10). Vers la fin de la période du traitement, avant de livrer la jument à l’étalon, on ne fera plus que des injections d’eau bouillie ou d’eau additionnée de bicarbonate de soude (2,3 p. 100).
Avortement épizootique. — Il est heureusement assez rare sur les juments en France. Cependant, en 1905, la maladie a fait de nombreuses victimes dans un grand haras, et depuis on l’a observée à différentes reprises dans différents centres d’élevage situés dans des régions diverses. D’après Lignières, l’avortement épizootique serait assez fréquent en Argentine.
Desoubry, qui a observé la maladie dans cinq établissements d’élevage, estime qu’elle a intéressé le tiers des effectifs et qu’elle aurait causé des ravages beaucoup plus considérables encore, si les précautions prises pour l’enrayer n’avaient pas été minutieuses. C’est donc là une affection redoutable en raison des pertes considérables qu’elle occasionne, car elle s’attaque presque toujours à des juments de pur sang d’une très grande origine et saillies par des étalons de premier ordre. Il importe donc de la prévenir. Malheureusement, on n’est pas encore très exactement fixé sur ses origines.
D’après Nocard et de Bang, l’avortement épizootique reconnaîtrait comme cause un microbe qui serait répandu dans le fumier, la litière, le sol, qui cultiverait dans la matrice, dans les enveloppes, et déterminerait un catarrhe utérin spécifique et l’avortement consécutif. Le germe conserve sa vitalité durant plusieurs mois dans l’utérus, ce qui expliquerait les récidives.
La contagion s’effectuerait donc dans les organes génitaux, par l’intermédiaire de la litière qui souillerait d’abord la muqueuse vulvaire.
Pour Lignières, l’avortement serait dû à l’infection de la mère par un microbe spécial, que l’on rencontre toujours dans l’intestin, rarement dans d’autres viscères, de la mère et du fœtus; l’infection se ferait dans le tube digestif par l’intermédiaire des excréments virulents qui souilleraient les aliments.
Pour Desoubry, l’infection aurait comme origine les aliments et les boissons. Dans trois cas, il a cru pouvoir, après analyse bactériologique, attribuer à l’eau fournie aux animaux la cause de la maladie.
Il semble bien, sans que toutefois aucune constatation Précise nous permette d’étayer notre affirmation, que la première hypothèse est Ja plus véridique: l’accident est dû à une Inflammation spécifique de la muqueuse utérine et des enveloppes fœtales. L’introduction d’une jument étrangère au haras et contaminée peut être la source d’une véritable épidémie. D’autres fois, la maladie débute sur une jument au haras, qui s’est infectée par le contact de ses’organes génitaux externes avec une litière ou un sol souillé.
Nous empruntons les renseignements qui suivent à l’intéressante communication faite par M. Desoubry à la séance de la Société centrale de médecine vétérinaire du 21 janvier 1909:
«Les avortements dus à des causes diverses ne sont pas rares dans les centres d’élevage, et les éleveurs savent faire la part qui revient à ce genre d’accidents. Je ne saurais trop leur recommander toutefois, dès qu’un avortement se produira chez eux, de bien examiner l’état de la jument dans les ving-quatre ou trente-six heures qui suivront l’accident. Si, sur cette dernière, ils constatent des symptômes que je vais décrire, il y a des chances pour que la nature de l’avortement soit infectieuse. Je leur conseille alors de prendre les précautions nécessaires. Avant d’aller plus loin, je tiens à déclarer que les nombreux cas d’avortement dont j’ai été témoin sont indépendants de toute autre maladie infectieuse et que les juments sur lesquelles l’accident s’est produit présentaient toutes les silgnes de la santé générale la plus parfaite.
«Les symptômes prémonitoires sont nuls. Dans le but de pouvoir éliminer des lots de juments saines toute jument qui présenterait des signes suspects, j’avais préposé un jeune. confrère au soin de prendre matin et soir, sur deux lots de 25 juments pleines, la température rectale. Cette fastidieuse opération, pratiquée durant quinze jours, né m’a donné aucun résultat. Toutefois je dois à la vérité de déclarer que, avant la mise en pratique de ce moyen de contrôle, une jument fut trouvée le matin avec 40°,5 de température, avec perte d’appétit accompagnée d’abattement complet. La conjonctive avait une coloration identique à celle que l’on rencontre dans la pneumonie infectieuse. Le sujet fut saigné, sinapisé, reçut les soins que nécessitait son état,. Dans la matinée, l’avortement se produisit, et deux jours après tout rentra dans l’ordre. Ce fut là le seul exemple d’une jument qui, avant l’avortement, ait présenté une élévation thermique notable accompagnée de symptômes inquiétants. Toujours l’avortement se fait avec la plus grande facilité : à peine quelques efforts, l’opération est faite. Seule une jument, dont le poulain était en position dystocique, nécessita une intervention.
«L’accident s’est produit à des moments très variables de la gestation. Il est à cet égard impossible de fixer aucune règle.
«La période d’incubation est d’environ vingt et un jours. J’ai pu fixer ce délai grâce à une constatation des plus intéressante.
«Deux juments étrangères, provenant d’un haras dans lequel la maladie n’a jamais été constatée, sont introduites dans un établissement où débute l’avortement épizootique; elles sont placées dans des box voisins de celui d’une jument qui avorte dans la nuit de leur arrivée. De ces deux juments, l’une avorte le vingt et unième jour, l’autre le vingt-deuxième dans la matinée. Cette détermination de la durée de lapériode d’incubation dans l’avortement épizootique est tellement précise que le propriétaire du haras le plus éprouvé attendait avec une impatience très justifiée, du reste, le temps heureux où pendant vingt et un jours aucun nouveau cas d’avortement ne se serait produit, convaincu, comme je l’étais moi-même, que, si nous arrivions à passer sans accident une telle durée, la maladie avait bien des chances d’être circonscrite. L’avenir nous donna raison.
«Après l’avortement, les symptômes présentés par les femelles sont caractéristiques, au point que, quand ils font défaut, on peut avec certitude affirmer que les avortements constatés sont accidentels et ne procèdent pas d’une infection.
«Environ cinq à six heures après l’accident, la température s’élève graduellement pour atteindre 40° et plus parfois le lendemain. La conjonctive est fortement colorée en rouge-acajou, l’abattement quelquefois extrême, l’appétit nul, la respiration accélérée. Cet état général inquiétant persiste peu; plus ordinairement, deux jours après, ces symptômes s’amendent, l’appétit renaît, la gaîté revient. Mais il reste presque toujours du côté des voies génitales des lésions qu’il importe de surveiller. La délivrance s’opère assez souvent mal et, même dans les cas où elle semble s’être bien faite, il se produit un écoulement purulent ayant mauvaise odeur et qui nécessite un traitement approprié. J’ai, sur une jument avortée, constaté une métrite très grave qui dura plusieurs semaines avec menace de péritonite. Ce fut seulement aux soins les plus sévères qu’on dut la chance de la rendre à la santé. En général, l’écoulement se tarit une semaine après l’avortement.
«Les indications du traitement sont multiples. Les juments avortes doivent être, autant que possible, laissées dans le milieu où s’est produit l’avortement, tandis que les autres sujets Sains seront, aussitôt qu’on le pourra, placés dans des écuries éloignées. Il est de toute importance, tant la contagion est facile, de veiller à ce que les hommes chargés des soins à administrer aux malades n’aient aucun contact avec le personnel désigné. pour les soins à donner aux sujets indemnes ainsi qu’avec ces derniers. Je me suis toujours trouvé bien de la mesure qui consiste à forcer les infirmiers à revêtir, dans les locaux réservés aux malades, des blouses d’une certaine longueur ainsi qu’à chausser des sabots qu’ils quittent pour vaquer à d’autres occupations. Pendant toute la période d’élévation thermique qui suit l’avortement, je fais administrer, par vingt-quatre heures et en trois fois, environ 10 grammes d’un sel de quinine incorporés à un électuaire ou, quand on le peut, à un breuvage alcoolisé. Il est indispensable de faire pendant au moins une semaine, et davantage quand il y a nécessité, des injections intra-utérines antiseptiques. Je recommande particulièrement le permanganate de potasse à la dose de 2 grammes par litre ou l’eau oxygénée coupée au tiers. Les injections sont administrées un peu chaudes, 40° au moins, et très lentement. Elles ne sont jamais inférieures à 5 litres.
«Je me sers pour ces injections d’un grand bock confectionné spécialement pour cet usage et d’une canule en caoutchouc rouge qui n’est autre que la grande sonde rectale qui sert dans l’espèce humaine. Les complications qui peuvent survenir sont traitées selon les circonstances; je n’indique ici que le traitement à utiliser dans les cas ordinaires. J’estime que les juments avortées ne doivent être présentées à l’étalon qu’environ deux mois après l’accident et seulement après avoir subi le traitement dont j’ai parlé plus haut. Sans cette précaution on risque, à mon avis, de permettre à l’étalon de jouer un rôle très efficace dans le transport du germe et de voir survenir plus tard un nouvelle épizootie. Contrairement à mes craintes, les juments avortées ont pu être saillies, la très grande majorité avec succès, dans l’année où l’avortement avait été constaté sur elles. Mais je dois déclarer que ce résultat heureux fut surtout obtenu grâce à l’emploi des injections intra-utérines, pratiquées cinq ou six heures avant la saillie, d’un litre environ d’un sérum physiologique que son auteur a désigné sous le nom d’ovulase.
«Pour ce qui est des juments ayant été exposées à la contagion, je fais procéder tous les matins au lavage avec une solution antiseptique (lysol, lusoforme ou crésyl) de la peau de la face interne des cuisses, de la base et de la face inférieure de la queue et des lèvres de la vulve. Ce lavage est opéré avec des tampons de coton hydrophile qu’on recueille pour brûler ensuite.
«Les injections sous-cutanées d’eau phéniquée à 2 p. 100, préconisées par Nocard dans l’avortement épizootique (de la vache), ne m’ont pas donné de résultats appréciables, et j’ai renoncé à leur emploi. Sur les conseils de M. le Pr Moussu, j’ai essayé les ovules médicamenteux à base d’antiseptiques, tels que l’iodoforme ou l’ichtyol. J’ai dû, après plusieurs tentatives, renoncer, ici encore, à l’usage de ces médicaments. Les juments irritables auxquelles j’avais affaire supportaient très mal cette médication, qui, sans doute, m’aurait donné sur des sujets moins sensibles des résultats plus heureux. De même, je ne puis recommander l’emploi des injections intravaginales de solutions antiseptiques, pour les motifs invoqués plus haut. Dans certains cas, le remède aurait été pire que le mal Par contre, je crois de toute nécessité de procéder à une désinfection du tube digestif. Après avis de notre collègue Lignières, j’avais essayé d’administrer à mes sujets du terpinol à la dose de 20 grammes par jour en électuaire. Ce médicament ne m’a pas rendu les services que j’en attendais, pour la double raison que son odeur très forte est un obstacle Parfois insurmontable à son administration, et parce que j’ai constaté qu’il constipe. J’ai eu alors recours à l’emploi des laxatifs, et surtout j’ai employé la crème de tartre soluble à la dose de 90 grammes par jour.
«Grâce à l’emploi de toutes ces mesures, je suis parvenu à réduire, je le pense, dans une certaine proportion, les cas d’avortement.
«Pour finir, j’estime qu’il est de toute nécessité de procéder à un examen minutieux des fourrages et des grains qui constituent l’alimentation des sujets qui font partie de l’établissement infecté, et d’apporter une attention toute particulière sur la qualité de l’eau de boisson.
«Si l’analyse décèle que celle-ci a été souillée de nombreux microorganismes, comme c’était le cas dans trois épizooties que j’ai pu suivre, il ne faut pas hésiter à la rejeter.
«Il va sans dire que, une fois l’épizootie terminée, une désinfection sérieuse des locaux infectés s’impose» (Desoubry).
Les fœtus et délivres seront brûlés. Les box occupés par les malades seront désinfectés aussi soigneusement que possible. Dans les herbages qu’elles fréquentaient, on fera une corvée de crottins; ceux-ci seront brûlés; les places où ils étaient répandus seront arrosées avec une solution crésylée forte.
Les juments qui ont avorté seront couvertes et tenues très chaudement. On les soumettra à un régime rafraîchissant: barbotages tièdes, dans lesquels on mettra chaque jour une poignée de sulfate de soude et une cuillerée à café de bicarbonate de soude.
Le Pr Moussu (d’Alfort) recommande en outre de faire les premier, troisième, sixième, et dixième jours après l’avortement, une injection dans la matrice avec le mélange suivant:
3° Accidents de la mise-bas. — Dystocies. — Les difficultés de la mise-bas qui nécessitent l’intervention de l’homme sont appelées dystocies. Pour que l’accouchement soit dystocique, il faut que cette intervention ait une certaine importance.
Les difficultés résultent soit de lésions du bassin ou des organes génitaux de la mère (dystocies maternelles), soit de maladies et surtout de présentations anormales du fœtus (dystocies fœtales).
Nous devons dire cependant que les accouchements dystociques sont rares chez les poulinières de pur sang. En général a gestation et la parturition s’accomplissent normalement, et c’est assez naturel. Les poulinières, en effet, ont un bon tempérament; elles sont presque toujours bien conformées; elles ont eu un bon régime alimentaire; elles vivent au grand air, à l’état de liberté. C’est évidemment à elles que faisait allusion un de nos plus célèbres médecins accoucheurs, le Dr Pinard, lorsqu’il écrivait:
«M est nécessaire de faire prendre pour les femmes enceintes les précautions et les soins que prennent les éleveurs pour les femelles en état de gestation.»
Quoi qu’il en soit, nous croyons devoir indiquer ici les principales causes de dystocies avec les moyens d’intervention les Plus simples.
A. Dystocies maternelles. — Le rétrécissement du bassin (angustie pelvienne) est la conséquence ordinaire des fractures d’un des os de cette cavité, notamment du col de l’ilium; parfois il est dû à des exostoses du coxal ou du sacrum, à des tumeurs ou à un développement incomplet de la cavité (surtout chez les femelles très jeunes).
Le diagnostic de ces lésions peut être porté, dans certains cas (fractures), par la simple inspection de la femelle, mais le plus souvent on l’établit par l’exploration interne.
Il est de toute nécessité d’écarter radicalement de la reproduction toute jument atteinte d’angustie pelvienne.
On Pourra tenter l’extraction forcée, en faisant tirer avec une force progressivement croissante sur les membres antérieurs du fœtus, auxquels on aura adapté des lacs. Si le passage est manifestement trop étroit, le vétérinaire pourra tenter de sauver la mère, en pratiquant l’embryotomie.
Le cicatrices. du vagin, les brides vaginales peuvent provoquer la dystocie, les premières en rétrécissant l’organe, les secondes, ordinairement reliquats de déchirures anciennes, en s’opposant à la sortie du fœtus. Il en est de même des tumeurs et des kystes du vagin, toutes affections fort rares chez la jument de pur sang.
L’intervention est simple; sectionner les brides, ou bien inciser avec précaution le vagin au niveau des cicatrices, ou bien ponctionner les kystes.
Nous avons déjà parlé de la hernie de la matrice à propos des accidents de la gestation. Le part se fait ordinairement dans de bonnes conditions, mais il est toujours plus long en raison de l’affaiblissement des parois abdominales. On peut fixer des lacs sur les membres antérieurs du fœtus et faciliter par des tractions les efforts de la jument.
La constriction du col utérin est aussi une cause de dystocie. Elle peut être la conséquence de spasmes, surtout chez les femelles jeunes et vigoureuses; le plus souvent elle résulte d’induration cicatricielle, conséquence de blessure lors d’un part antérieur. Contre le spasme du col, on aura recours aux médicaments opiacés et belladonés (pommades à la belladone ou à l’atropine, en onctions sur le col), aux douches vaginales chaudes, à la dilatation progressive avec les doigts. Lors du rétrécissement cicatriciel, il est parfois nécessaire d’inciser le col incomplètement, en deux ou trois endroits.
B. Dystocies fœtales. — Elles comprennent toutes les formes d’accouchement dystocique dues aux causes suivantes
a. Disposition anormale du cordon ombilical;
b. Excès de volume du fœtus;
c. Maladies du fœtus;
d. Monstruosités;
e. Multiparité ;
f. Présentations et positions anormales du fœtus.
a. Le cordon ombilical peut être enroulé autour d’un membre, du cou ou du corps du fœtus, et empêcher sa sortie. Les efforts expulsifs étant infructueux, on explore les voies génitales et on reconnaît l’enroulement du cordon. Si on ne peut détruire cet enroulement avec la main, il faut sectionner le cordon et se hâter d’attirer le fœtus dehors, afin d’éviter l’asphyxie. Si celle-ci était commençante, on aurait recours à la respiration artificielle, tractions rythmées de la langue, etc., ainsi que nous l’avons dit plus haut.
b. L’excès de volume du foetus s’observe très rarement. On emploiera l’extraction forcée, mais avec circonspection. Si on ne réussit pas, le vétérinaire pratiquera l’embryotomie.
c. Les maladies du fœtus, ascite, anasarque, emphysème généralisé, augmentent son volume, ce qui rend son passage dans le canal pelvien impossible.
les sont fort rares dans la race pure. L’intervention est la même que pour le cas ci-dessus; mais on peut réduire le volume du fœtus, en pratiquant des ponctions multiples, des scarifications cutanées, qui donnent écoulement au liquide ou aux gaz.
La contracture musculaire intéresse souvent les membres antérieurs et la tête. Elle entraîne un raccourcissement très accusé des membres, l’arqûre, la bouleture, ou bien une extension exagérée du membre, suivant que ce sont les fléchisseurs ou les extenseurs qui sont contracturés. — Par l’exploration des voies génitales, on se rend compte de la rigidité des muscles et des membres ou de l’encolure; la main est dans l’impossibilité de les redresser. Pour obtenir le produit, il faut sectionner les tendons ou les muscles et remettre les membres ou la tête en position normale. Parfois on doit recourir à l’embryotomie.
Nous ne citons que pour mémoire les monstruosités fœtales, qu’il est exceptionnel de rencontrer dans la race pure. e. Les parts gémellaires sont également fort rares, chez le pur sang. Presque toujours, il y a avortement, sinon l’un des deux produits meurt quelques jours après sa naissance. L’accouchement ne devient dystocique que quand les deux fœtus superposés s’engagent à la fois dans le bassin. On interviendra en immobilisant l’un des produits à l’aide d’un lacs fixé dans le pli des paturons et en refoulant l’autre fœtus, puis on les extraira successivement.
f. Présentations et positions anormales. — C’est la cause la plus fréquente des dystocies chez les juments de pur sang; nous ne pouvons décrire dans ce livre, qui s’adresse aux éleveurs et, par conséquent, avant tout pratique, les multiples présentations et positions anormales du fœtus qui rendent la mise-bas dystocique. Nous en donnons simplement le tableau à titre d’indication.
Tableau synoptique des dystocies fœtales dépendant des positions et présentations anormales (Cagny et Gobert, Dictionnaire vétérinaire).
Nous ne parlerons que des présentations anormales qui peuvent être réduites sans l’intervention du vétérinaire, lequel cependant doit être appelé aussi hâtivement que possible, dans tous les cas.
Les cas les moins difficiles sont ceux dans lesquels un seul membre se présente avec la tête, l’autre étant allongé en arrière, sur la poitrine, ou bien quand les deux membres aritérieurs. sont allongés en arrière, la tête se présentant seule; la tête peut aussi être encapuchonnée et se présenter par la nuque. Dans d’autres cas, plus difficiles, la tête est complètement retournée, fléchie sous la poitrine ou sur le dos, ou portée de côté, l’encolure étant en état de flexion extrême, etc.
INSTRUMENTS NÉCESSAIRES. — PRÉCAUTIONS A PRENDRE. — Le haras devra être pourvu de quelques instruments nécessaires pour tenter l’extraction du fœtus dans le cas d’accouchement laborieux. Ce sont d’abord des cordes ou lacs, bien graissés et souples, un licol pour maintenir la tête du fœtus, un ou deux porte-lacs pour attacher le lacs à un membre trop éloigné pour que la main puisse y parvenir, un repoussoir, sorte de béquille pour repousser le fœtus ou une de ses parties, enfin un treuil d’un modèle quelconque pour faciliter les tractions; ce treuil peut d’ailleurs être facilement improvisé.
Certaines précautions sont à prendre dans l’application des divers moyens d’intervention. On devra, suivant les cas, opérer sur la jument couchée ou debout; dans ce cas, on lui mettra un tord-nez pour l’empêcher de faire des efforts inutiles et gênants; on l’entravera si c’est nécessaire. On opérera sur une litière propre, dans un endroit où on pourra se mouvoir à son aise.
Avant d’introduire la main et le bras dans le vagin de la jument pour faire l’exploration du fœtus, on les désinfectera soigneusement et on les enduira d’huile ordinaire ou mieux d’huile phéniquée. On évitera avec le plus grand soin de se blesser. On procédera toujours sans brusquerie, et toute force sera appliquée doucement, progressivement.
MODES D’INTERVENTION. — Ils varient nécessairement suivant la nature de la dystocie. La question capitale, c’est de reconnaître d’abord la cause qui met obstacle à la sortie du fœtus, la position exacte du fœtus. A l’exploration, il est relativement facile de reconnaître la tête, le tronc ou les membres; pour distinguer un membre antérieur d’un postérieur, on se basera sur le sens de la flexion au niveau de l’articulation principale, genou ou jarret (la confusion entre ces deux articulations est possible à la simple palpation). L’exploration devra être minutieuse, et c’est ainsi qu’il faut s’assurer que le fœtus se présente bien seul et que l’on n’est pas exposé à faire tirer sur un membre et la tête d’un fœtus par exemple, en même temps que sur un membre antérieur ou postérieur d’un autre.
Quand on s’est rendu un compte exact de la position du fœtus, on opère suivant la logique, suivant ce que le bon sens commande de faire. Les règles des manœuvres obstétricales sont en effet des plus simples en théorie, mais d’une application pratique souvent fort difficile. Elles se réduisent à ceci: une partie du corps du fœtus se présentant en mauvaise position (tête ou membre fléchi), la remettre en bonne Position (extension). C’est très facile à dire, mais plus difficile à exécuter.
Pour y arriver, voici quelques indications qui peuvent être utiles. Si le membre fléchi est à portée de la main, on glisse celle-ci le long de l’avant-bras jusqu’au genou, que l’on tire en avant, puis on prend le pied, on fléchit les articulations inférieures du membre et on l’amène doucement en avant. Si le membre ou la tête que l’on veut redresser ont leur extrémité hors de la portée de la main, alors il ne faut pas hésiter a faire tirer le plus possible (à l’aide de lacs qui y seront adaptés) sur les parties qui se présentent, pour les repousser ensuite le plus possible, recommencer à faire tirer, et repousser, etc. Au bout de quelques tentatives de cette sorte, le fœtus se déplace, et on peut atteindre le membre ou la tête repliée.
Pour redresser un membre ou la tête fléchie, on peut opérer comme nous venons de dire plus haut, en prenant l’extrémité dans la main et en l’attirant vers la vulve de la jument; ce moyen exige une grande force. Voici un autre moyen plus pratique: fixer une anse de corde au-dessous de l’articulation que l’on peut atteindre (genou ou jarret pour un membre, région de la gorge pour la tête), faire tirer sur cette corde pendant qu’avec la main ou un repoussoir on repousse de toutes Ses forces en arrière de son point d’application, au-dessus du genou ou du jarret, ou au milieu de l’encolure par exemple.
Par ce moyen, il est relativement facile de saisir l’extrémité cherchée, de la fixer au moyen d’un lacs mis au-dessous du boulet ou à la mâchoire inférieure, par exemple, et d’agir sur le membre en repoussant le canon, ou sur la tête en repoussant la nuque .
On opérera aussi hâtivement que possible, mais toutefois sans violence, afin de sauver le produit si possible, qui meurt fatalement dès que l’opération se prolonge au delà d’une demi-heure.
Dans les efforts de traction, on fera coïncider ceux-ci avec les efforts expulsifs de la mère. Mais, quand le poulain a été amené en bonne position, on peut enlever le tord-nez et l’entrave à la mère, la laisser se coucher si elle le désire et continuer l’extraction du produit sur la jument couchée.
SOINS CONSÉCUTIFS AUX PARTURITIONS DIFFICILES. — Il faut s’occuper d’abord du produit, s’il n’est pas mort; on lui donnera les soins que nous avons indiqués plus haut; on sectionnera le cordon ombilical après ligature ainsi que nous l’avons dit. On amènera le petit devant la mère, qui le léchera; au besoin, on pourra le bouchonner avec un bouchon de foin ou des torchons secs et chauds; ce massage est excellent pour réveiller l’activité circulatoire et pour sécher le produit.
On le fera téter en le soutenant s’il manque de force; on peut lui faire prendre au biberon un peu de lait de sa mère ou un peu de lait de vache sucré et coupé d’eau; on peut aussi lui donner de légers grogs dans lesquels on mettra une cuillerée à bouche d’eau-de-vie (Duret).
A la jument on donnera les soins ordinaires des parturientes. Si elle est épuisée, on lui administrera du bouillon, une infusion de camomille, de thé, de café, de vin chaud sucré avec de la kola. On la frictionnera vigoureusement et on l’enveloppera chaudement, puis on la laissera dans le calme le plus complet, sur une très bonne litière. Dès que la jument aura repris un peu de force, on commencera les injections antiseptiques un peu chaudes (35-40°) dans les cavités vaginale et utérine. On procédera comme il a été dit à propos de l’avortement. Mais ici on se contentera d’une injection journalière pendant une semaine, sauf cependant si la muqueuse génitale a été blessée, et surtout si la jument a mal délivré. Dans ces cas, les injections seront renouvelées deux fois par jour et seront plus longtemps continuées.
4° Accidents consécutifs à la mise-bas. — L’hémorragie interne, la métrorragie se produit tout de suite après la mise-bas. Elle est consécutive à des déchirures, des blessures de la matrice, du col ou du vagin, qui surviennent surtout dans le cas d’accouchement laborieux ou dystocique.
Elle vient compliquer parfois le renversement de la matrice.
On tentera de l’arrêter par les injections antiseptiques froides ou mieux par le tamponnement de la cavité vaginale avec des linges très propres imbibés de solutions antiseptiques froides (eau oxygénée à 1 p. 3). Si l’hémorragie est abondante, on peut recourir aux injections sous-cutanées de vaso-constricteurs:
6 à 8 grammes de cette solution en injection sous-cutanée.
Ou de sérum gélatiné ou non (50 ou 100 centimètres cubes de sérum antitétanique ou antistreptococcique, par exemple).
On soutiendra la jument par des boissons alcooliques chaudes et sucrées, ou des excitants diffusibles. On l’enveloppera très chaudement. Si l’hémorragie a été abondante, on aura recours aux injections sous-cutanées de sérum artificiel (eau bouillie filtrée, 1 litre; sel marin, 7 grammes).
Les contusions, plaies, déchirures de la matrice et du vagin sont des complications ordinaires des parts dystociques. Cependant, parfois, le vagin peut être déchiré lors d’un part normal, par les pieds du fœtus en mauvaise direction. On soupçonne l’existence d’une de ces lésions traumatiques par la présence de sang à la vulve; l’hémorragie peut d’ailleurs être plus ou moins abondante. On peut assurer le diagnostic en pratiquant l’exploration des organes génitaux avec beaucoup de précautions, afin de ne pas aggraver la lésion, de ne pas agrandir la déchirure, par exemple.
Les plaies de la muqueuse se cicatrisent assez facilement. Mais les perforations, les déchirures sont toujours graves. Elles peuvent se compliquer de hernie de l’intestin ou de la vessie, d’abcès, de péritonite, de fistules vaginales ou recto-vaginales (dans le cas de déchirures du vagin), etc.
On traitera par les injections antiseptiques tièdes, pratiquées deux fois par jour, en prenant les précautions d’usage (Voy. Avortement).
L’eau oxygénée donne de bons résultats. Dans le cas de déchirure, le vétérinaire pourra tenter de pratiquer la suture des lèvres de la plaie, ou bien d’obturer celle-ci avec des tampons de gaze iodoformée retenus chacun par un fil qui pend au dehors et à l’aide duquel on les retire aisément.
Il est bonde laisser les femelles dans le calme le plus absolu. Leur donner des barbotages, des mashes tièdes, des excitants diffusibles avec des antipyrétiques, ou bien des narcotiques dans le cas de douleurs, de coliques.
Quand une jument a été déchirée et que cette déchirure. ne s’est pas fermée, il sera préférable de ne plus la livrer à la reproduction; ou, dans tous les. cas, on devra veiller, dans les accouchements ultérieurs, à ce que les membres du fœtus ne s’engagent pas dans la déchirure, ce qui arrêterait la mise-bas et pourrait avoir des conséquences très graves.
Le renversement de la matrice est un accident assez rare chez la jument, qui ne s’observe guère qu’après un avortement ou une mise-bas difficile. Il se produit au moment de l’expulsion du fœtus ou même un peu de temps après: sous l’influence de violents efforts expulsifs ou de tractions exercées sur le fond de la matrice, la corne dilatée et le fond de l’utérus s’invaginent peu à peu comme un doigt de gant qu’on retourne, progressent vers le col, puis pénètrent dans le vagin, et l’organe vient faire saillie au dehors. Il forme alors une tumeur plus ou moins grosse, à surface rouge vif, violacée ou brunâtre suivant l’ancienneté de la lésion; cette tumeur n’apparaît parfois que pendant le décubitus, la miction ou la défécation. Quelquefois la matrice renversée porte une déchirure. Quand le renversement a lieu après le part et avant la délivrance, il se complique très souvent d’hémorragie qui peut être mortelle. Des symptômes de coliques peuvent encore aggraver l’accident.
Si le renversement est simple, on y remédie assez facilement. On fait de préférence lever la jument, et on l’entrave comme pour une parturition laborieuse. Si possible on la place sur un plan incliné, de façon à surélever l’arrière-main.
Avec la main préalablement aseptisée et huilée, on refoule lentement la matrice et on la repousse progressivement dans le bassin, en ayant soin de l’étaler complètement, de façon à ce qu’elle reprenne sa position absolument normale. On évitera toujours de pousser pendant les efforts expulsifs de la femelle.
Une fois en place, on fera de grandes injections intrautérines tièdes pour distendre les parois utérines et supprimer les replis, causes d’efforts expulsifs. Puis on préviendra la réapparition de l’accident, en maintenant la vulve fermée à l’aide d’un sac plié en quatre, que des aides tiendront pendant tout le temps que dureront les efforts expulsifs. On peut aussi adapter sur la vulve un bandage spécial, en cuir, retenu en haut et en bas par des ficelles qui vont s’attacher au surfaix. Si le renversement se complique de non-délivrance, de déchirure, d’hémorragie, il faut en toute hâte querir le vétérinaire.
Ce n’est que dans les cas d’extrême urgence que l’on peut tenter de décoller avec une très grande douceur les attaches du délivre, puis de refouler la matrice dans l’abdomen, ainsi que nous venons de le dire plus haut. L’hémorragie sera arrêtée par les moyens que nous avons indiqués précédemment. Si la matrice était très tuméfiée et ne pouvait, en raison de son volume, rentrer dans la cavité pelvienne, on tenterait de réduire ses dimensions par la compression méthodique effectuée à l’aide d’un linge, ou mieux de serviettes imbibées d’eau bouillie et enroulées en cravate et nouées progressivement de l’extrémité vers la base de la tumeur hernière, enfin d’en chasser le sang. On peut diminuer l’intensité des efforts expulsifs de la jument en lui administrant des calmants: injection sous-cutanée de morphine, atropine, ou simplement absorption de 1 ou 2 litres d’eau mélangée de vin et d’alcool; administration d’un breuvage chaud contenant 20 à 50 grammes de chloral ou 100 grammes de sulfonal (peu soluble).
Après réduction, la jument sera laissée dans le calme et le repos absolu. Dans les jours qui suivront, on donnera des injections intra-utérines avec un solution antiseptique faible et un peu chaude. Si la mère est trop faible, la soutenir avec des toniques, des excitants diffusibles. On prendra chaque jour sa température, afin de s’assurer qu’elle n’a pas de fièvre, ce qui serait l’indice d’une infection de la matrice. Dans ce cas, renouveler les injections intra-utérines plusieurs fois par jour et administrer des antiseptiques. Mais ces cas graves exigent toujours la présence du vétérinaire.
La non-délivrance est rare chez les juments. Elle ne s’observe que lors d’accouchement prématuré, surtout chez les juments qui produisent pour la première fois, et aussi lors d’avortement. Nous savons, en effet, que chez la jument l’expulsion des enveloppes fœtales ou délivre suit immédiatement ou peu d’instants après la sortie du fœtus. Si ces enveloppes séjournent dans la cavité utérine, elles se mortifient, se putréfient et constituent une source d’infection qui peut avoir des conséquences très graves pour la mère.
Il y a en effet résorption par le sang qui circule dans les parois de la matrice, des produits de décomposition que celle-ci contient, d’où empoisonnement général et infection de tout l’organisme de la mère. En outre, le contact des enveloppes en voie de putréfaction avec la muqueuse utérine entraîne l’inflammation de celle-ci et une métrite consécutive. Donc, quand le délivre n’a pas été évacué après la sortie du fœtus (ce dont il faut toujours s’assurer), il faut en provoquer l’expulsion. Une attente de douze heures après la mise-bas est le maximum de la période d’intervention; si on tardait davantage, la matrice pourrait déjà être infectée, et l’organisme ressentirait les premiers signes de l’intoxication.
Le plus généralement, le cordon ombilical reste pendant en dehors de la vulve. On peut essayer d’exercer sur lui des tractions douces, progressives, sans brusquerie. Si les enveloppes ne viennent pas, on attache à ce cordon un poids de 500 grammes, et on fait, toutes les trois ou quatre heures, des injections antiseptiques assez chaudes dans la cavité vaginale et utérine, en suivant le manuel opératoire indiqué plus haut (Voy. Avortement). Souvent la traction continue et constante du poids suffit pour entraîner les enveloppes que les lavages antiseptiques aident à décoller.
Si, après vingt-quatre heures, on n’a atteint aucun résultat, il faut alors procéder à l’extraction directe à la main. Mais cette opération fort délicate, et qui peut avoir des conséquences très graves si elle est mal faite, ne peut être tentée que par le vétérinaire. Elle peut se compliquer d’hémorragie, de renversement, accidents qui seront traités comme nous avons dit plus haut.
Parfois. dans les avortements, la délivrance est incomplète, et il reste des lambeaux de placenta attachés à la matrice, qui peuvent, en se putréfiant, devenir la source d’infection. C’est pourquoi il est toujours indiqué, après les avortements et même après l’expulsion que l’on croit complète du délivre, lors de non-délivrance, de recourir aux injections antiseptiques tièdes dans la cavité utérine, injections qui seront renouvelées deux fois par jour au début.
S’il Y a eu commencement d’infection de la mère, ce qui se traduit par de la fièvre, on la couvrira très chaudement; on lui administrera des antiseptiques internes, des antipyrétiques et des excitants, boissons alcooliques chaudes et sucrées, ou infusions de thé, de café, etc.
Une jument qui aura délivré difficilement sera surveillée attentivement durant plusieurs jours, afin de combattre les accidents infectieux dès qu’ils apparaîtront.
La métrite est une affection due à l’inflammation de la muqueuse utérine, qui suit ordinairement les accouchements laborieux et dystociques et surtout la non-délivrance. Elle se traduit par l’écoulement à la vulve d’un liquide d’abord blanchâtre, puis jaunâtre ou verdâtre, mal odorant; quelquefois on observe des coliques; la jument maigrit souvent et peut présenter des poussées fébriles. La maladie peut se compliquer de péritonite.
On traitera par les injections antiseptiques dans la matrice.
L’affection, même bénigne, peut avoir, des conséquences graves au point de vue de la reproduction, car il peut persister une légère inflammation chronique de la muqueuse qui modifie ses sécrétions et empêche, par la suite, la jument d’être fécondée. En outre cette irritation chronique de la muqueuse intéressée excite le sens génésique de la jument qui est constamment en chaleurs et reste d’un entretien fort difficile. Aussi doit-on prendre toutes les précautions que nous avons indiquées pour éviter semblable complication.
La fourbure de parturition s’observe assez rarement chez les juments de pur sang entretenues au haras. Les signes sont ceux de la fourbure ordinaire, et ils apparaissent peu de temps après la mise-bas, surtout quand la jument a mal délivré. Le retour de la sécrétion lactée est toujours un signe favorable pour le pronostic.
Le traitement sera celui de la fourbure (injections sous-cutanées d’ésérine et d’arécoline, bains de pieds d’eau froide). On y associera les injections antiseptiques dans la matrice.