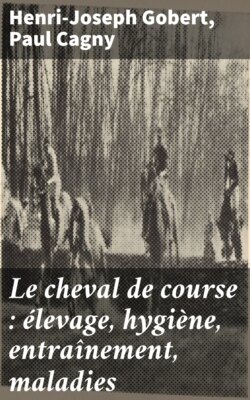Читать книгу Le cheval de course : élevage, hygiène, entraînement, maladies - Paul Cagny - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÉFACE
ОглавлениеTable des matières
Depuis plus d’un siècle que l’on prépare des chevaux en vue des courses, le principe qui régit toutes les méthodes d’entraînement, aussi bien les méthodes hygiéniques que les méthodes de travail, n’a guère varié. En ce qui concerne ces dernières, il ne saurait d’ailleurs en être autrement: ce n’est que par le travail progressif et continu que l’on peut augmenter la puissance fonctionnelle des organes, que l’on peut adapter l’organisme aux conditions de son rendement maximum, que l’on peut en un mot développer jusqu’à leurs plus extrêmes limites, la puissance et la vitesse du moteur animal. Mais, si le principe des méthodes d’entraînement n’est pas perfectible, ses modes d’application par contre, sont susceptibles d’évolution, de progrès. Nous devons avouer cependant que l’évolution a été très lente et les progrès fort réduits. La pratique du training n’est pas devenue une science; elle est restée un art un peu mystérieux et compliqué dont la pratique est confiée à certaines familles de privilégiés qui se le transmettent de père en fils et l’exercent comme un véritable sacerdoce. Par cela même, nombre de ses procédés, de ses coutumes sont restés routiniers, empiriques et surannés. Ainsi la mesure des modifications imprimées à l’organisme par l’alimentation intensive et par le travail progressif est taxée sur des signes extérieurs qui n’ont aucune précision scientifique et qui peuvent être diversement interprétés. De même la progression du travail d’entraînement est restée subordonnée à l’appréciation toute instinctive de celui qui le donne, au sens pratique de l’entraîneur. Pour se guider dans ce travail de transformation lente et obscure qu’il imprime à tous les jeunes organismes qui croissent, se développent, se modifient sous ses yeux, pour s’orienter dans la mise au point de ces machines vivantes qui lui sont confiées, l’entraîneur ne possède aucun repère précis, aucun signe véritablement rigoureux, certain, d’une appréciation facile, qui lui permettra de guider sa progression de travail, son régime hygiénique et alimentaire. Et l’on est en droit de s’étonner, devant pareille constatation, que des méthodes d’entraînement étayées sur de solides données physiologiques et mécaniques n’aient pas encore apporté à la préparation de cette machine si spéciale que constitue le cheval de course, la rigueur scientifique que nous sommes habitués à rencontrer dans tout ce qui touche l’exploitation par l’homme d’un générateur de force ou de mouvement.
Nous avons tenté, dans ce livre, de raisonner, d’expliquer scientifiquement les pratiques les plus importantes de l’entraînement. Nous avons considéré le cheval de course comme un moteur animé dont l’entretien et le fonctionnement sont soumis à des lois physiologiques et mécaniques et ce sont ces principes que nous nous sommes efforcés d’exposer clairement. Ils régissent toute l’hygiène de l’entraînement et quand on en est bien pénétré, on ramène facilement les efforts constatés, normaux ou pathologiques, à leur cause véritable. Nous ne pensons pas avoir résolu par cela même, tout le problème si délicat et si complexe de l’entraînement scientifique: l’être animé, quel qu’il soit, porte en lui trop de mystères, pour qu’on puisse déterminer avec exactitude tous les éléments de sa transformation, ou mesurer tous les phénomènes biologiques qui engendrent on accompagnent l’effort, le mouvement.
Dans une première partie réservée à l’élevage du cheval de course, nous avons exposé tout ce qui a trait à l’établissement d’un haras, à l’entretien des prairies, au choix des reproducteurs, à l’hygiène de l’étalon, de la poulinière et du poulain; nous avons décrit les affections, maladies et accidents auxquels ils sont plus particulièrement exposés, notamment les accidents de la gestation et de la mise bas et les maladies du poulain.
Dans la seconde partie du livre, nous avons envisagé le cheval de course à l’entraînement. Nous avons étudié d’abord l’hygiène alimentaire, la façon de nourrir d’une façon rationnelle le cheval de course en croissance, en plein travail.... et nous avons décrit les affections digestives ou les troubles de la nutrition générale qui résultent presque toujours de l’inobservation de ces règles hygiéniques. Puis nous avons traité de l’hygiène du travail en présentant d’abord des considérations générales sur la physiologie du travail musculaire et de l’effort, sur la condition, sur l’évolution du modèle. Nous avons envisagé ensuite les pratiques de l’entraînement proprement dit en nous efforçant toujours d’expliquer scientifiquement les raisons de ces pratiques et d’apporter à la constatation de leurs effets une précision qui leur manque tant. Le doping a été le sujet d’une étude spéciale. Nous avons décrit minutieusement les soins à donner aux membres en vue d’atténuer, de réduire et même d’éviter les effets nocifs du travail intensif, ainsi que les soins à donner aux pieds et la façon rationnelle de ferrer les chevaux de course.
Nous nous sommes étendus très largement ensuite sur la Pathologie des chevaux de course à l’entraînement. Cette partie de notre travail, de beaucoup la plus importante puisqu’elle occupe presque la moitié du livre, en constitue, à notre sens, sa véritable et modeste valeur originale. Il n’existait pas jusqu’ici, à proprement parler, de véritable traité des maladies du cheval de course: en écrivant cet ouvrage, nous pensons avoir comblé cette lacune. Les affections chez le cheval sont presque toutes des maladies de service; leur nature, leur Physionomie, leurs manifestations varient avec celui-ci et aussi avec l’activité réactionnelle particulière du cheval qui y est soumis. Le cheval de course étant entretenu et utilisé suivant un mode spécial, il est par conséquent des maladies qui lui sont propres et d’autres qui se manifestent chez lui avec des symptômes particuliers.
Nous avons envisagé d’abord l’étiologie générale des affections du cheval de course, en montrant successivement l’action nocive de l’hérédité, du jeune âge, du travail vite dans la détermination de ses maladies ou tares. Puis, nous avons montré la réaction particulière du cheval de pur sang à l’action de la maladie et, nous basant sur l’activité réactionnelle de cet organisme si délicat et si sensible, nous avons établi une thérapeutique spéciale du cheval de course, en insistant particulièrement sur lés précautions à prendre avant, pendant et après les opérations chirurgicales. Nous avons alors exposé aussi clairement que possible, les affections des divers appareils ou fonctions, en nous étendant surtout sur les maladies de l’appareil locomoteur qui sont naturellement les plus fréquentes chez des individus travaillant en mode de vitesse. Les affections des os, des tendons, du pied ont été décrites et exposées minutieusement et nous nous sommes efforcés de déterminer exactement la genèse des lésions et, par cela même, les moyens de les éviter. Enfin parmi les multiples maladies des autres appareils que nous avons étudiées, nous devons mentionner particulièrement le cornage, la pousse, le cœur forcé, les hémorragies internes, le saignement de nez, la pisse, le mal de chien, l’hystérie, le surmenage..... qui sont surtout propres au cheval de course.
Nous avons fait appel en rédigeant ce livre, aux observations très nombreuses que nous avons pu faire l’un et l’autre dans une pratique déjà longue du cheval de pur sang, aux conseils d’éleveurs, d’entraîneurs, de propriétaires connus et réputés, aux enseignements qu’a prodigués à l’un de nous son vénéré père, qui fut pendant cinquante ans le vétérinaire très écouté des plus grandes écuries de course et à la mémoire duquel nous adressons un respectueux et reconnaissant hommage.
H.-J. GOBERT P. CAGNY.