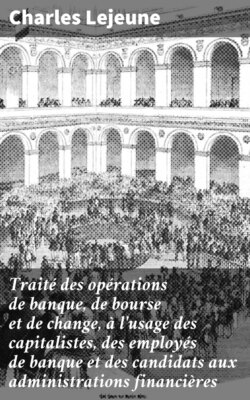Читать книгу Traité des opérations de banque, de bourse et de change, à l'usage des capitalistes, des employés de banque et des candidats aux administrations financières - Charles Lejeune - Страница 39
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. — BANQUES POPULAIRES
ОглавлениеTable des matières
Les Banques populaires ont pour but d’accorder du crédit à de petits fabricants, à de petits commerçants qui, isolément, n’ont aucune «surfacé » personnelle, mais qui, en se groupant en associations, se prêtent un appui mutuel et offrent une garantie par la responsabilité individuelle et solidaire qu’ils assument pour les engagements pris par chacun d’eux. Un banquier n’escompterait pas du papier tiré par un modeste producteur sans crédit, mais il y consentira si 10, 20 ou 100 autres petits fabricants sont solidairement garants de celui-ci.
Les premières banques populaires, appelées aussi «Caisses de crédit», ont fonctionné en Allemagne, où elles ont été organisées de façon un peu différente, vers 1848, par deux hommes qui leur ont donné leur nom: Schulze (appelé Schulze-Delitsch, du nom de sa ville natale en Saxe prussienne), et Raiffeisen, originaire de la Prusse rhénane.
Les Banques populaires Schulze-Delitsch et Raiffeisen ont comme caractère commun de présenter une application du principe de la mutualité, en vertu duquel tous les membres d’une association, en vue du crédit, sont engagés pour chacun. Ces associés, qui sont souvent du même corps de métier, habitent toujours la même ville ou la même région; ils se connaissent et se groupent en raison de la confiance qu’ils ont à l’égard les uns des autres.
Mais les Banques populaires Schulze-Delitsch se distinguent des Caisses de crédit Raiffeisen en ce. que les premières sont de véritables banques mutuelles, ayant pour but de réaliser des bénéfices et d’en faire profiter leurs adhérents, développant ainsi le goût de l’épargne dans les classes populaires, et atténuant les conflits sociaux en faisant de tous les prolétaires autant de petits capitalistes. En effet, les Banques Schulze ont pu distribuer annuellement des dividendes qui se sont élevés à 20, 25, 30 et même 50 % du montant des actions; elles sont constituées par actions de 1.000 marks, que les adhérents peuvent acquérir au moyen de versements échelonnés. Il est à noter que ces banques recrutent leurs membres: et par conséquent leurs clients dans l’industrie ou le commerce. On comptait en Allemagne, en 1913, environ 1.200 Banques Schulze groupant 600.000 membres, avec un capital de 1 milliard 600 millions de marks.
Au contraire, les Caisses de crédit Raiffeisen, qui prennent leurs associés parmi les agriculteurs, auxquels elles accordent du crédit pour acheter du bétail, des semences, des engrais, des machines agricoles, ne sont pas constituées comme des banques: ce sont plutôt des organisations de solidarité n’ayant pas pour but de faire des bénéfices, mais d’aider les petits cultivateurs dans une intention philanthropique et charitable. Tous les emplois (sauf parfois celui du caissier qui est permanent) y sont bénévoles et gratuits, n’étant d’ailleurs qu’intermittents. Pendant longtemps, les Caisses Raiffeisen n’ont pas eu de capital et les membres n’ont pas eu par conséquent d’actions à souscrire et à payer. Mais en vertu de la loi allemande sur les sociétés, elles ont été obligées de se constituer un capital minimum formé par des actions d’un prix très réduit (10 marks environ). Jusqu’à ce que cette même loi les y ait obligées, elles n’ont pas distribué de dividendes, tous les bénéfices devant être ajoutés au fonds de réserve, grâce auquel les prêts pouvaient être effectués; lorsque ce fonds de réserve devenait assez important, les prêts nouveaux devaient pouvoir être consentis à un intérêt moindre, et même ces Caisses pouvaient entreprendre des travaux dont bénéficiaient gratuitement les adhérents. Depuis qu’elles sont tenues par la loi de distribuer un dividende, elles créditent chacun des membres d’une somme très réduite (1 mark), puis le débitent de pareille somme comme prix de l’abonnement à une publication éditée par le bureau central des Caisses Raiffeisen. Ces Caisses étaient, en 1913, au nombre de 5.000, réunissant 500.000 membres environ.
Les Banques Schulze, comme les Caisses Raiffeisen, avaient un bureau et une caisse centrale. En 1895, l’État allemand a créé une Caisse centrale des associations de crédit populaire, qu’il a dotée d’un capital de 75 millions de marks et qui sert de Trésorerie centrale régulatrice, répartissant l’argent dans les régions ou dans les corporations où le besoin s’en fait sentir, à la suite de mauvaise récolte, de chômage, etc... En 1911, la Caisse centrale a fait ainsi circuler un total de 26 milliards de marks.
L’exemple donné par les Allemands n’a été malheureusement que peu suivi en France, du moins en ce qui concerne les véritables Banques populaires. Après quelques essais malheureux tentés depuis 1860, il a fallu arriver à 1893 pour voir se former une organisation durable: la Banque coopérative des associations ouvrières de production. On cite encore: le Centre fédératif du crédit populaire en France, comprenant une douzaine de banques populaires urbaines, l’Union des Caisses rurales et ouvrières françaises groupant 900 sociétés, la Banque fédérale de l’alimentation, groupant environ 250 chambres syndicales.
Les Pouvoirs publics ont voulu développer encore le crédit populaire et ont fait, dans ce but, la loi du 13 mars 1917. Le résultat a été satisfaisant, car, de 1919 à 1921, 90 Banques populaires nouvelles ont été formées.
On peut également assimiler aux Banques populaires les Caisses de crédit agricole, sortes de caisses locales ou régionales, permettant à des sociétés coopératives les achats en commun d’approvisionnements, d’engrais, de machines, etc..., et surtout les Caisses de crédit mutuel, organisées à la manière des Caisses Raiffeisen. Ces Caisses, organisées par la loi du 5 novembre 1894, encouragées par des subventions de l’État (40 millions versés par la Banque de France en 1897, et une redevance annuelle de cette même Banque de France, qui s’élevait avant 1914 à 4 millions de francs environ), ont été développées par de nombreuses lois dont la dernière, celle du 5 août 1920, a abrogé les précédentes. On comptait en 1919 4.500 caisses locales et 97 caisses régionales, ayant un capital de 27 millions et ayant reçu 67 millions à titre d’avances de l’État. Elles ont fait pour près de 80 millions d’escompte en 1919 (au lieu de 210 millions en 1913).
En Belgique, en Italie, en Suisse, en Autriche, au Japon, on a mieux qu’en France imité l’exemple des Banques Schulze et des Caisses Raiffeisen. En général, les Banques populaires organisées dans ces pays tiennent à la fois des deux systèmes allemands.