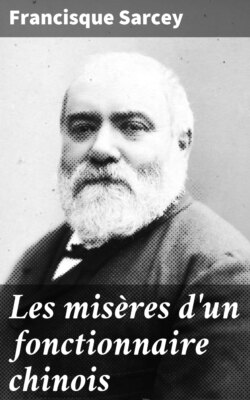Читать книгу Les misères d'un fonctionnaire chinois - Francisque Sarcey - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеX
HISTOIRE DU VIEILLARD RAPÉ
Table des matières
–Hélas! répondit le vieillard, c’est vous, je le vois bien, qui allez occuper le poste que j’avais sollicité, et qui m’était dû à tant de titres. Je ne vous eu veux point, monsieur, car vous ne savez pas le mal que vous me faites. Mais votre présence renouvelle en moi le sentiment de mon malheur, et en aigrit encore l’amertume.
Et le vieillard se mit à pleurer. De grosses larmes tombaient de ses yeux et roulaient silencieusement sur ses joues maigres. Le jeune Fo-hi, très ému de ce spectacle, invita ce pauvre homme à dîner avec lui, et lui fit conter son histoire au dessert.
–Cette histoire n’est pas longue, dit le vieillard râpé; elle n’en est pas moins triste. J’étais filleul de l’arrière-cousin d’un homme puissant. J’entrai, par la protection de mon parrain, dans l’administration des routes. Ah! que j’aurais bien mieux fait de rester dans la boutique de mon père et d’y apprendre son état! Plût à Dieu que je fusse cordonnier, au lieu de courir sur les grands chemins! Je me mariai, monsieur; mieux eût valu pour moi me mettre une pierre au cou, et me jeter dans la rivière. Ma femme était une bonne femme; je n’ai pas à m’en plaindre, et je ne regrette pas encore de l’avoir épousée. Elle a partagé toutes mes heures de misères, et elle a su me les rendre plus douces. Mais elle n’avait que peu de chose; c’est ce qu’on appelle un mariage d’inclination. Elle me donna un enfant chaque année, avec une régularité désespérante. J’en ai sept aujourd’hui, monsieur.
Le premier nous combla de joie; nous remerciâmes Dieu, qui bénissait notre union. Le second ne nous fut pas désagréable; nous commençâmes à réfléchir au troisième, et nous fùmes tous les deux comme fous de chagrin quand vint notre petit dernier. Nous n’avions pas déjà de quoi nourrir les six autres; nous mourions de faim, cela est à la lettre. Vous savez les appointements qu’on reçoit dans notre partie; vous pensez si neuf personnes peuvent vivre là-dessus.
Ma pauvre femme se mit en tête de gagner quelque argent, car c’est une femme très courageuse. Elle ouvrit un petit magasin de modes; ses deux filles aînées la secondaient de leur mieux, et l’ouvrage commençait à donner. Mais l’administrateur en chef fut informé, je ne sais comment, que la femme d’un de ses employés travaillait de ses doigts pour vivre. Il me fit appeler chez lui, et me tança vertement; il prétendit que je déshonorais l’administration.
–Mais, monsieur, lui dis-je, j’ai des enfants!
–Pourquoi diable en faites-vous? me répondit-il d’une voix brusque. Un fonctionnaire ne doit pas avoir plus d’enfants qu’il n’en peut nourrir.
Il avait quelque raison, j’en conviens. Mais enfin ces pauvres petits n’avaient pas demandé à venir au monde; ce n’était pas leur faute si on les y avait mis. Nous ne pouvions cependant pas les tuer pour la plus grande gloire de l’administration, J’essayai timidement de présenter à mon chef quelques bonnes raisons. Il m’assura d’un ton péremptoire, et qui n’admettait pas de réplique, que c’était à prendre ou à laisser: si je ne voulais pas obéir, il fallait donner ma démission.
Que vouliez-vous que je fisse? Il y avait déjà quinze ans que j’étais entré dans l’administration. Ma démission me faisait perdre tous mes droits à une retraite pour laquelle j’avais déjà si longtemps travaillé. Quel emploi aurais-je trpuvé, en quittant la place que j’avais eu tant de peine à obtenir? Je n’étais plus dans l’âge où l’on court les aventures; je ne me sentais pas capable de grand’chose, je cédai; ma femme remercia ses pratiques en pleurant, et je restai dans mon ornière, par l’unique raison que j’y étais depuis quinze ans.
Je ne vous dirai pas toutes les bassesses où je me réduisis pour obtenir une augmentation de traitement. Cinquante taëls de plus, c’est bien peu de chose au fond; mais cela nous eût sauvé la vie. Je me dépouillai de toutes mes opinions et de tous mes goûts; j’étudiai les faibles de mes chefs, et je pris soin de les flatter. Ma femme se fit l’humble servante de leurs femmes, elle se chargea de leurs petites commissions; elle se mit volontairement à la chaîne, et cette chaîne devint tous les jours plus étroite, sans que ces dames parussent lui savoir le moindre gré des services qu’elle leur rendait. Ma femme était pour elles une domestique, moins les gages.
Je rougis encore en songeant à toutes ces humiliations. J’ai le cœur gros des couleuvres que nous avons si vainement avalées. Ah! si jamais je puis les leur cracher au visage! Je suis bon, monsieur, je ne voudrais pas faire de mal à une mouche. Mais si je tenais entre mes mains un de ces hommes sans cœur qui prennent si légèrement leur parti du mal qu’ils nous ont fait, j’aurais plaisir à le broyer dans un accès de rage: «Tiens! lui dirais-je, misérable, voilà pour tes airs importants et ce nez que tu haussais d’une façon si impitoyable en nous regardant. Tiens! voilà pour tes mépris, voilà pour tes rapports, voilà pour tes fureurs bêtes, tiens! tiens!
Le vieillard serrait les poings en parlant ainsi; le sang lui était monté aux joues et en colorait vivement les pommettes; ses yeux jetaient des flammes; il but un verre de thé, se détendit peu à peu, et reprit d’un ton plus calme:
–Nous finîmes par nous trouver un jour à bout de toutes ressources, au milieu d’enfants qui criaient la faim. Nous avions épuisé la bourse de nos parents et de nos amis; nous étions criblés de dettes. Nous nous regardions, ma femme et moi, d’un air farouche et désespéré. Je songeai à mon parrain qui avait été, quinze ans auparavant, la cause de tous mes malheurs, en me faisant donner ma place. Il s’était depuis ce temps-là cru quitte envers moi, et n’avait jamais répondu à mes lettres. Je fis une dernière tentative: je lui adressai une supplique, dont il me semblait qu’un cœur de roche eût dû être attendri. Quinze jours après, on me notifiait ma destitution.
Oui, monsieur, j’étais destitué; après quinze ans de services! sans aucun motif qui eût l’apparence du bon sens! M. le ministre prétendait que j’avais montré une insolence rare envers mes supérieurs. Moi, insolent! hélas! je n’avais été que trop poli, trop humble! ma femme était alors enceinte; vous sentez quel coup ce fut pour cette malheureuse. Elle se mit au lit avec une forte fièvre. Je fus pour moi obligé de la quitter, malade et sans argent. Je cours à Pékin solliciter une audience du ministre, me traîner à ses pieds, et réclamer de lui le pain de mes vieux jours et la vie de toute ma famille.
Le jeune Fo-hi se sentit ému de ce récit. Il ouvrit sa bourse:
–Tenez, dit-il au vieillard, cet argent est celui du gouvernement. Vous l’avez certes gagné mieux que moi, qui l’ai reçu je ne sais trop comment ni pourquoi. La moitié me suffira pour achever mon voyage. Acceptez le reste. Entre collègues.
Cette offre était faite d’un air de cordialité si franche que le vieillard n’eut pas le courage de refuser.
–Vous me sauvez la vie, s’écria-t-il. Puissiez-vous être aussi heureux que vous le méritez! Il y a donc encore de braves cœurs dans l’administration!
–O! j’en suis si peu! dit modestement le jeune Fo-hi.
Il serra la main de ce brave homme et remonta dans sa chaise de poste. Deux jours plus tard, il entrait dans Song-Kong-Chou, et c’est là que nous le retrouverons au chapitre suivant.