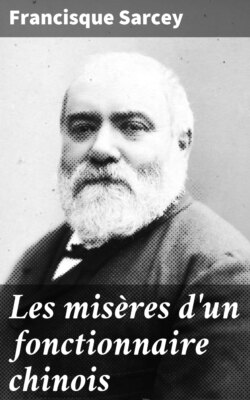Читать книгу Les misères d'un fonctionnaire chinois - Francisque Sarcey - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеV
OU LE ROI DE L’AVENIR EST EMBARRASSÉ
Table des matières
–Et que me conseillez-vous de faire maintenant? dit un jour le jeune Fo-hi au vieux Li-joulin. Toutes les carrières me sont ouvertes; laquelle dois-je choisir?
–La carrière de l’épicerie, répondit le philosophe.
–Moi, épicier? allons donc!
–C’est l’état de votre père, jeune homme.
–Mon père ne savait pas un mot de la langue sanscrite. A quoi me servirait-il d’avoir perdu dix ans à l’apprendre?
–A savoir jouir de votre fortune quand vous l’aurez gagnée.
Le roi de l’avenir pinça les lèvres avec un air de dédain, et jugea que le bonhomme radotait; au sortir de là, il rencontra un de ses anciens camarades, qui le mena dans sa chambre, une jolie chambre où pendaient plusieurs pipes à fumer l’opium. Cette chambre et ces pipes décidèrent de la vocation du jeune Fo-hi. Son camarade étudiait les lois.
–Je veux étudier les lois, dit-il à son père en rentrant.
Madame Fo-hi prit la parole, et dit que ce seraient encore trois ans, pour le moins, de grosses dépensés, sans compter qu’après ces trois années de nouvelles études, il n’était pas du tout sûr qu’on ne fût point obligé à des sacrifices plus grands encore. Elle ajouta que ses deux filles étaient en âge d’être mariées, et qu’il fallait songer à les établir. Les deux sœurs écoutaient à la porte; c’étaient de bonnes filles, quoiqu’elles fussent un peu trop curieuses, mais on n’est pas parfait, comme dit le sage Confucius; elles entrèrent au milieu de la conversation, elles déclarèrent toutes deux qu’elles n’étaient pas pressées, qu’elles sauraient bien attendre que leur frère fût arrivé à la gloire; qu’elles tenaient d’ailleurs à être épousées, non pour leur dot, mais pour elle-mêmes; c’est un préjugé des jeunes Chinoises. Il fut abondamment pleuré ce soir-là dans la famille de Fo-h; et après beaucoup d’embrassements et de larmes on y décida que le roi de l’avenir recevrait une pension de son père.
Le jeune Fo-hi fit les plus belles promesses du monde, et il faut dire à sa louange qu’il les tint, dans la mesure de ses forces. Ce n’était point un méchant garçon, ni même un paresseux, c’était un esprit médiocre, qui suivait tout doucement l’ornière qu’on lui avait tracée; il allait d’un mouvement machinal, sans regarder ni à droite ni gauche, où le poussait le vent du hasard. Il y a plus qu’on ne croit d’esprits ainsi faits, et, comme l’a fort bien dit un des plus grands philosophes de la Chine, l’homme n’est ni ange ni bête.
Le jeune Fo-hi ne se perdit donc point, durant ces trois années d’études libres. Il ne perdit que l’argent de son père. Il passa honorablement tous ses examens, conquit tous ses grades, et reçut enfin de belles lettres patentes, signées du ministre, contre-signées de l’empereur, par lesquelles il était autorisé à mettre un bouton de cristal à son bonnet. Ce jour paya monsieur Fo-hi père de tous ses sacrifices. Madame Fo-hi se laissa éblouir elle-même à l’éclat de ce bouton; elle oublia que durant trois années elle s’était levée à quatre heures du matin, et avait fait l’ouvrage de deux domestiques. On fit solennellement encadrer les lettres patentes, et on les exposa à l’endroit le plus apparent de la maison. La vue de ce cadre consola singulièrement les deux jeunes filles, qui ne laissaient pas que d’avoir eu quelques nuits inquiètes.
Le grand Tao prit leur ennui en pitié, et leur envoya des maris. Pé-ka-o demanda l’aînée en mariage; c’était un brave homme, à ligure joviale, robuste d’épaules, et dont le rire s’entendait au loin. Il était laboureur de son état et possédait une ferme, qu’il faisait valoir lui-même. On lui avoua qu’il n’y avait pas de dot à prétendre; il ne fit point la grimace, et répliqua sur-le-champ qu’une bonne femme de ménage était le premier des trésors dans une ferme, et que mademoiselle Fo-hi était assez riche de ses charmes et de ses vertus. Le compliment n’était peut-être ni très nouveau, ni bien galamment tourné, mais il partait du cœur; il était dit de cet air de franchise et de bonne humeur qui persuade; il suffisait d’ailleurs que ce fût un compliment, mademoiselle Fo-hi sourit et agréa celui qui le faisait. 1
La seconde sœur n’avait guère qu’un an de moins que son aînée; ce mariage prochain lui donna des idées. Elle alla trouver son père, elle lui déclara qu’elle aimait Chi-kan-go, et qu’elle épouserait Chi-kan-go.
––Eh quoi! s’écria monsieur Fo-hi au comble de l’étonnement, mon commis de magasin! Je ne puis pourtant pas lui jeter ma fille à la tête. Encore faudrait-il qu’il me la demandât.
–Il n’osera jamais. Vous êtes si imposant, mon père!
–Mais sais-tu s’il t’aime, seulement? Est-ce que le drôle aurait eu la hardiesse de te le dire?
–Lui, mon père! il n’ose pas même me regarder.
–Eh bien, alors!
La cadette sourit, comme avait fait sa coeur mais d’un air infiniment plus malicieux. Elle s’assit sur les genoux de son père, et lui passa les bras autour du cou.
–Tu l’associeras à ton commerce, nous resterons toujours près de toi, tu vieilliras au milieu de te enfants et, s’il plaît à Dieu, de tes petits-enfants, nous serons tous heureux, car nous serons tous ensemble.
–Allonss! fais-le venir, dit M. Fo-hi, qui voyait déjà ses petits-enfants lui grimper aux jambes en lui criant: Bon papa, bon papa!
Chi-kan-go se présenta devant son patron, tremblant comme une feuille d’érable, et rouge comme une pivoine. Il était fort timide de son naturel, mais ce n’en était pas moins un rude travailleur. M. Fo-hi lui trouvait du bon sens, et bon sens vaut mieux qu’esprit dans le commerce.
Les deux noces furent célébrées le même jour.
M. le docteur daigna les honorer de son bouton de cristal. Il était bien un peu humilié des beaux-frères que lui donnaient ses sœurs, mais, réflexion faite, il en avait pris son parti. Il s’était dit qu’un jour il les tirerait de ces métiers infimes, et les élèverait, par son crédit et son influence, à des positions plus dignes de lui. Il serait leur protecteur, et cette idée flatteuse le réconciliait avec la bassesse de leur condition présente. Il tourna même, en l’honneur des deux mariées, quatre ou cinq couplets de circonstance qui parurent admirables, et que nous supprimons. ici, parce qu’ils feraient peut-être moins de plaisir au lecteur qu’il n’en firent à M. Fo-hi. Madame Fo-hi pleura de tout son cœur quand on les chanta; elle pleura le soir encore quand il fallut livrer ses filles à leurs maris, elle se remit à pleurer le léndemain matin en s’éveillant. Les larmes ont cela de merveilleux qu’elles soulagent les bonheurs extrêmes comme les grands chagrins.
–Eh! mon garçon, dit M. Fo-hi père à son fils en lui frappant sur l’épaule, voilà tes deux sœurs établies. A ton tour, maintenant. Le gouvernement te doit une place, puisqu’il t’a donné de l’éducation. Nous allons la lui demander.
La lune de miel des deux jeunes ménages brilla doucement sur les longues et inutiles démarches de l’épicier solliciteur, et en adoucit l’amertume. Il se tourna d’abord vers le chef de la verge d’airain, qui exerce en Chine les mêmes fonctions que le ministre de la justice en France. Il le combla en quelques mois de pétitions et de placets. Il y en avait de toutes sortes, les uns polis et dignes, d’autres légèrement étonnés, d’autres suppliants et pathétiques. On s’adressait tantôt à la raison du ministre, et tantôt à son cœur. Souvent on rappelait les services que la famille des Fo-hi avait rendus de père en fils à la patrie en vendant du poivre, et leur dévouement qui ne s’était jamais démenti pour l’empereur et son auguste épouse. On vantait les mérites du candidat et sa bonne éducation, et l’argent qu’elle avait coûté. D’autres fois on s’apitoyait sur le sort d’un jeune homme dont les belles facultés ne trouvaient pas d’emploi et qui n’avait d’espoir qu’en la munificence du ministre.
Le ministre ne répondait pas à ces pétitions, qui eussent attendri des tigres. Il avait d’autres affaires sans doute. L’épicier ne se décourageait point. Parmi ses pratiques, qu’il appelait des clients, il comptait des personnages assez haut placés, il les fatigua de visites; quelques-uns apostillèrent ces placets, qui n’en furent pas mieux reçus. D’autres lui promirent de faire des démarches, et le signalèrent à leurs domestiques pour qu’on lui fermât la porte s’il s’avisait de revenir. Le pauvre homme, qui avait jusqu’alors vécu libre, gras et rond, dont le nez fleurissait de santé et de joie, devenait maigre et jaune. Ce nez brillant, ce nez épanoui s’allongeait tristement et penchait vers la tombe. Il négligeait sa boutique; il avait des accès de mauvaise humeur contre sa femme, contre son fils, contre tout le monde et surtout contre les ministres, dont il parlait avec une inquiétante liberté d’appréciation.
–Je ne sais en vérité pourquoi nous les payons si cher, disait-il au vieux Li-joulin dans un jour d’épanchement. Ils ne font point la besogne du pays, et mon fils est sur le pavé. Ce garçon-là m’a coûté les yeux de la tête, il me mange encore de l’argent gros comme lui; il est recommandé par tout le monde, j’ai mis en mouvement toutes les personnes que je connaissais, et quelques-unes même que je ne connaissais pas. Un mandarin de première classe, qui s’intéresse à lui parce qu’il a été au collège avec son neveu, a bien voulu parler pour lui; c’est comme s’il avait chanté. Le ministre lui a fait de belles promesses, mais tout cela est de l’eau bénite de cour: pas plus de nomination que sur ma main. Si je pouvais arriver jusqu’à l’empereur, je lui en conterais long.
Le vieux lettré aurait eu beau jeu à répondre: Je vous l’avais bien dit; mais c’était un philosophe indulgent; il savait que cette phrase n’a jamais guéri de rien.
–Et quelle place voudriez-vous pour votre fils?
–N’importe laquelle et n’importe où, s’écria M. Fo-hi. Une fois le pied à l’étrier, mon fils arrivera, j’en suis sûr.
–Eh bien! je vais demander pour vous et pour lui la protection de ma vieille femme de ménage.
L’épicier ouvrit de grands yeux et crut qu’on se moquait. Mais le vieux lettré parlait fort sérieusement. La femme de ménage fut mandée, et on– lui conta l’affaire.
–J’essayerai, dit-elle modestement.
Elle avait pour amie intime une vieille balayeuse dont le fils, soldat aux gardes de Sa Majesté, était l’amant d’une cousine de la femme de chambre qui coiffait tous les matins l’illustre épouse d’un ministre. Huit jours après, le jeune Fo-hi recevait une grande lettre, revêtue du sceau impérial. Il la décacheta en tremblant.
–J’ai une place! s’écria-t-il après avoir lu.
–Il a une place! répéta le père.
–Il a une place! il a une place! répéta toute la maison.
Et les voisins, et les voisines s’en mêlèrent, et ce ne fut bientôt qu’un cri par la boutique et jusque dans la rue:
–Il a une place! il a une place!