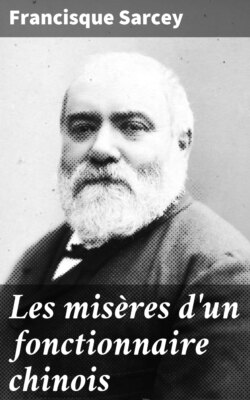Читать книгу Les misères d'un fonctionnaire chinois - Francisque Sarcey - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеXII
A QUOI LE JEUNE FO-HI DUT DE NE POINT PERDRE
LE POSTE OU IL AVAIT ÉTÉ MIS PAR ERREUR
Table des matières
Cependant le vieillard râpé était arrivé à Pékin. Il était allé, quatorze jours de suite, tous les matins, dans l’antichambre de M. le ministre, et n’y avait gagné que d’être connu des garçons de bureau, qui l’éconduisaient, tantôt avec des paroles brutales, et quelquefois-avec un air de commisération plus cruel encore que toutes les injures.
Le malheureux finit par perdre la tête. Il crut qu’il n’avait plus d’autre recours que la justice de l’empereur. Il se posta sur son passage, armé d’une espèce de grande pancarte, où il avait écrit en lettres gigantesques: «SIRE, JUSTICE ET PITIÉ.» Il la déploya, en criant de toutes ses forces, au moment où l’empereur passait dans la rue. Une des personnes du cortège fit signe à deux ou trois estafiers, qui mirent la main sur le vieillard et le conduisirent chez un de ces officiers qui sont chargés de maintenir dans la ville une bonne police, et qu’on appelle pour cette raison des officiers de paix. Il y conta son histoire avec beaucoup d’exaltation; l’officier parut l’écouter et le plaindre, lui dit qu’on allait le mener chez l’empereur, et le remit aux mains de gens qu’il suivit sans défiance. Une heure après, il était enfermé dans une maison très grillée et toute peuplée de visages hagards.
Il fut pris d’un violent accès de fureur, secoua les grilles et les mordit, hurlant de rage. Deux hommes vigoureux lui passèrent une camisole qui lui rendait impossible tout mouvement des bras et le portèrent sous une espèce de robinet d’où ils firent tomber sur sa tête un torrent d’eau glacée. Cette douche calma le vieillard, il regarda d’un air hébété tout ce qui l’entourait, murmura quelques mots inintelligibles, et se laissa jeter sans résistance sur un lit où il s’endormit d’un profond somme.
Quelques mois après, la fantaisie prit à une belle princesse, qui était parente au trente-cinquième degré d’un oncle de l’empereur, de visiter un établissement de fous. Elle vint accompagnée d’un ministre qui lui donnait le bras d’une façon tout à fait galante, et fut reçue par le directeur avec tous les honneurs dus à son titre et à son rang. Elle se promena dans les cours et interrogea quelques-uns des malheureux qui se rencontrèrent sur son chemin. La physionomie du vieillard râpé l’intéressa; elle le fit causer; il conta ses aventures avec une telle précision de détails que la princesse en parut frappée.
–Et vous croyez que cet homme est fou? dit-elle en regardant le médecin en chef de la maison.
Le docteur s’inclina, et répondit avec son sourire le plus gracieux:
–J’en suis sûr, madame, et je ne sais même s’il guérira jamais. Les fous qui parlent raisonnablement sont presque toujours incurables.
–Je serais bien curieuse de m’assurer si l’histoire qu’il nous a contée est vraie.
–Rien n’est plus facile, madame, dit à son tour le ministre.
On envoya tout aussitôt consulter les archives, et l’on reconnut avec stupéfaction l’erreur dont le malheureux vieillard avait été victime. La belle princesse daigna beaucoup rire de cette méprise. Elle conta le soir même cette anecdote aux familiers de son salon qui la trouvèrent extraordinairement plaisante. Elle demanda au docteur s’il était impossible de tirer ce pauvre homme de la maison où il était enfermé: le docteur déclara qu’il ne pouvait lâcher un malade sans l’avoir bien et dûment guéri. La princesse le lui recommanda chaudement; elle parla d’envoyer à la famille, comme indemnité, un secours de cent taëls et n’y songea plus le lendemain.
Le ministre était rentré dans son hôtel, furieux des plaisanteries qu’il avait essuyées. Il manda l’expéditionnaire qui avait commis l’erreur et le fit empaler sous ses yeux pour lui apprendre à soigner ses écritures. Il écrivit sur-le-champ à Song-Kong-Chou, pour qu’on eût à destituer un certain drôle nommé Fo-hi, qui avait traîtreusement usurpé la place d’un autre. C’en était fait pour toujours de notre héros si ses chefs ne s’étaient trouvés, par un singulier enchaînement de circonstances, dans la nécessité de le défendre même contre M. le Ministre.
La route où le jeune Fo-hi exerçait faisait, à un certain endroit, un coude qui n’était point agréable à l’œil. Elle tournait autour d’un jardin qu’elle aurait dû traverser pour aller en ligne droite. Ce jardin appartenait à un bourgeois aisé qui le cultivait de ses propres mains; il était célèbre à dix lieues à la ronde par la beauté des fleurs qu’on y pouvait admirer, et qui étaient presque toutes des fleurs rares. Le propriétaire était très fier de son jardin, qu’il n’eût pas donné pour tout l’or du monde. Il ne l’avait clos que d’une haie vive, afin de n’en point dérober la vue aux passants. Son grand plaisir était de se mettre, le matin, à sa fenêtre, de regarder ses fleurs étincelantes de rosée, et d’en respirer les vigoureux parfums.
Il fut bien étonné, un jour qu’il y revint après quelques semaines d’absence. Il trouva un large pan de la haie arraché et la route qui se préparait à passer tout au travers de l’ouverture. Des tas de pierres s’élevaient au milieu de ses plates-bandes, et des ouvriers bouleversaient le terrain à grands coups de pioche. Il pensa tomber à la renverse en voyant ce dégât. Il apostropha violemment les ouvriers, qui le renvoyèrent à monsieur le contrôleur.
Il faut avouer que le jeune Fo-hi avait donné ses ordres un peu légèrement. Mais je prie mes lecteurs de l’excuser sur ses intentions qui étaient bonnes. Ce coude lui blessait la vue. Il s’était dit que ce serait un grand avantage pour le public et un glorieux triomphe pour la symétrie, si l’on rectifiait la route; qu’au fond, il n’y avait rien de si facile. Il suffisait de couper en deux ce malencontreux jardin, qui rompait d’une si déplaisante façon l’aimable uniformité de la ligne droite. Ce n’était pas sa faute si le propriétaire était un esprit mal fait, qui préférait ses saletés de fleurs au bien général. Il fallait n’en tenir compte et passer outre. Sur ce beau raisonnement, le jeune Fo-hi, parlant au nom de l’administration qu’il représentait, avait commandé à ses hommes de percer à travers la haie et de marcher droit devant eux.
Le propriétaire s’en alla, tout blême de rage, au bureau du contrôleur. Il lui fut répondu négligemment qu’il fallait s’adresser à monsieur l’administrateur en chef, qui seul avait qualité pour lui donner des explications. Il courut donc chez l’administrateur, et, sur-le-champ, il lui exposa du ton le plus animé ses sujets de plainte.
L’administrateur l’écouta poliment et lui dit qu’il se ferait adresser un rapport sur cette affaire.
–Un rapport! s’écria l’autre exaspéré! eh! qu’avez-vous besoin d’un rapport? Vos ouvriers sont dans mon jardin, ce jardin est à moi, cela est-il clair? Je ne veux point de tout votre grimoire! Qu’on me rende ce qu’on m’a volé, oui, ce qu’on m’a volé! Votre administration est une caverne de voleurs!
–Monsieur, dit l’administrateur d’une voix majestueuse, je consens à oublier les paroles qui vous sont échappées dans un mouvement de colère et que vous regrettez déjà sans doute. Vous m’avez insulté dans l’exercice de mes fonctions, et le cas serait grave, si je ne savais compatir et pardonner aux faiblesses humaines. Apprenez, monsieur, que l’administration ne se trompe jamais en Chine; si elle a pris votre jardin, c’est sans aucun doute qu’elle en avait le droit, que dis-je? elle avait le devoir de le prendre!
–Nous verrons bien! hurla le propriétaire. Je m’en vais de ce pas chez un huissier; nous avons des juges à Pékin.
La route était achevée depuis deux mois, quand le tribunal, saisi de la plainte, rendit son jugement. Il déclarait que c’était là une affaire administrative et qui, par conséquent, ne le regardait pas; qu’il fallait s’adresser à l’administration elle-même pour qu’elle décidât si elle avait raison ou tort; qu’il était impossible de trouver un juge qui connût mieux l’affaire, puisque c’était la sienne, et qu’il n’y avait rien de tel pour voir clair dans un procès que d’y être partie soi-même.
Le propriétaire n’était pas de cet avis. Il en appela de ce jugement au conseil de l’empire, demandant avec instance à être jugé par d’autres que par ses voleurs. C’est justement à cette époque qu’arriva la lettre où le ministre ordonnait qu’on destituât le jeune Fo-hi. L’administrateur en chef répondit sur-le-champ à monsieur le ministre pour le prier de revenir sur son arrêt. Il exposait, et avec un grand sens, que cette destitution ferait le plus mauvais effet sur le public; qu’il l’attribuerait à une tout autre cause; que l’administration devait soutenir jusqu’au bout le jeune Fo-hi qui s’était mis en avant pour elle, et que l’abandonner en ce moment, c’était s’abandonner elle-même.
Monsieur le ministre entra aisément dans ces raisons qui étaient excellentes, et voilà comment le jeune Fo-hi fut conservé pour avoir fait une sottise en un poste d’où il avait failli être chassé pour la sottise d’un autre.,