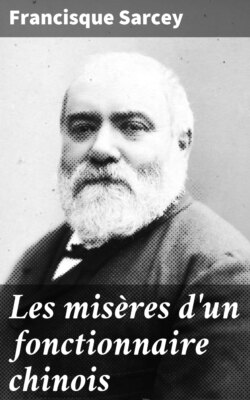Читать книгу Les misères d'un fonctionnaire chinois - Francisque Sarcey - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеXIV
LES SERMENTS
Table des matières
L’année7964est tristement célèbre dans les allnales de la Chine. Ce grand empire qui avait joui durant tant de siècles d’une prospérité sans troubles, connut alors pour la première fois les révolutions et les guerres civiles. L’empereur Hu-o-li XXIV mourut, laissant le trône à son fils Hu-o-li XXV, un tout jeune homme, âgé de dix-sept ans, dont il confia la tutelle à Fi-ho, le plus intime de ses conseillers. Ce Fi-ho était remarquable par sa bonne mine et son grand esprit; mais il était dévoré d’ambition. Il avait épousé une nièce de l’empereur défunt et nourrissait un secret désir de le remplacer un jour.
L’avènement du jeune monarque répandit une joie universelle dans toute la Chine. Les règnes qui commencent ont le charme des belles aurores qui promettent des jours sans nuages. Les chefs d’administration convoquèrent par tout l’empire les employés qui étaient sous leurs ordres afin qu’ils eussent à renouveler au nouveau souverain le serment d’obéissance et de fidélité qu’ils avaient jadis prêté à son père.
–De grand cœur et des deux mains, dit le jeune Fo-hi. L’empereur est le premier magistrat de mon pays, choisi par Dieu, reconnu par la nation; je le respecte et l’aime, comme doit faire tout bon Chinois; mon serment ne m’engage à rien que je ne sois prêt à tenir. Mais, je ne sais en vérité pourquoi on me le demande plutôt qu’à cet ouvrier qui passe dans la rue.
–Comment!! lui répondit-on; lui répondit-on; mais, vous êtes fonctionnaire. Vous devez une reconnaissance toute spéciale à l’empereur, car c’est lui qui vous paye et vous nourrit.
–Point du tout! répliqua Fo-hi. Je donne mon temps et ma peine à la nation tout entière, qui .m’en paye par les mains du souverain. Cela est bien différent. Je ne suis pas plus obligé à l’empereur pour l’argent qu’il me donne que cet ouvrier ne l’est à l’intendant qui lui distribue son salaire à la fin de la semaine. En fait de serment, je n’en sais qu’un au monde qu’on soit en droit de me demander plus particulièrement: c’est celui de faire en conscience la besogne qui m’est imposée. Il est clair qu’on ne peut pas exiger d’un marchand de soies qu’il jure d’entretenir les routes en bon état. Mais nous devons tous la même fidélité à l’empereur, comme nous devons tous la même obéissance à la loi; je suis tout disposé à la rendre, et je m’étonne qu’on croie nécessaire de m’enchaîner par un serment dont les autres citoyens sont dispensés.
Ces réflexions étaient peut-être assez justes. Mais le jeune Fo-hi eut le tort de les faire tout haut en présence de quelques collègues, ses amis intimes. Aussi, quand ce fut à son tour de jurer, M. l’administrateur en chef le regarda de travers.
–Prenez garde! monsieur, lui dit-il sévèrement: vous raisonnez beaucoup pour être jamais un bon fonctionnaire! Vous n’avez pas pour Sa Majesté l’empereur le respect.
–Eh quoi! s’écria le jeune Fo-hi avec force, je n’ai pas de respect pour l’empereurr! moi, qui lui suis dévoué corps et âme! Je le considère comme l’homme qui représente ma patrie aux yeux des peuples étrangers, et je suis prêt à mourir pour lui comme je donnerais ma vie pour elle.
–Non, monsieur, reprit l’administrateur d’un ton plus doux, vous ne devez pas seulement aimer l’empereur comme vous aimez votre patrie, parce qu’il la représente. Il faut avoir pour sa personne même la dévotion que le prêtre a pour son Dieu. Ce sont les sentiments que je professe, et je suis sûr qu’ils ne seront désavoués par aucun de ceux qui m’entourent.
Les quatre ou cinq cents fonctionnaires qui écoutaient ce discours .s’inclinèrent d’un même mouvement et sourirent tous à la fois. Ceux que le hasard avait placés près du jeune Fo-hi s’écartèrent tout doucement de lui, comme s’ils craignaient de gagner la peste. Les réponses se pressaient sur ses lèvres, mais il se rappela fort à propos un axiome que lui avait donné le vieux Li-joulin:
La raison du plus fort est toujours la meilleure.
Il retint son envie de parler, et signa, sans mot dire, la formule du serment qu’on lui avait présentée.
Le soir même, il était chez lui gravement occupé à fumer une pipe d’opium, quand le portier de M. l’administrateur lui apporta la circulaire suivante, où un grand nombre de ses collègues avaient déjà apposé leurs signatures:
«MES CHERS COLLABORATEURS,
» La Providence qui veille si particulièrement sur les destinées de la Chine, vient de donner un témoignage éclatant de sa bienveillance pour notre belle patrie. Elle a renversé du trône le ci-devant empereur Hu-o-li, vingt-cinquième du nom, dont le jeune âge et l’inexpérience conduisaient la Chine aux abîmes. Elle a choisi pour ce grand et mémorable ouvrage les mains puissantes de l’illustre Fi-ho. Notre amour et nos vœux l’avaient dès longtemps appelé au pouvoir suprême, où viennent de le placer d’une façon définitive les justes décrets du Très-Haut. Déjà le peuple de Pékin a manifesté sa joie par ces cris et ces illuminations où l’on sent battre le cœur d’une grande nation. Serons-nous les derniers mes chers collaborateurs, à acclamer un changement que nos secrets désirs provoquaient depuis bien des années, à nous rallier hautement aux magnifiques destinées que Dieu prépare à la Chine? Non, messieurs, le moment est venu de montrer notre dévouement à la cause publique et à l’empereur. Je vous attends demain, pour prêter à l’élu du peuple et de Dieu un serment solennel; je ne crains pas qu’un seul d’entre vous manque à cet impérieux devoir. S’il y avait parmi vous un homme capable d’une aussi infâme trahison, il est évident qu’il ne pourrait pas porter une minute de plus un uniforme et des insignes qui sont ceux de l’honneur et du dévouement.»
–Tout, s’écria le jeune Fo-hi dans un violent transport, tout, la destitution, la mort même, plutôt que cette lâcheté! Les misérables!
Le sang lui bouillait dans les veines; il marchait à grands pas dans sa chambre, les yeux enflammés d’indignation, les poings crispés, et sa préoccupation était si forte, qu’il apostrophait les meubles, comme s’ils eussent pu l’entendre et lui répondre.
Il sortit, car il étouffait dans son appartement; il avait besoin de grand air et d’espace. Il courut longtemps dans la campagne, jetant au vent des exclamations de fureur et des phrases sans suite:
–Non, criait-il, cela est impossible; n’est-ce donc rien qu’un serment? On se parjure, et l’on va souper! L’autre, hier; aujourd’hui, celui-là. Ce Fi-ho nous demande un serment! a-t-il donc respecté le sien? N’avait-il pas juré, lui aussi, fidélité à son souverain, au fils de son bienfaiteur? Quelle foi peut-il avoir à de vaines formules, lui qui a si indignement trahi ce qu’il y a de plus sacré au monde! Il ne veut que nous avilir. Il compte sur la lâcheté de nos cœurs. O! oui, nous sommes bien iâches! Mais moi, du moins, je lui prouverai qu’il reste encore des âmes que rien n’abat. Je refuserai ce serment; d’autres m’imiteront; l’exemple gagnera de proche en proche; le tyran pâlira sur son trône.
L’imagination du jeune homme, lancée au grand galop sur cette route, ne s’arrêta plus. Il se vit emprisonné, torturé, mais toujours ferme. Il était conduit au dernier supplice; il se récita le discours qu’il improviserait dans cette circonstance. Ce discours lui arracha des larmes. Le peuple, transporté de fureur, se ruait sur les soldats, le délivrait de leurs mains, et le ramenait en triomphe.
Le jeune Fo-hi revint tout échauffé de cette promenade, et l’âme violemment tendue aux sacrifices héroïques. Il alla chez tous ses collègues, l’un après l’autre, les exciter au refus, faire des prosélytes, et organiser la résistance. Il ne trouva partout que des âmes hypocrites ou des cœurs faibles. Le premier à qui il s’adressa l’écouta d’un air défiant; il le prenait pour un agent provocateur.
–Mon cher collègue, lui dit-il d’un ton froid et convaincu, j’honore et j’aime le grand prince qui vient de sauver la Chine; je n’ai donc aucune répugnance à lui prêter le serment qu’il exige. J’attends même avec impatience le moment de donner un témoignage public de mon dévouement au nouvel ordre de choses.
Chez un autre, ce fut la femme qui arrêta Fo-hi au premier mot de son discours:
–Je vous en prie, lui dit-elle, ne donnez pas à mon mari de mauvais conseils; le pauvre homme ne serait que trop disposé à les suivre.
–Eh quoi! s’écria le jeune Fo-hi avec douleur, c’est vous qui parlez ainsi, vous qui devriez relever son courage, s’il était abattu! Qu’avez-vous fait de cette générosité de sentiments qui est si naturelle au cœur des femmes? C’est chez elles que l’homme puise sa force et sa fierté; faut-il donc qu’il n’y trouve plus que les conseils d’une triste prudence?
–* Hélas! monsieur, répondit la femme, vous en parlez bien à votre aise!
Elle avait sur les genoux un petit garçon qu’elle déshabillait; deux petites filles tenaient sa jupe, regardant cette scène, sans la comprendre, avec leurs grands yeux étonnés:
–Pauvres chérubins! dit-elle à demi-voix en passant sa main dans leurs cheveux.–Quand vous serez père, monsieur, vous entendrez plus aisément les conseils que donnent ces chères petites têtes blondes. S’il y a du mal à prêter ce serment, qu’il retombe sur ceux qui l’exigent!
Le jeune Fo-hi sortit de là navré. Il ne réussit pas mieux près de ses autres collègues; quelques-uns partageaient son indignation, mais tous avaient peur.
–La belle avance! répondirent-ils; quand nous serons sur le pavé, le gouvernement en sera-t-il moins fort? Notre résistance serait inutile aux autres; elle est fort dangereuse pour nous.
–Mais si nous nous entendions tous! s’écriait douloureusement le jeune Fo-hi.
–A! cela est différent. Si tout le monde refuse, je refuse.
Mais personne ne voulait attacher le grelot. Il y avait, parmi les collègues du jeune Fo-hi, un vieux bonhomme, très vert encore, et qui avait toujours témoigné d’une grande liberté de sentiments.
.–Vous, au moins, lui dit notre héros, vous ne m’abandonnerez point.
–J’aime à voir votre colère, mon cher enfant. Elle me prouve que nous ne sommes pas encore si pourris que je le croyais par le fonctionnarisme; et cela ne me déplaît pas. Je ne sais pas ce que j’aurais fait il y a trente ans, j’avais la tête bien près du bonnet, et il est fort probable que j’eusse agi comme vous voulez agir vous-même. J’aurais eu tort.
–Vous auriez eu tort?
–Eh! sans doute, mon cher enfant, il eût peut-être mieux valu choisir une profession libre que de se mettre sous la coupe du gouvernement; mais quand une fois on y est, il faut subir les conséquences d’une position qu’on s’est faite. Le pouvoir. après tout, ne vous demande rien que de très naturel. Il ne veut pas que les agents qu’il emploie travaillent à le miner et à le perdre. Il exige que vous promettiez par serment de ne lui point être hostile; il a raison, et il n’y a pour vous aucun déshonneur à le jurer. Avez-vous de mauvais desseins contre le gouvernement? Aucun, sans doute. Vous ne l’aimez pas; vous en pensez beaucoup de mal; mais vous n’avez pas l’intention de le renverser; vous ne pouvez rien, ni pour, ni contre lui. Pourquoi refuser un serment que vous tiendrez nécessairement sans l’avoir fait?
–Et pourquoi, s’écria le jeune Fo-hi, si ce serment est une chose aussi indifférente que vous dites, pourquoi la seule pensée m’en a-t-elle fait bondir le cœur?
–C’est que vous avez vingt ans. J’en ai bien près de soixante, et je juge moins par sentiment que par raison; je prêterai sans enthousiasme, mais sans fureur, le serment qu’on exige; ce n’est qu’une vaine formalité à laquelle je me soumets. Je n’ai pas envie de perdre tous mes droits à une retraite que j’ai laborieusement conquise par quarante ans de service. Le gouvernement, qui a mon argent en poche, me le garderait si je ne prononçais pas un certain mot, qui n’est pour moi que de simple cérémonial. Je le prononce sans marchander, le pistolet sur la gorge. J’aime mieux cela que d’en être réduit un jour à mourir de faim, en criant: «Au voleur!» Encore ne pourrais-je pas le crier bien haut. Allez, mon cher enfant, suivez mon exemple, et buvez frais. comme dit Panurge.