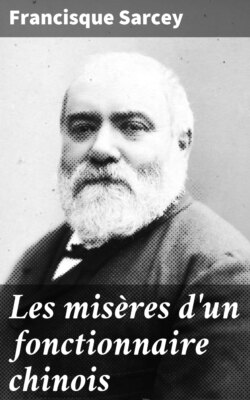Читать книгу Les misères d'un fonctionnaire chinois - Francisque Sarcey - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеXVI
VÉHÉMENTE APOSTROPHE DU JEUNE FO-HI
Table des matières
Huit jours après il reçut une lettre qu’il reconnut, à la forme et au cachet, pour être une lettre officielle. Il l’ouvrit avec un certain tremblement, et lut ce qui suit:
«MONSIEUR,
» M. le ministre me charge de vous apprendre que vous êtes destitué de l’emploi que vous occupez actuellement. Vous irez à Fei-out-chi, comme jaugeur de pierres de troisième classe, ainsi que vous pourrez voir par la nomination ci-annexée. Je souhaite, monsieur, que cette punition soit pour vous une leçon dont vous profitiez. Vous n’avez point cet esprit d’ordre qui est le premier mérite d’un fonctionnaire. Vous portez dans tous vos actes, et jusque dans vos moindres paroles, un dénigrement systématique qui va jusqu’à la rébellion. Je vous avertis, au nom même de M. le ministre, que si vous ne changez point de conduite, l’administration sera forcée d’en venir avec vous aux dernières mesures de rigueur, et de vous rejeter pour toujours de son sein.
La lettre était signée de M. l’administrateur en chef. Le jeune Fo-hi la froissa, se mit à son bureau et écrivit tout d’un trait:
«MONSIEUR L’ADMINISTRATEUR EN CHEF,
» J’épargnerai à l’administration la peine qu’elle aurait infailliblement à prendre dans quelques mois. Je vous envoie ma démission. Vous l’avez très bien dit: j’ai encore un peu de cœur, et ne suis pas fait pour être fonctionnaire. Je ne l’ai été que trop longtemps. Mieux vaut mourir de faim que de manger un pain si dur et acheté si cher.»
Il signa et, sans se donner le temps de la réflexion, expédia la lettre. Le soir même, il fut mandé chez M. l’administrateur. Ce personnage important le reçut aveo beaucoup d’affabilité.
–Mon jeune ami, lui dit-il, vous m’avez écrit dans un premier mouvement de colère une lettre peu convenable; j’aurais pu l’envoyer tout de suite à M. le ministre. J’ai mieux aimé user d’indulgence: le fond chez vous n’est pas mauvais. Voilà votre lettre, je vous la rends; je regarde votre démission comme non avenue.
Le jeune Fo-hi fit un geste comme pour refuser.
–Ecoutez-moi, mon jeune ami, reprit l’administrateur d’un ton de protection bienveillante. Il sera toujours temps de donner votre démission. Rapportez-la moi dans deux jours, si vous persistez dans votre idée. J’espère que d’ici là vous aurez mieux réfléchi. La vie du fonctionnaire a ses ennuis, je le sais; vous les sentez un peu trop vivement à cette heure. Vous en oubliez les beaux côtés, que vous verrez mieux quand vous aurez plus de sang-froid. L’avantage d’appartenir à un corps puissant, qui ne vous abandonne jamais, le respect qui entoure votre uniforme partout où vous allez, la douceur d’une existence assurée contre tous les hasards par des appointements modestes, mais régulièrement payés, la certitude d’une retraite qui mettra vos derniers jours à l’abri du besoin, l’espoir même d’un avancement, qu’on obtient toujours quand on sait le mériter, en voilà plus qu’il n’en faut pour emporter la balance. Songez à tout cela, mon jeune ami, avant de prendre une résolution que n’approuverait peut-être pas votre famille, et dont vous vous repentiriez plus tard. Vous savez fort bien ce que vous perdez en nous quittant; savez-vous en revanche ce que vous trouverez hors de chez nous? Pesez mùrement toutes ces considérations, et revenez me voir dans vingt-quatre heures. En attendant, je déchire votre lettre, puisque vous ne voulez pas la reprendre.
–Ma résolution est irrévocable, dit le jeune Fo-hi.
–C’est bon, c’est bon, reprit en souriant l’administrateur. Nous verrons cel!»
Et il le congédia d’un geste fort amical.
Le jeune Fo-Hi passait tous les jours, en allant à son bureau, devant une boutique d’épiceries qui lui rappelait celle de son père. Il y avait dans cette boutique un gros garçon, à mine réjouie, qui avait pris l’habitude de le saluer chaque matin. Le jeune Fo-hi lui rendait sa politesse d’un petit signe de tête. Il condescendait même quelquefois à lui adresser la parole, quand il le trouvait sur le pas de la porte, et qu’il était lui-même de bonne humeur.
–Un beau temps, lui disait-il.
–Un beau temps, oui, monsieur Fo-hi, répondait le garçon; mais le fond de l’air est vif.
Ce garçon épicier était très fier de cette distinction. Il respectait Fo-hi, et l’enviait en même temps. Le fameux, bouton de corail lui faisait mal aux yeux en les éblouissant. On sentait dans la façon dont il ôtait son bonnet de loutre une grande déférence mêlée d’un certain dépit. Il n’y avait pas à se méprendre à la signification de ce salut; il voulait dire: «L’heureux hommee! qui touche sa paye tous les trente du mois, rubis sur l’ongle, et qui ne roule pas des cornets de poivre! Il ira ce soir au bal chez M. le gouverneur, et peut-être sera-t-il admis à l’honneur de lui taper sur le ventre, comme cela se pratique dans le grand monde. Il a sa place marquée dans les cérémonies publiques et à la procession de Jagarnatha. Il est quelque chose, et je lui ôte mon bonnet de loutre avant qu’il m’ait ôté son bonnet de soie. L’heureux homme!»
Ce salut faisait ordinairement plaisir au jeune Fo-hi. Mais dans la situation d’esprit où il se trouvait en revenant de chez son administrateur, il ne put voir cet imbécile lui ôter son bonnet sans être pris d’un grand serrement de cœur. Il alla à lui et, d’un ton fort animé, comme s’il parlait à lui-même:
–Tu me salues! lui dit-il; c’est toi qui me salues! quelle dérision! garde ton bonnet, mon ami; c’est à moi d’ôter le mien et de te saluer jusqu’à terre.
L’épicier écarquillait ses gros yeux tout ronds, et demeurait, son bonnet en main, la bouche ouverte, avec une mine ahurie.
–C’est à moi de te saluer, reprit le jeune Fo-hi avec force; car tu es libre et je ne le suis pas. Quand ta besogne est faite; tu ne dois plus rien à ton patron, qui te laisse dormir tranquille.. J’ai vingt patrons, moi, vingt supérieurs, qui sont payés par l’empereur pour me tracasser, qui veulent gagner leur argent, et qui font encore du zèle. Les gouvernements changent et ne te demandent rien; tu vends ton riz et ton poivre, sans te soucier d’eux. Ils ont droit à mon dévouement, puisqu’ils me nourrissent; ils exigent que je le leur promette, et j’ai fait trois serments en un même jour.
Ne me salue pas, mon ami; garde ton bonnet.. Car le travail que tu fais est utile, tu le sais, cela te soutient et te console. Tu crois au sucre que tu casses, et tu le casses de meilleur cœur. Mais moi, mon ami, je suis accablé chaque jour d’une besogne qui m’épuise et qui n’est d’aucune utilité pour personne. Je passe les plus beaux jours de ma vie, ces jours qui s’enfuient pour ne plus revenir, à compter des cailloux sur le bord des routes, à noircir des rames de papier pour les rats qui les mangent. Je ne suis qu’une machine qui tourne à vide.
Tu ne sais rien, n’est-ce pas? c’est à peine si l’on t’a appris à lire et à écrire. Console-toi, ignorance n’est pas bêtise. Chaque jour m’enfonce au-dessous du plus ignorant. Je tourne au crétin, je le sens et j’en pleure de rage. Les petites passions m’envahissent; je prends goût aux tracasseries mesquines; je suis perdu. Je n’ose descendre au fond de ma conscience; j’y trouverais des trésors de haine. Contre qui? Eh! mon Dieu! lé sais-je! contre personne et contre tout le monde; contre ces administrateurs qui m’accablent de leur morgue bête, et me transmettent avec une si visible satisfaction les coups de pied qu’ils reçoivent; contre une besogne que je fais sans goût, parce que je la fais sans intention; contre toi-même, oui, contre toi, triple niais, qui as la sottise de me saluer tous les matins.
Ne me salue pas, mon ami; garde ton bonnet. Tu m’envies d’aller au bal chez le gouverneur. Mais sais-tu que je ne suis pas libre d’y manquer, si la fantaisie m’en prend? Sais-tu bien que si je n’étais pas allé subir le petit signe protecteur de madame la gouverneuse, de charitables âmes en prendraient bonne note, et que cette note serait mauvaise? J’ai ma place à la procession de Jagarnatha; mais ne vois-tu pas que j’y suis entre deux rangs de soldats, comme un malfaiteur que l’on mène en prison?
C’est à moi de te saluer, mon ami. Tu es né dans ce pays; tu y feras honorablement fortune; tu y mourras entouré de tous les tiens, pleuré de quelques-uns. Je m’en vais de ville en ville sans pouvoir fixer ma tente en aucun lieu. On m’envoie. sans crier gare, d’un bout de la Chine à l’autre, et je n’ai pas le premier sou pour faire le voyage. Je mourrai comme je vis, misérable et sans famille, à cent lieues du village où je suis né.
Plains-moi, mon ami; je suis plus à plaindre qu’à envier. Plains-nous, plutôt; car nous sommes tous, pauvres fonctionnaires, logés à la même enseigne, et ce n’est pas, par malheur, une enseigne d’épicier. Tu vois ce magistrat qui passe; c’est un conseiller. Ton patron, qui le salue jusqu’à terre, ne lui ferait pas crédit. Regarde ce bel officier; ses appointements d’une année reluisent sur ses épaules; il n’achètera jamais de château sur ses économies. Il ne paye que de mine, et ses fournisseurs en savent quelque chose. Le gouvernement émiette son budget devant les fonctionnaires pour contenter plus de monde. Il ne contente personne. A maigres appointements, maigre besogne et maigre reconnaissance. Ne demande jamais ta part du gâteau et remets ton bonnet sur ta tête.