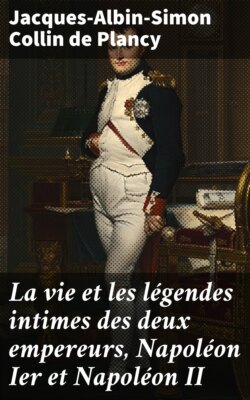Читать книгу La vie et les légendes intimes des deux empereurs, Napoléon Ier et Napoléon II - Jacques-Albin-Simon Collin De Plancy - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VII. — JOSÉPHINE.
ОглавлениеTable des matières
Une prédiction qui flatte a des chances heureuses, car elle encourage.
KOTZEBUE.
Dès que la Convention se sentit délivrée par l’habileté du jeune général, elle eut la hardiesse que donne la victoire sur l’insurrection. Elle ordonna le désarmement des masses, ce qui s’exécuta plus facilement qu’on ne l’espérait.
Peu de jours après cette mesure, le général Bonaparte reçut la visite d’un enfant de quatorze ans, dont la figure belle et digne le charma. C’était Eugène de Beauharnais, qui venait le prier de lui faire rendre l’épée de son père.
«Et quel est votre père, mon enfant? dit-il.
— Le général Beauharnais, que le comité de salut public a assassiné le 23 juillet 1794, cinq jours avant la mort du tyran.»
Il désignait ainsi Robespierre, mort à son tour sur l’échafaud, dont il avait fait si grand usage.
Eugène Beauharnais n’était pas tout à fait un étranger pour Bonaparte, car il avait remarqué sa mère dans les brillantes sociétés qui se réunissaient quelquefois chez Barras.
Voyant dans ce noble jeune homme un avenir, il lui fit présent d’un beau sabre, et quatre jours après il lui renvoya l’épée de son père.
L’enthousiasme et la vive affection pour le général Bonaparte naquirent de là et ne s’affaiblirent jamais dans le cœur d’Eugène. Sa mère, partageant ses joies, crut devoir aller remercier l’homme généreux qui pouvait être un protecteur pour son fils; et ce léger incident fit connaître un peu plus Joséphine à Bonaparte. Veuve d’un homme honorable, elle n’avait que deux enfants (Eugène et Hortense); sa fortune était fort ébréchée, mais elle était chrétienne fidèle, en même temps que charmante et bonne.
Joséphine Tascher de la Pagerie était née d’une famille noble a la Martinique, le 24 juin 1765. Elle avait été emprisonnée avec le vicomte de Beauharnais, son mari, mort, comme on l’a vu, sur l’échafaud. Elle devait l’y suivre; mais Tallien, dont la femme estimait grandement Joséphine, l’avait fait sortir de prison après la mort de Robespierre; et la Convention lui avait rendu les débris de ses biens, confisqués jusque-là.
On racontait que, dans les jeunes années de Joséphine, une négresse qui avait aussi ce qu’on appelle la seconde vue ou le don de prévoir lui avait prédit qu’elle arriverait à l’une des plus hautes positions, qu’elle porterait une couronne, qu’elle s’assoirait sur un trône.
Et ses amis de la Martinique rappelaient naïvement ces prophéties. On dit qu’elles firent aussi quelque impression sur le général Bonaparte, qui croyait, en sondant son cœur, avoir une mission, et qui ne se trompait pas. Il savait que les mêmes augures avaient annoncé à madame de Maintenon un avenir pareil.
Madame de Maintenon, veuve de Scarron à l’âge de vingt-cinq ans, se trouvait dans la plus grande détresse, lorsqu’un maçon nommé Barbé, qui, très-habile dans son art, passait aussi pour avoir en récompense de sa piété le don de prophétie, lui annonça que «après bien des peines un grand roi
» l’aimerait, qu’elle régnerait. Mais, ajoutait-il, quoique
» parvenue au comble de la faveur, vous n’aurez jamais un
» grand bien.»
Il entra ensuite dans de singuliers détails, qui l’étonnèrent et la frappèrent; et comme les personnes présentes riaient de ces présages, Barbé leur dit: «Vous feriez mieux de baiser le bas de sa robe .» En 1685, Louis XIV épousa la veuve de Scarron, devenue marquise de Maintenon.
Bonaparte rechercha donc la main de la veuve du vicomte de Beauharnais. Il fut accueilli. C’était en février 1796. Le Directoire, depuis six mois, avait remplacé la Convention. Bonaparte, le mariage étant décidé, fit avec Joséphine les visites et les emplettes d’usage; et tout se préparait, lorsque, dans une de ces courses, Joséphine pria son futur époux de la conduire chez son notaire, maître Raguideau, dont l’étude était auprès de la place Vendôme, dans la rue Saint-Honoré. Comme il traversait avec elle cette place, appelée alors place des Piques, il s’arrêta un moment devant les débris de la statue équestre de Louis XIV qui venait d’être abattue; il fit remarquer aux personnes qui l’accompagnaient que le plus convenable ornement d’une si noble place serait une colonne triomphale. Prévoyait-il alors qu’il l’élèverait lui-même?
En entrant dans l’étude du notaire, Joséphine se détacha du bras de Bonaparte et passa seule dans le cabinet du citoyen Raguideau, à qui elle fit part de son prochain mariage.
«Avec qui? lui demanda le tabellion.
— Avec le général Bonaparte.
— Quoil veuve d’un militaire, vous vous hasardez à en épouser un autre? N’êtes-vous pas lasse de la vie agitée? Et ce général Bonaparte, qui a si rudement balayé les sections aux marches de Saint-Roch, c’est, dit-on, un homme sans fortune.
— Il s’en fera une.
— Est-il donc un Moreau? un Pichegru? un Dumouriez? Croyez-vous que les grands généraux poussent si dru? J’aimerais mieux vous voir épouser un bon administrateur ou un riche propriétaire. Mais vous me direz que c’est une affaire de cœur. Je ne vous en fais pas mon compliment....»
Or la porte était entr’ouverte, et Bonaparte avait entendu la longue kyrielle du bon notaire, que nous avons dû résumer en peu de mots. Il n’en fut pas ému et n’en fit rien paraître. C’était le 4 ventôse (23 février 1796).
En sortant du cabinet du notaire, dont les paroles avaient glissé sur son cœur sans l’ébranler, Joséphine reprit le bras de son fiancé, et alors, comme pour répondre aux timidités du citoyen Raguideau en même temps qu’à la prédiction qui lui montrait un bel avenir, elle apprit que le Directoire venait de rappeler le général Schérer et de nommer à sa place le général Bonaparte commandant en chef de l’armée d’Italie. Il fallait donc hâter le mariage, qui eut lieu à Saint-Roch, le mardi 8 mars. L’épousée avait quatre ans de plus que l’époux. Mais leur acte de mariage, par une galanterie du jeune marié, leur donnait à tous deux l’âge égal de vingt-huit ans.
La lune de miel du jeune ménage ne fut pas longue. Trois jours après la solennité du mariage, il fallait partir. Le général était, comme l’État, sans argent. L’or avait disparu. Les assignats n’avaient plus cours, les bons du trésor étaient en plein discrédit, l’argent semblait avoir disparu. On a raconté bien des choses sur les difficultés que subit Bonaparte pour s’équiper. Le 5 mars, il avait commandé six paires de bottes a un artiste en chaussures nommé Jorstmann. C’était un Alsacien à la tête carrée, qui prit ses mesures, fit les bottes et les porta quatre jours après au général, dont le nom faisait alors grand bruit. Mais le jeune héros ne lui offrant en payement qu’un bon du trésor, il le refusa, déclarant qu’il ne livrait sa marchandise que contre argent comptant. Il remporta donc ses six paires de bottes; et deux jours après, le 11 mars, le général Bonaparte se mit en route pour sa première campagne d’Italie, qui devait avoir tant d’éclat.
Il emmenait avec lui Joséphine, dont il n’était le mari que depuis trois jours, et avec elle le jeune Eugène Beauharnais et sa sœur Hortense. De ce jour il avait fait Eugène son aide de camp. Il passa par Marseille, où il voulait visiter sa famille réfugiée là, et présenter son épouse à sa mère.
La mère et les sœurs de Napoléon avaient vu, le 18 juin 1793, leur maison brûlée par les ennemis de la France, ce qui les avait contraintes à quitter Ajaccio. Vingt-deux ans après, un autre 18 juin amènera les malheurs de Waterloo.
Le jeune marié ne put offrir à sa famille que bien peu de secours, et il se rendit où le devoir l’appelait.
Le 20 mars, signalé aussi par d’autres circonstances de sa vie, il prenait à Nice le commandement en chef de l’armée d’Italie. L’État n’avait donné à Bonaparte, pour la guerre si vaste qu’il allait entreprendre, que deux cents louis d’or. Il ne put distribuer à chacun des généraux qui allaient marcher sous ses ordres que quatre louis pour leur entrée en campagne. Néanmoins ils sourirent, car c’était depuis plus de trois ans la première fois qu’ils voyaient de la monnaie d’or .