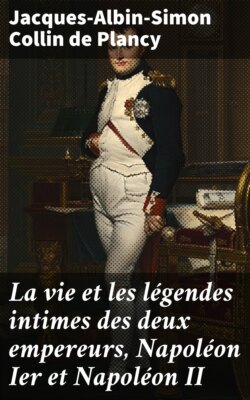Читать книгу La vie et les légendes intimes des deux empereurs, Napoléon Ier et Napoléon II - Jacques-Albin-Simon Collin De Plancy - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. — L’ENFANCE DE NAPOLÉON.
ОглавлениеTable des matières
J’entrai à Brienne, dit Napoléon: j’étais heureux.
Mémoires d’Antomarchi.
L’enfance de Napoléon fit tout d’abord présager quelque chose de grand. Il avait une tête forte et remarquable. Ses délassements étaient sérieux. Il ne se plaisait qu’aux études précises, la géographie et l’histoire. Il était pieux et tendre.
«J’ai toujours trouvé, disait-il dans son exil de Sainte-Hélène, j’ai toujours trouvé un charme infini à me rappeler la piété de mon enfance et ces bonnes prières que je faisais sur les genoux de notre vieil oncle (l’archidiacre Lucien). Quand il nous enseignait la religion, il nous disait: «Priez, mes enfants, et Dieu vous aidera.»
L’enfant du 15 août avait le cœur généreux. Un jour, une corbeille de raisins et de figues, envoyée par l’oncle archidiacre, fut dévorée en cachette par les enfants. On en soupçonna ou peut-être on en accusa Napoléon, qui nia le fait. En le voyant embarrassé de cette enquête, on le crut coupable. On l’engagea donc à confesser, pour obtenir son pardon. Mais il nia plus fermement. Alors il fut châtié, et condamné à ne manger pendant trois jours que du pain et du fromage. Il subit ces peines en silence.
Le quatrième jour, une amie d’Élisa, instruite de ces détails, vint déclarer que c’était elle qui, avec Élisa, avait dévasté la corbeille. On reconnut alors que Napoléon le savait et qu’il avait mieux aimé souffrir que dénoncer.
L’oncle Lucien fut frappé de ce caractère; et lorsqu’on parla de mettre les enfants aux éludes, ce qui devait les séparer, il demanda qu’on les lui amenât, car il était alité et sentait sa fin prochaine. Quand il les vit tous autour de lui, il prit la main de Joseph: «Tu es l’aîné de la famille, lui dit-il; mais n’oublie jamais que Napoléon en est le chef.»
C’était une prophétie, et nous avons vu son accomplissement.
Le père du jeune Napoléon l’emmena au collége d’Autun, où il entra le 1er janvier 1777. Mais Louis XVI avait établi en France douze écoles militaires. Charles-Bonaparte espérait obtenir du roi l’admission de son fils dans une de ces écoles. Il l’obtint assez vite; et l’enfant, qui se trouvait tristement dépaysé à Autun, avec des élèves dont il n’entendait pas la langue et qui ne comprenaient pas la sienne, avait subi là, pendant trois mois et demi, une espèce d’exil affligeant. Il fut donc comblé de joie lorsque son père vint lui annoncer qu’il était admis à l’école militaire de Brienne. Il y entra le 23 avril de cette même année 1777, et dès lors il respira.
On l’a représenté, dans cette école célèbre, comme un enfant bourru, taciturne, exigeant, ce qui est totalement faux. Le comte de Las Cases dit au contraire qu’au rebours de toutes les histoires apocryphes, «il était doux, tranquille, appliqué, d’une grande sensibilité ; qu’il avait profondément l’estime de ses maîtres, l’affection de ses condisciples, et qu’on jugeait qu’il y avait en lui l’étoffe d’un homme extraordinaire. «Le vénérable abbé Fournerot, dans son beau pensionnat de Troyes, sous le Consulat et sous l’Empire, citait fréquemment à ses nombreux élèves l’illustre écolier de Brienne, dont il avait suivi toutes les études; il le représentait comme un modèle de régularité, de discipline, d’intelligence, de douceur, de respect pour ses parents et pour ses maîtres, de constance dans ses affections.»
A l’appui de ce que nous citons, Napoléon disait à Sainte-Hélène: «Dans ma pensée et dans mon cœur, Brienne est
» toujours ma patrie. C’est là que j’ai reçu les premières
» impressions qui font un homme.»
Cependant on a prêté à cette jeune âme, si belle et si pure, des actes singuliers. Nous voulons parler de lettres, supposées écrites par lui à son père, pour lui demander de l’argent, afin de ne pas paraître plus pauvre que ses camarades. Or ses camarades recevaient comme lui six sous par semaine pour leurs menus plaisirs, et aucun des élèves ne pouvait recevoir autre chose de ses parents.
La meilleure réponse à ces stupidités, c’est la conduite du jeune Corse à l’école militaire de Brienne. Il était pieux, très-assidu au travail, ennemi des lectures frivoles, lisant dans ses moments de repos les livres d’histoire et de géographie, les vies des hommes illustres de l’antiquité, étudiant Polybe et Arrien, faisant peu de progrès dans les langues, excepté le français, qu’il apprit très-vite.
Dans ses récréations il s’occupait avec ses condisciples, en hiver surtout, à des opérations militaires. Il était constamment le premier et le plus fort de tous les élèves dans les mathématiques.
Il se prépara admirablement à sa première communion, qui eut lieu le 14 juin de l’année 1781. Il a dit plus tard que ce jour-là était le plus heureux de sa vie.
En sortant de la messe de ce grand jour, qui était cette année-là le jour de la Fête-Dieu, il écrivait, dans le transport de sa pieuse joie, une longue et touchante lettre à celui de ses oncles qui fut depuis le cardinal Fesch. Le bon cardinal en a cité quelques passages à M. Olivier Fulgence, à Rome:
«Mon cher oncle, écrivait-il, rien n’est comparable aux
» joies que j’éprouve; je voudrais consacrer à Dieu ma force
» tout entière et combattre pour lui, au moins de la parole.
» Les occupations de l’école ne me permettent pas de me
» livrer à la vie contemplative, mais au moins je sens avec un
» bonheur réel qu’à travers mes travaux et la carrière d’épée
» où je m’engage, je marche catholique et dans la foi de
» mon père....»
Il avait fait sa première communion par les soins du bon et grave M. Geoffroy, curé de Brienne. Il fut confirmé peu après, et on a fait à ce sujet un conte encore. Le grand vicaire du prélat qui conférait le sacrement lui demandant son nom, il répondit: «Napoléon.» Le grand vicaire répliqua: «Mais ce saint-là n’est pas dans le calendrier?»
Le conte dit que le jeune Bonaparte s’écria: «Je le crois bien, c’est un saint corse!» tandis qu’il répondit très-doucement: «Le calendrier ne peut pas contenir tous les saints que l’Église honore.»
Il avait douze ans.
Lorsqu’il était encore à Ajaccio, dans sa famille; où il croissait en âge et en intelligence, ses goûts militaires s’étaient révélés déjà. Il avait un petit canon de cuivre, qui faisait son bonheur et ses plus chers délassements. Dans les deux années qui suivirent sa première communion, quand il n’étudiait pas, pendant les récréations, il jouait au soldat. Il devint successivement, dans la petite troupe des élèves, caporal, sergent, sergent-major, commandant.
Il devait ces dignités à l’affection de ses camarades. Il n’était pas moins aimé et admiré de ses maîtres, qui voyaient en lui un bel avenir. En 1783, le duc d’Orléans, venu à Brienne pour présider, de la part du Roi, la distribution des prix, assista à un examen où il fut si étonné des connaissances et du jugement solide du jeune Corse, qu’il lui mit sur la tête une couronne de chêne. Napoléon la conservait encore lorsqu’il fut élevé au trône.
Pendant le rude hiver de 1783 à 1784, il organisa avec la neige, qui était abondante, des siéges et des combats. Sous ses ordres, les élèves qui l’aimaient firent avec la neige des remparts et des tranchées. On attaqua et on résista avec des projectiles que la neige fournissait encore. Ces jeux vaillants ont été représentés plusieurs fois dans nos gravures et nos albums.
En 1784, il fut proposé pour être admis à l’École militaire de Paris; il y entra le 17 octobre de cette même année, avec des certificats qui le patronnèrent et que nous devons reproduire.
M. de Kéralio, inspecteur des écoles militaires et savant académicien, qui a laissé des ouvrages utiles, rendit de lui ce témoignage:
«Napoléon de Buonaparte, né le 15 août 1769, taille de
» 4 pieds 10 pouces 11 lignes, a fait sa quatrième. De bonne
» constitution; santé excellente; caractère soumis, honnête,
» reconnaissant; conduite très-régulière; s’est toujours dis-
» tingué par son application aux mathématiques. Il sait très-
» passablement son histoire et sa géographie. Il est assez
» faible pour les exercices d’agrément; et pour le latin, il n’a
» fait que sa quatrième. Ce sera un excellent marin. Il mérite
» de passer à l’École militaire de Paris.»
Et comme on objectait a Kéralio la grande jeunesse de Napoléon, il répondit: «Je sais ce que je fais. Je vois la un germe qu’on ne saurait trop cultiver.»
Le savant Domairon (car ces écoles de religieux et de prêtres avaient toujours d’excellents maîtres), professant les belles-lettres à l’école militaire de Brienne, disait des amplifications du jeune Napoléon que c’était du granit chauffé au volcan.
Son professeur d’histoire, M. de l’Éguille, le caractérisait ainsi: «Corse de naissance, il ira loin, si les circonstances le favorisent .»
Il fut bien accueilli par ses nouveaux condisciples, et parmi eux il se fit des amis, qu’il n’oublia pas plus que ses maîtres et ses camarades de Brienne . Mais l’École militaire de Paris n’était pas aussi sérieusement organisée que celle de Brienne. Les élèves étaient presque tous des viveurs, comme on dit aujourd’hui, qui ne recherchaient que le luxe, les dissipations et les jeux. Quoiqu’il n’eût que quinze ans, le jeune Bonaparte eut la hardiesse d’adresser au directeur de l’École un mémoire où il lui représentait que si on voulait faire de bons officiers, il fallait substituer aux vains délassements la discipline, le travail, la sobriété et l’ordre. Il posait là des règles qu’il devait établir plus tard dans les écoles militaires de Saint-Germain, de Fontainebleau, de Saint-Cyr et de la Flèche.
Il ne resta que dix mois à l’École militaire de Paris. A la fin d’août 1785, ayant subi devant le savant Laplace un examen dont il sortit avec triomphe, il fut inscrit sur la liste des élèves jugés capables d’être officiers, avec cette mention:
«Napoléon Bonaparte, né en Corse; réservé et studieux; préfère l’étude à toute espèce d’amusement; se plaît à la lecture des bons auteurs; très-appliqué aux sciences abstraites; peu curieux des autres; connaissant à fond les mathématiques et la géographie, silencieux, aimant la solitude; parlant peu, énergique dans ses réponses, prompt et sérieux dans ses reparties. Ce jeune homme est digne d’être protégé.»
Il reçut son brevet de sous-lieutenant d’artillerie et prit rang dans l’armée le 1er septembre 1785.