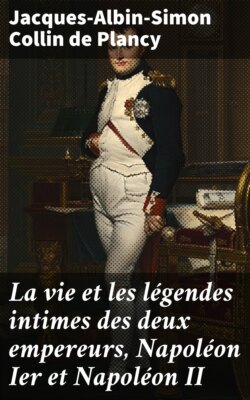Читать книгу La vie et les légendes intimes des deux empereurs, Napoléon Ier et Napoléon II - Jacques-Albin-Simon Collin De Plancy - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XIV. — LE CONSULAT.
ОглавлениеTable des matières
Terrible dans la guerre et sage dans la paix,
Il est avant trente ans l’honneur du nom français.
FRANÇOIS DE NEUFCHATEAU .
Pendant que la commission des Vingt-Cinq préparait avec les consuls, et sous la présidence habituelle de Bonaparte, une constitution sérieuse, les premiers actes du nouveau gouvernement furent la suppression de la loi sur les otages et la mise en liberté de tous ceux qui en étaient les victimes; le rapport de la loi sur l’emprunt forcé ; la déportation à la Guyane de plusieurs représentants du jacobinisme. (Mais la plupart se soumirent et obtinrent aussitôt des emplois.)
On rendit sur-le-champ la liberté à tous les prêtres parqués dans les îles de Ré et d’Oléron.
Plusieurs mesures de ce genre rassurèrent complétement la nation; et le Premier Consul se vit béni de toutes parts, en dépit des jacobins. Plusieurs paroisses firent dire des messes pour sa conservation, et les catholiques exaltèrent le nom de celui en qui ils voyaient un envoyé de Dieu.
Le 22 frimaire (13 décembre 1799), on promulgue la nouvelle constitution, dite la Constitution de l’an VIII. Elle est l’œuvre de Bonaparte. Elle établit que le pouvoir exécutif est confié pour dix ans à trois consuls; qu’il sera éclairé et secondé par un Sénat conservateur, composé de quatre-vingts membres, âgés de quarante ans et au delà ; par un Corps législatif composé de trois cents membres, âgés au moins de trente ans; et par un Tribunat de cent membres de vingt-cinq ans au moins, ceux-là chargés de discuter les lois proposées par les consuls.
Le Premier Consul, par cette constitution, a les sceaux de l’État; il promulgue les lois; il nomme à toutes les places; il a à sa nomination un nombre de conseillers d’État qui sont, comme on l’a vu, les orateurs du gouvernement, pour soutenir devant le Tribunat et devant le Corps législatif les lois proposées, après en avoir exposé les motifs. Les deux autres consuls au besoin suppléent le premier.
Dans cette même constitution, le premier consul est Bonaparte, le second Cambacérès, le troisième Lebrun.
Bonaparte ne voulait pas seulement que cette constitution fût promulguée, il voulait qu’elle fût soumise à la froide et calme acceptation du peuple français tout entier, mais individuellement et sans réunions. Dans ce but, des registres furent déposés chez les juges de paix, chez les notaires, chez les maires, de sorte que chacun put aller déposer son suffrage ou son opposition. Ce grand acte ne fut assis et proclamé loi générale de l’État que lorsqu’il fut établi qu’il était généralement accepté. Alors le Premier Consul accorda une amnistie générale à tous les habitants insurgés des départements de l’Ouest. Dans son discours du 10 novembre, au conseil des Anciens, il avait laissé prévoir cette mesure, en exprimant son horreur pour les guerres fratricides qui avaient dévasté la Vendée.
Le 25 décembre parut une loi qui réglait le mode et la nature des récompenses que l’État devait accorder aux militaires qui s’étaient distingués ou qui se distingueraient par des actions d’éclat.
Le 26, le Premier Consul écrivit au roi d’Angleterre une lettre où il lui faisait part de son élévation à la première dignité de la République, en lui exprimant son désir sincère de voir la France et l’Angleterre unies pour amener une paix générale.
Le 1er janvier de l’an 1800, qui ouvrait le dix-neuvième siècle, vit l’installation du Corps législatif et du Tribunat. Le Sénat fut composé des membres les plus capables du conseil des Cinq-Cents. Le 19 janvier, le gouvernement consulaire s’installa avec pompe aux Tuileries. Le 23 vit l’établissement de la Banque de France; les ministères furent confiés à des hommes spéciaux; les directeurs de chaque département furent remplacés par des préfets. Tout se relevait avec splendeur, et le pays respirait enfin.
Mais on attendait la réponse de l’Angleterre à la lettre du Premier Consul. On reçut enfin du ministre Pitt une réplique qui tranchait la négociation: «L’Angleterre, écrivait-il, ne » pourra signer la paix que quand la France sera rentrée » dans ses anciennes limites.» Lord Granville, de son côté, écrivait a Talleyrand, ministre alors dès affaires étrangères, une lettre diplomatique qui était en quelque sorte une déclaration de guerre. Pitt, cependant, se sentait ébranlé par les raisons de Fox et de Shéridan, chefs de l’opposition, qui plaidaient la cause de la paix; et alors eut lieu une scène qui n’est pas encore entrée dans l’histoire. Elle a été racontée par le cardinal Fesch, oncle maternel de Napoléon, à M. Olivier Fulgence, dans son voyage à Rome en 1838. Ce récit explique ce qu’on lit dans les biographies des négociations que Pitt entreprit sans succès avec le Premier Consul, dont il connaissait la valeur. En empruntant ce récit au préambule mis par M. Olivier Fulgence en tête de l’excellent livre de M. le chevalier de Beauterne, nous n’avons à rectifier que la date des faits:
«Si on avait su ce que les Anglais exigeaient de Napoléon, si on avait su pourquoi il fit une guerre si acharnée contre eux!... (c’est le cardinal Fesch qui parle) Vous pouvez en croire un homme qui n’a jamais quitté ses conseils: il aurait eu la paix des Anglais sans peine, sans grandes concessions politiques, s’il eût été moins sérieusement catholique. Car ce n’était pas lui qui faisait obstacle, c’était sa foi. On lui en voulait, à lui, homme nouveau, que l’on voyait sur le chemin du trône, et sans antécédents comme en avait la race déchue, on lui en voulait de manquer la seule occasion qui se fût présentée en France depuis Henri IV de détruire la religion catholique... Oui, je vous l’affirme, les Anglais lui faisaient une paix magnifique, s’il eût consenti à établir le protestantisme en France.... Cela vous étonne; écoutez un fait qui vaut toutes les sortes de preuves.
» Un jour, le télégraphe annonce qu’un émissaire de Pitt vient de descendre à Boulogne, et qu’il sollicite l’autorisation de se rendre à Paris, pour transmettre au gouvernement des communications fort importantes. C’était un certain Marséria, Corse de nation, qui avait fait ses études pour entrer dans la prêtrise, qui avait jeté le froc aux orties avant de recevoir le sous-diaconat, et qui avait passé au service de l’Angleterre, où il était alors capitaine. On m’en apporte la nouvelle; et j’entre immédiatement chez Napoléon. Je le trouvai au bain; car, à cette époque, il passait les nuits au travail, et le matin, pour se reposer, il se mettait au bain en continuant de dicter. Je lui rends compte de la dépêche, et de la demande de cet homme. Son premier mot fut un refus.
» — Qu’ai-je à pourparler avec Pitt? me dit-il; si je reçois un envoyé de Pitt, les Français vont crier que je traite avec lui. Qu’on le fasse repartir.
» — Et pourquoi? lui répliquai-je. Non, recevez-le; Marséria est un galant homme. Au moins faut-il savoir ce qu’il est chargé de vous dire.
» Il fit encore quelques objections, mais à la fin, comme je le pressais fort, il me dit: — Soit donc! recevez-le, vous, mon oncle; mais que je n’en entende plus parler.
» J’écrivis en conséquence. Marséria ne se le fit pas répéter, prit la poste, et le surlendemain matin il était chez moi. Il entre d’un air fort dégagé.
» — Eh! que venez-vous faire ici? lui demandai-je. Savez-vous, Monsieur, ajoutai-je en riant, que vous êtes bien hardi de venir vous jeter ainsi en France, vous, Français au service de l’Angleterre, et que l’on serait en droit de vous y arrêter?
» — Oh! oh! répondit-il, je n’ai pas peur de cela. Je suis chargé d’une mission toute spéciale de la part de Pitt, et j’ai des choses fort importantes à dire au Premier Consul. Mais je vous le déclare tout de suite, pour ménager le temps, je ne puis les dire qu’à lui; et s’il ne veut pas m’entendre lui-même, je remporte ma mission et mes paroles.
» Sur-le-champ j’allai communiquer ce préambule à l’Empereur, et il consentit enfin à recevoir Marséria.
» Celui-ci commença par prendre caractère: — Vous savez, dit-il au Premier Consul, que je ne suis qu’un pauvre officier, peu riche de moi, partant peu garni d’argent d’ordinaire; et cependant, aujourd’hui, me voilà fourni comme un banquier...
» En effet, il tira de son gousset nombre de billets de banque. — Cela suffit, ce me semble, continua-t-il, pour établir que je ne viens pas ici à mes frais. Mais, j’ai mieux encore pour vous certifier ma mission; car je suis porteur de lettres de M. Pitt....
» — Mon cher Marséria, interrompit Napoléon, gardez vos lettres. Je n’ai rien de particulier à démêler avec M. Pitt. Je vous reçois comme compatriote, comme ancienne connaissance, mais non à titre d’envoyé.
» Marséria reprit: — Vous vous faites une idée exagérée, injuste des préventions de l’Angleterre à votre égard. L’Angleterre n’a rien contre vous personnellement. Elle ne tient pas à la guerre, qui la fatigue et qui lui coûte ses richesses. Elle en achètera même volontiers la fin au prix de maintes concessions que sans doute vous n’espérez pas; mais pour vous donner la paix, elle vous impose une seule condition: c’est que vous l’aidiez à l’établir chez elle.
» — Moi! répliqua l’Empereur, eh! qu’ai-je à faire en Angleterre? Ce n’est pas mon rôle, je suppose, d’y mettre la concorde. D’ailleurs, je ne vois pas comment j’y serais’ propre.
» — Plus que vous ne le pensez, continua Marséria; et pesant ses paroles, il reprit: L’Angleterre, surtout depuis l’invasion des prêtres et des religieux proscrits par les républicains, l’Angleterre est déchirée de discordes intestines. Ses institutions se minent peu à peu. Une sourde lutte la menace, et jamais elle n’aura de tranquillité durable tant qu’elle sera divisée entre deux cultes. Il faut que l’un des deux périsse; il faut que ce soit le catholicisme. Et pour aider à le vaincre, il n’y a que vous. Établissez le protestantisme en France, et le catholicisme est détruit en Angleterre. Établissez le protestantisme en France: à ce prix, vous avez une paix telle assurément que vous la pouvez souhaiter.
» — Marséria, répliqua le Premier Consul, rappelez-vous ce que je vais vous dire; et que ce soit votre réponse: Je suis catholique; et je maintiendrai le catholicisme en France, parce que c’est la religion de l’Église, parce que c’est celle de mon père, parce que c’est la mienne enfin. Et, loin de rien faire pour l’abattre ailleurs, je ferai tout pour la rétablir et la raffermir ici.
» — Mais remarquez donc, reprit vivement Marséria, qu’en agissant ainsi, en restant dans cette ligne, vous vous donnez des chaînes invincibles, vous vous créez mille entraves. Tant que vous reconnaîtrez Rome, Rome vous dominera; les prêtres domineront au-dessus de vous; leur action pénétrera jusque dans votre volonté. Avec eux vous n’aurez jamais raison à votre guise; le cercle de votre autorité ne s’étendra jamais jusqu’à sa limite absolue, et subira au contraire de continuels empiétements.
» — Marséria, il y a ici deux autorités en présence. Pour les choses du temps, j’ai mon épée, et elle suffit à mon pouvoir. Pour les choses du ciel, il y a Rome, et Rome en décidera sans me consulter; elle aura raison. C’est son droit.
» — Mais, reprit de nouveau l’infatigable Marséria, vous ne serez jamais complétement souverain, même temporellement, tant que vous ne serez pas chef d’Église; et c’est là ce que je vous propose. C’est de créer une réforme en France, c’est-à-dire une religion à vous.
» — Créer une religion! répliqua le Premier Consul en souriant; pour créer une religion il faut monter sur le Calvaire, et le Calvaire n’est pas dans mes desseins. Si une telle fin convient à Pitt, qu’il la cherche lui-même. Mais, pour moi, je n’en ai pas le goût.
» Voilà, reprit après un moment d’interruption le cardinal Fesch, voilà comment Napoléon était catholique, et comment il défendait sa religion.»
Et on verra dans la suite de ces faits qu’il eut à soutenir plusieurs fois encore de pareilles luttes.
Or, les résolutions de Napoléon, rapidement communiquées à Pitt, ne pouvaient amener la paix. D’ailleurs, les conquêtes de la campagne d’Italie étaient toutes à peu près perdues. L’Autriche, alimentée par l’or de l’Angleterre, entretenait une armée de soixante mille hommes sur les frontières des Alpes. Cette armée était commandée parle feld-maréchal Mélas. Elle venait de faire subir une défaite au brave général Championnet, le même qui avait en 1794 décidé la victoire de Fleurus, et qui avait gagné d’autres batailles. Les troupes françaises, atteintes d’une épidémie, ne pouvaient plus que peu.
Le Premier Consul, qui veillait à tout, arrêta le 8 mars qu’il serait formé à Dijon une armée de réserve de soixante mille hommes. En même temps il lança dans la Vendée une proclamation où on lisait:
«Il est des citoyens, chers à la patrie, qui ont été séduits. C’est à ces citoyens que sont dues la lumière et la vérité. Des lois injustes ont été promulguées et exécutées; de grands principes d’ordre social ont été violés. La volonté constante, comme la gloire des premiers magistrats, est de fermer les plaies de la France. La liberté des cultes est garantie désormais par la Constitution. Les ministres d’un Dieu de paix seront les premiers moteurs de la réconciliation et de la concorde. Qu’ils parlent aux cœurs le langage qu’ils ont appris à l’école de leur divin Maître. Qu’ils aillent dans ces temples, qui se rouvrent pour eux, offrir le sacrifice qui expiera les crimes de la guerre et le sang qu’elle a fait verser.»
La Vendée était pacifiée, l’horrible fête du 21 janvier était supprimée, la confiance était partout avec l’ordre; et l’armée était prête, lorsque le 6 mai 1800 le Premier Consul quitta Paris pour aller prendre le commandement de l’armée de réserve préparée à Dijon, et qui allait devenir à son tour l’armée d’Italie.