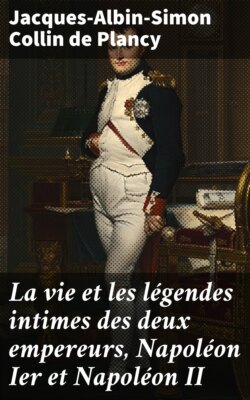Читать книгу La vie et les légendes intimes des deux empereurs, Napoléon Ier et Napoléon II - Jacques-Albin-Simon Collin De Plancy - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IX. — CONTINUATION DE LA CAMPAGNE.
ОглавлениеTable des matières
En avant!
Cri français.
Le 14 janvier 1797, bataille de Rivoli; les Autrichiens sont en pleine déroute, et le général Alvinzy, qui les commande, en fuite.
Cette victoire avait eu pour prélude, le 12, les combats de Saint-Michel et de Montebaldo. Le 15, combat d’Anghiari. Le 16, combat de Saint-Georges; bataille de la Favorite. En cinq jours, l’armée a gagné deux batailles rangées et six combats. Elle a tué six mille hommes, fait vingt-cinq mille prisonniers, pris vingt drapeax et soixante canons. Le 25, Bonaparte fait évacuer la Toscane; le 26, combats de Carpenedolo et d’Avio; le 27, combat de Derumbano; le 30, après avoir forcé des gorges du Tyrol, les Français font leur entrée dans Trente.
Le 1er février, l’armée française envahit la Romagne et occupe Imola , Faenza et Forli. Le 3, capitulation de Mantoue, dont la garnison est prisonnière. On y trouve 538 bouches à feu, 17,000 fusils, près de 5,000 pistolets, 14,500 bombes, 187,000 boulets, 530,000 livres de poudre, près d’un million et demi de gargousses et de cartouches, 36,000 livres de fer, 321,000 livres de plomb et 184 caissons. Il faut lire les détails rapides de ce grand fait où les généraux de Bonaparte lui reprochaient d’être trop magnanime pour un ennemi. Nous citons le bel ouvrage du colonel de Chambure .
«Le maréchal Wurmser avait envoyé son aide de camp Klenau au quartier général français. Son envoyé disait que la ville pouvait encore tenir trois mois, et que si le maréchal demandait à capituler, c’était par égard pour les souffrances du peuple de Mantoue. Bonaparte se lève et dit à Klenau:
«Si Wurmser avait seulement pour vingt jours de vivres
» et qu’il parlât de se rendre, il ne mériterait aucune capitu-
» lation honorable. Mais je respecte l’âge, la bravoure et les
» malheurs du maréchal. Voici les conditions que je lui
» accorde, s’il ouvre ses portes demain. S’il tarde quinze
» jours, un mois, deux mois, il aura les mêmes conditions.
» Il peut attendre jusqu’à son dernier morceau de pain. Je
«pars à l’instant pour passer le Pô..... Vous connaissez mes
» intentions: allez le dire à votre général.»
» Klenau a reconnu le général Bonaparte. Mais c’est en lisant ses conditions généreuses qu’il apprendra à le juger. Napoléon veut honorer le courage malheureux. Wurmser conservera son épée et reconduira dans sa patrie le reste de son armée.
» Plein de reconnaissance pour cette noble conduite, le vieux maréchal veut voir son jeune vainqueur; il le presse de venir passer le fleuve à Mantoue. Mais Bonaparte se refuse à paraître devant la ville, qui vient de lui envoyer ses clefs. Le jour de la reddition de la place, ce n’est pas lui qui en prendra possession. Des soins plus importants l’occupent: il dédaigne de jouir de ses succès; il lui importe d’en profiter. C’est le général Sérurier qui entre à Mantoue et qui voit défiler devant lui la garnison autrichienne.....
» Si Napoléon a pu se dérober aux honneurs qui l’attendent, il ne peut se soustraire aux témoignages que Wurmser veut lui donner de sa reconnaissance. Le maréchal lui écrit une lettre honorable pour tous deux, et l’instruit d’un complot d’empoisonnement qui doit éclater à son passage dans la Romagne. Cet avis fut utile, dit laconiquement Napoléon dans ses Mémoires. Il fut beau et noble de la part de Wurmser de veiller sur les jours de celui qui avait veillé sur son honneur..... »
Mais reprenons.
Le 9 février, les Français occupent Ancône; le 10, ils occupent Lorette; le 13, le saint pape Pie VI écrit au général Bonaparte, qu’il appelle son très-cher fils, une lettre où il demande la paix. Cette paix entre la République française et le pape Pie VI est signée le 19 février, à Tolentino, avec des concessions et des conditions assez onéreuses, exigées par le gouvernement français d’alors . Le 22, le Pape adresse un bref à son cher fils Napoléon Bonaparte, pour le remercier d’une mesure qu’il vient de prendre en faveur des prêtres réfugiés en Italie. Voici la pièce relative à cette mesure:
BONAPARTE, GÉNÉRAL EN CHEF DE L’ARMÉE D’ITALIE.
«Au quartier général de Macerata, le 27 pluviôse an V (15 février 1797).
» La loi de la Convention nationale sur la déportation défend aux prêtres réfractaires de rentrer sur le territoire de la République française, mais non pas de rester sur le territoire conquis parles armées françaises.
» La loi laisse au gouvernement français la faculté de prendre sur cet objet les mesures que les circonstances peuvent exiger.
» Le général en chef, satisfait de la conduite des prêtres réfractaires réfugiés en Italie, ordonne:
» ARTICLE 1er. — Les prêtres réfractaires sont autorisés à rester dans les États du Pape conquis par les armées françaises.
» ARTICLE 2. — Il est défendu, sous les peines les plus sévères, aux individus de l’armée, aux habitants, prêtres ou religieux du pays, de molester, sous quelque titre que ce soit, les prêtres réfractaires.
» ARTICLE 3. — Les prêtres réfractaires seront mis en subsistance dans les différents couvents, où il leur sera accordé par les supérieurs le logement, la nourriture, la lumière et le feu.
» ARTICLE 4. — Les supérieurs des couvents donneront à chaque prêtre réfractaire quinze livres de France par mois, pour leur habillement ou entretien.»
Citons encore le dernier article de cette proclamation:
«Le général en chef verra avec plaisir ce que les évêques et les prêtres charitables feront pour améliorer le sort des prêtres réfugiés ou déportés.»
Cet acte si simplement généreux fut connu bien vite à Paris, et il produisit tant d’effet que le Directoire dut le confirmer. Il publia donc ce qu’on va lire, le 8 ventôse (26 février), onze jours après l’initiative prise par le général:
«Le Directoire exécutif arrête:
» ARTICLE 1er. — Le ministre des relations extérieures est autorisé à délivrer un passe-port et une route à tout prêtre français, non détenu pour crime prévu par le Code pénal, qui déclarera vouloir se rendre en Italie, dans la partie des États du Pape occupée par les troupes de la République.
» ARTICLE 2. — Le général en chef de l’armée d’Italie prendra toutes les mesures qui lui paraîtront convenables pour qu’il soit efficacemennt pourvu aux besoins de ces prêtres, et pour qu’ils soient traités de même que les autres prêtres français qui ont été trouvés réfugiés sur les terres du Pape.»
De tels faits expliquent les sympathies que le général Bonaparte soulevait de toutes parts-autour de lui.
En même temps que les sages mesures qu’on vient de lire, le général Bonaparte occupait l’Ombrie et soutenait le 22 février le combat de Lovadino. Le 26, il envoyait à Paris les trophées de Mantoue.
Le 2 mars, combat de Monte-di-Sover; le 10, occupation de Feltre et bataille de Bellune; le 12, combat de San-Salvador; le 13, combats de Longura et de Sacile. Le 16, bataille du Tagliamento; les Autrichiens, commandés par le prince Charles, sont mis en déroute. Le 18, prise de Palma-Nova et d’autres postes; le 19, prise de Gradisca; combat de Casasola; le 21, prise de Goritz et de Camiza, combats de Caminio. Le 22, combats de Puféro et prise de Botzen; le 23, prise de Trieste, qui ajoute le Tyrol autrichien à la conquête de l’Italie.
Le 25, attaque des gorges du Tyrol; combats de Tarvis, de Trévise, de la Chiuse, où l’armée française gagne trente pièces de canon, quatre cents chariots, cinq mille prisonniers, dont quatre généraux. Le 28, combat de Bruck; le 29 prise de Klagenfurth, et soumission de la Carniole et de la Carinthie. Le 31 mars, lettre du général Bonaparte à l’archiduc Charles; il y engage le prince autrichien à s’unir à lui pour arrêter le fléau de la guerre.
Le 1er avril, prise de Neumarkt et de Freisach; le 3, combat de Hundsmarck; prise de Kintenfeld, Jundenburg et Scheffling. Le 4, l’armée française poursuit l’armée du prince Charles sur la route de Vienne. Le 7, suspension d’armes entre l’armée française et le prince Charles. Le 8, la ville de Gratz est occupée par les Français. Le général Bonaparte n’est qu’à trente lieues de Vienne.
Le 13, l’armistice entre le prince Charles et le général Bonaparte expire. L’armée française enveloppe l’armée autrichienne. Le 18 avril, entre les plénipotentiaires autrichiens et le général Bonaparte représentant la République française, se signent au château d’Eckenvald, près de Léoben, les préliminaires de la paix.
Le 16 avril, une révolution se prépare à Venise. Vérone, à l’instigation des Vénitiens, s’insurge contre les Français. Cette ville est reprise le 24, et tous les États de terre ferme de la république de Venise sont envahis par ordre de Bonaparte. Il publie le même jour un manifeste contre la Vénétie. Le 3 mai, il lui déclare la guerre; le 11, les troupes françaises entourent Venise, où la noblesse effrayée prend la fuite; le doge abdique, l’anarchie s’agite dans la fière cité, et les habitants en masse appellent les Français pour ramener l’ordre chez eux. La ville est prise le 16; le 20 mai, le général Bonaparte y fait son entrée, et quelques jours après il envoie au Directoire les drapeaux pris aux Vénitiens.
Napoléon profite de la paix achetée par tant de victoires pour organiser l’Italie. Il établit la république cisalpine, ayant Milan pour capitale; la république ligurienne, ayant pour capitale Gênes; il maintient la république de Saint-Marin, sous le protectorat de la France; il partage les États vénitiens entre la France, la république cisalpine et l’empereur d’Allemagne; il maintient la paix avec le royaume de Naples.
Ce ne fut que le 17 octobre que la paix dont l’Autriche avait si grand besoin fut faite à Passeriano, quoiqu’on lui ait donné le nom de Campo-Formio, qui est un village voisin. Elle fut signée dans l’appartement qu’occupait là le général Bonaparte. Dans ce traité, qui reconnaissait toutes les conquêtes de la France , le vainqueur avait imposé pour condition accessoire, quoique formelle, la liberté du général la Fayette et de deux autres Français retenus par l’Autriche dans les prisons d’Olmutz. Dès qu’il se revit libre, la Fayette écrivit au général Bonaparte, son libérateur, la lettre qui suit, datée de Hambourg:
«Citoyen Général.
» Les prisonniers d’Olmutz, heureux de devoir leur délivrance à la bienveillance de leur patrie et à vos invincibles armes, avaient joui dans leur captivité de la pensée que leur liberté et leur vie étaient attachées aux triomphes de la République et à votre gloire personnelle. Ils jouissent aujourd’hui de l’hommage qu’ils aiment à rendre à leur libérateur.
» Il nous eût été doux, citoyen général, d’aller vous offrir nous-mêmes l’expression de ces sentiments, de voir de près le théâtre de tant de victoires, l’armée qui les remporta, et le héros qui a mis notre résurrection au nombre de ses miracles. Mais vous savez que le voyage de Hambourg n’a pas été laissé à notre choix; et c’est du lieu où nous avons dit le dernier adieu à nos geôliers que nous adressons nos remercîments à leur vainqueur.
» Dans la retraite solitaire, sur le territoire danois du Holstein, où nous allons tâcher de rétablir les santés que vous avez sauvées, nous joindrons au vœu de notre patriotisme pour la République l’intérêt le plus vif à l’illustre général auquel nous sommes encore plus attachés par les services qu’il a rendus à la cause de la libertê et à notre patrie, que par les obligations particulières que nous nous glorifions de lui avoir, et que la plus vive reconnaissance a gravées dans nos cœurs.
» Salut et respect.
» LA FAYETTE, LATOUR-MAUBOURG, BUREAU DE PUZY.»
En lisant cette lettre empâtée, Napoléon souriait à demi; et il dit en la refermant: «Il se réserve toujours d’être notre Washington.»