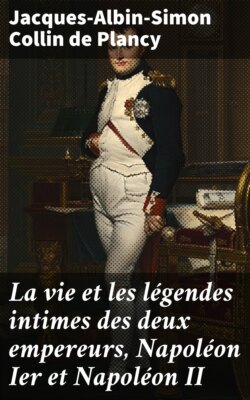Читать книгу La vie et les légendes intimes des deux empereurs, Napoléon Ier et Napoléon II - Jacques-Albin-Simon Collin De Plancy - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
X. — FÊTES A PARIS.
ОглавлениеTable des matières
Aucune gloire désormais
Ne vous sera donc étrangère?
Et vous savez faire la paix
Comme vous avez fait la guerre.
ARNAULT, Au général Bonaparte.
Dès qu’on apprit à Paris que la paix était définitivement signée et que le général Bonaparte allait à Rastadt la confirmer par une convention militaire, le Directoire, que l’immense popularité du héros effrayait outre mesure, s’empressa de le nommer général en chef de l’armée dite d’Angleterre.
Les Anglais étaient les seuls ennemis qui nous restassent à combattre, quoique d’ailleurs ils fussent peu formidables dès lors, n’ayant plus d’appuis sur le continent. Cette nomination eut lieu le 26 octobre 1797; et ce ne fut que cinq jours après que les directeurs reçurent officiellement le traité de paix apporté par Berthier et Monge. Mais depuis les préliminaires de Léoben, on avait rassemblé sur les côtes de l’Océan une armée et une flotte.
M. Granier de Cassagnac, qui a si complétement et si bien compris toutes les phases de la Révolution, expose très-nettement la position d’alors:
«Le Directoire, dit-il, ne voulait pas la paix; il ne tenait qu’à lui, comme l’a révélé Carnot, de la conclure cinq mois plus tôt, aux conditions qui ont été acceptées.... A l’arrivée des préliminaires de Léoben, les triumvirs rugissent: la Réveillère-Lepaux était un tigre; Rewbell poussait de gros soupirs; Barras désapprouvait le traité. Un jour, ne pouvant contenir sa rage, il se leva brusquement et s’adressant à moi comme un furieux: «Oui, me dit-il, c’est à toi que » nous devons l’infâme traité de Léoben .»
» Cet éloignement du Directoire pour la paix avait deux causes; il redoutait ces questions intérieures d’organisation de travail, de commerce, d’économie, de prospérité, de satisfaction générale que les temps calmes posent toujours et qu’il faut résoudre, sous peine d’affaiblissement et de déchéance. Il avait peur de ces généraux couverts de lauriers, à la vie noble et pure, ayant avec l’amour des soldats la confiance de l’opinion publique, et pouvant devenir, par la seule force de la comparaison, des rivaux très-redoutables.
» Bonaparte surtout était pour le Directoire un objet de jalousie et de défiance. Barras lui devait le succès du 18 fructidor, et c’est peut-être parce qu’il sentait sa supériorité et sa force qu’il le haïssait en le caressant. «Bonaparte leur fut tou-
»jours odieux, dit encore Carnot, et ils ne perdirent jamais de
» vue le projet de le faire périr. Je n’en excepte point Barras.
» L’ascendant que prenait le général, par ses victoires multi-
» pliées, commençait à l’importuner.»
» Ce sont précisément ces mêmes raisons qui rendaient la paix et la renommée de Bonaparte chères à l’opinion publique. On trouvait dans la paix la fin des maux du passé, et dans le jeune vainqueur une espérance et une garantie pour l’avenir.
» Le traité de paix conclu entre la République et l’Empereur, roi de Hongrie et de Bohême, arriva au Directoire dans la nuit du 26 au 27 octobre 1797; il était apporté par le général Berthier, à qui Bonaparte avait adjoint Denon, pour lequel il avait et il conserva une estime particulière.... Le Directoire l’adressa aux deux conseils par un message.
» L’arrivée du message annonçant la paix produisit dans les conseils une ivresse générale. Au conseil des Cinq-Cents, des membres épars dans les corridors se pressèrent aux portes de la salle en criant: La paix! La paix! la lecture du message terminée, les curieux des tribunes, les journalistes, les personnes assises dans la salle, au banc des pétitionnaires, donnèrent le signal des applaudissements. L’assemblée entière était debout, découverte, contre son habitude, et mêlait ses acclamations à celles du public . Au conseil des Anciens, les mêmes transports éclatèrent; et la séance fut levée au milieu de l’enthousiasme universel. Cette joie sincère et bruyante exprimait la pensée du pays.
» Pour la France, la paix avec l’Empereur, c’est-à-dire avec la seule des grandes puissances continentales qui eût jusqu’alors refusé de traiter, c’était la fin de la Révolution.... Cette paix voulait dire, pour ceux qui avaient voté la mort du Roi, qu’ils ne seraient pas recherchés par une restauration remplie de colère; pour ceux qui avaient acheté des biens nationaux, qu’ils ne seraient pas chassés de leurs nouvelles possessions; pour ceux qui étaient voués aux principes de 1789, qu’ils n’auraient plus à compter avec un état social tombé sans retour; pour les soldats qui avaient couru aux frontières, que la Belgique et la rive gauche du Rhin seraient désormais acquises par le droit; pour tous ceux qui sentaient la dignité et la gloire de la patrie, que la France, sortie victorieuse d’une lutte avec l’Europe entière, déposait les armes après avoir fait entrer ses principes dans le droit public des nations civilisées.
» Le général Bonaparte, à qui étaient dus des résultats si beaux, longtemps inespérés, était devenu le pivot des espérances publiques...., non-seulement au point de vue de la gloire militaire, mais aussi au point de vue de la probité politique et de l’élévation du caractère, entièrement hors de pair avec tous les généraux de son temps, quels qu’ils fussent. Aussi tout le monde avait le pressentiment des hautes destinées de Bonaparte et s’en exprimait publiquement.
. » C’est au milieu de ces préoccupations générales que Bonaparte, qui s’était rendu de Milan à Rastadt, et qui avait pris part quelques jours aux préliminaires du congrès, arriva le 5 décembre 1797 à Paris, où l’attendaient, au milieu de l’anxiété et de la jalousie du Directoire, la curiosité et l’admiration publiques.»
Le 26 octobre, bien avant la rentrée de Bonaparte à Paris, le Directoire avait rassemblé différents corps de troupes sur les côtes de l’Océan. Ils devaient former une armée destinée à combattre l’Angleterre. Le général Desaix avait reçu l’ordre de se rendre à Rennes pour surveiller ces préparatifs. On annonçait que le général Bonaparte était chargé de cette grande expédition; et une proclamation affichée partout engageait tous les Français à se liguer, pour châtier le cabinet britannique de sa perfidie, en exposant que c’était à Londres que l’on fabriquait les malheurs de l’Europe, et que c’était là qu’il fallait y mettre un terme.
Le 29 octobre, le concile des prêtres constitutionnels chanta dans l’église de Notre-Dame un Te Deum en actions de grâces du traité de paix de Campo-Formio; cérémonie qui eut lieu aux instances des masses, et que le Directoire n’osa pas empêcher.
Le 31 octobre, le général Berthier se présenta solennellement devant le Directoire: il tenait d’une main le traité de Campo-Formio et de l’autre une branche d’olivier. «Ce rameau, dit-il, a été acheté glorieusement par cinq cent quatre-vingt-un combats, parmi lesquels on compte presque autant de victoires. »
Dans son discours, il rappela le début de cette grande campagne et il cita une des allocutions du général Bonaparte, lorsque sa petite armée de vingt mille hommes fut parvenue au sommet des Alpes, d’où l’on voyait les plaines fertiles du Piémont et de la Lombardie:
«Soldats, ce n’est plus une guerre défensive, c’est désor-
» mais une guerre d’invasion; ce sont des conquêtes que vous
» allez faire. Point d’équipages, point de magasins. Vous êtes
» sans artillerie, sans habits, sans souliers, sans solde; vous
» manquez de tout. Mais vous êtes riches en courage. Eh bien,
» voilà vos magasins, votre artillerie! Vous avez du fer et du
» plomb; marchons, et dans peu ils seront à nous. L’ennemi
» est quatre fois plus nombreux que nous: nous en acquer-
» rons plus de gloire.....»
Le 15 novembre, le général Bonaparte, en quittant l’armée d’Italie pour se rendre au congrès de Rastadt, fit ses adieux aux soldats; mais il leur annonçait, en même temps, que bientôt il serait avec eux «pour lutter contre de nouveaux dangers, et qu’il espérait les retrouver toujours dignes soutiens de la liberté et de la gloire du nom français».
Le 1er décembre, après avoir traversé la Suisse, où il reçut partout des ovations, Bonaparte arrivait au congrès de Rastadt; il y stipula avec les plénipotentiaires autrichiens l’évacuation, avant la fin du mois, de Mayence et des autres places cédées aux Français sur la rive gauche du Rhin; et le 5 décembre il arrivait sans bruit à Paris, où sa présence mit sur-le-champ toute la grande ville en fête. Il s’était rendu à son petit hôtel de la rue Chantereine, que le peuple baptisa aussitôt du nom de rue de la Victoire. Il se présenta le même jour au Directoire, sans appareil et sans entourage.
Mais on lui préparait une fête qui eut lieu le 10 décembre, au palais du Luxembourg; toute la ville y prit part. Une garde d’honneur s’était improvisée pour l’escorter au palais directorial; il y arriva sans pompe, dans une simple voiture et accompagné seulement de Marmont, l’un de ses aides de camp. Les généraux Joubert et Andréossy déployèrent alors, devant les directeurs, les ministres, les représentants des puissances, les deux conseils, un immense drapeau, sur lequel on lisait la longue série des hauts faits du héros de l’Italie.
Cependant, la veille, les directeurs avaient nommé Alexandre Berthier général en chef de l’armée d’Italie; et deux jours après le Corps législatif donna à Bonaparte un somptueux dîner d’honneur, dans la grande galerie du Louvre. Le passage du pont de Lodi était représenté, sur la table immense, en pâtisserie appétissante; ce qui fit sourire le héros de la fête. Quinze toasts furent portés à ce dîner, au bruit du canon. En quittant la table, Bonaparte sortit par le grand salon, où l’on avait rassemblé tous les chefs-d’œuvre de l’Italie dont il avait enrichi la France. Le banquet magnifique fut fêté par la nombreuse assemblée; pour lui, il n’y mangea qu’un fruit, car la sobriété était une de ses vertus.
Le 25 décembre, le général Bonaparte est nommé membre de l’Institut de France.
Le 3 janvier 1798, le ministre des relations extérieures donne une fête au général Bonaparte, qui ne peut paraître dans Paris sans être acclamé partout.
Il s’échappe quelques jours après, pour calmer les inquiétudes du Directoire, et va inspecter, sur les côtes de l’Océan, les préparatifs de la guerre déclarée à l’Angleterre. Il ne revint de cette excursion que le 23 février et s’occupa de composer son état-major. Dix jours plus tard, le Directoire le chargea de diriger le grand armement formé sur les côtes de la Méditerranée, afin de soutenir, au besoin, le général Berthier, qui ne suivait pas la ligne de Bonaparte et qui respectait peu le sentiment religieux.
On apprend que, le 22 février, la république de Mulhouse s’est détachée, la veille, de la confédération helvétique pour se réunir à la République française.
Le 2 avril, le Directoire arrête que le général Bonaparte se rendra sur-le-champ à Brest et y prendra le commandement de l’armée et des forces navales qui sont rassemblées pour la descente en Angleterre. Dix jours après, un autre arrêté nomme Bonaparte général en chef de l’armée d’Orient, car le Directoire veut éloigner le héros. Bonaparte arrive à Toulon le 8 mai; il s’occupe de préparer son armée, et fait à ses braves cette proclamation:
«Soldats, vous êtes une des ailes de l’armée d’Angleterre. Vous avez fait la guerre des montagnes, des plaines et des siéges, il vous reste à faire la guerre maritime. Les légions romaines, que vous avez quelquefois imitées, mais pas encore égalées, combattaient Carthage tour à tour sur cette mer et aux plaines de Zara; la victoire ne les abandonna jamais, parce que, constamment, elles furent braves, patientes à supporter la fatigue, disciplinées et unies entre elles. Soldats, matelots, vous avez été jusqu’à ce jour négligés. Aujourd’hui la plus grande sollicitude de la République est pour vous. Le génie de la liberté, qui a rendu, dès sa naissance, la République arbitre de l’Europe, veut qu’elle le soit des mers et des nations les plus lointaines....»