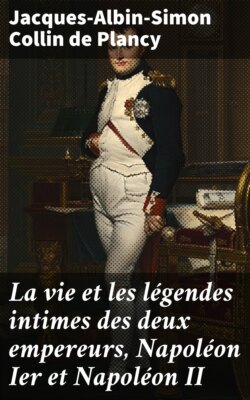Читать книгу La vie et les légendes intimes des deux empereurs, Napoléon Ier et Napoléon II - Jacques-Albin-Simon Collin De Plancy - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
XII. — LA PESTE DE JAFFA.
ОглавлениеTable des matières
Un homme cependant, dans cette horrible enceinte,
De la terreur publique osa braver l’atteinte....
Au fond d’une tumeur par le mal calcinée,
Il puise sur l’acier la goutte empoisonnée,
Et dans sa propre veine ouverte de sa main
Infiltre sans pâlir le liquide venin.
BARTHÉLEMY ET MÉRY, Napoléon en Égypte.
En entrant dans l’année 1799, nous ne ferons qu’indiquer le combat de Souâgni, qui eut lieu le 3 janvier; et le 22, le combat de Samanhout. Le 6 février, le général Bonaparte ouvrit la campagne de Syrie. Le 9, prise d’El-Arisch et de ses magasins; le 12 eut lieu le combat de Kéné, où fut défait complètement Osman-Bey. Le 17, combat d’Aboumana. Le 25, prise de Ghaza et d’une grande quantité de munitions de guerre. Le 3 mars, combat de Souhama. Le 4, l’armée française est devant Jaffa, l’ancienne Joppé.
Mais cette place est garnie de hautes murailles et d’énormes tours, que douze cents canonniers turcs doivent défendre. Le général en chef, qui voit dans Jaffa la clef de la Syrie, ordonne l’assaut. Après deux jours d’un bombardement énergique, l’une des grandes tours s’écroule. C’est une porte ouverte. Cependant, avant d’entrer, Bonaparte envoie un parlementaire turc au commandant de la place, qui, pour toute réponse, fait trancher la tête à l’envoyé et ordonne une sortie. Or, il y est complétement battu et sa garnison passée au fil de l’épée. L’armée entre et prend aussitôt sous sa protection tous les chrétiens qui se trouvent dans Jaffa, et qui venaient au-devant d’elle le crucifix à la main.
Mais de la garnison, deux mille hommes environ, Bédouins ou Albanais, avaient mis bas les armes, et les aides de camp Eugène Beauharnais et Croisier leur avaient promis la vie sauve. L’armée, qui manquait de vivres, et qui répugnait à garder ces prisonniers, se révolta contre ces promesses. On ne pouvait les envoyer en France, puisqu’on n’avait plus de navires; on n’osait leur rendre la liberté, parce qu’on savait qu’ils se retireraient dans les montagnes et harcèleraient les marches, déjà très-pénibles. Toute l’armée demandait que ces bandits fussent mis à mort. Bonaparte réunit ses généraux en conseil, et on délibéra trois jours sans oser s’opposer aux objections de la troupe. Pendant ces trois jours, Bonaparte résista aux cris de l’armée et aux conseils des généraux; mais il dut céder en gémissant; il laissa faire, et ces deux mille malheureux furent fusillés.
En même temps que cette triste exécution, on apprit avec épouvante que la peste était dans l’hôpital de Jaffa. Plusieurs soldats français qui s’y trouvaient en furent atteints, et ses progrès étaient rapides. On a pu voir le tableau célèbre où Bonaparte, qui visite les malades, touche les plaies d’un pestiféré. Si à l’hôpital du couvent d’Haïfa, sur la route de Saint-Jean d’Acre, Bonaparte ne fit que visiter les pestiférés, il est constant qu’à Jaffa il en toucha plusieurs en leur disant, pour les rassurer, que l’épidémie qui les frappait n’était qu’une fièvre bulbeuse; et comme ceux qui l’entouraient lui représentaient qu’il faisait une imprudence, il répondit: «C’est pour moi un devoir.»
On lit dans la biographie du docteur Desgenettes, par M. Léon de la Sicotière, dont la sincérité est inattaquable, que le général Bonaparte s’approchait de ces malheureux, et qu’il aida même à soulever un soldat dont les habits étaient souillés par l’ouverture d’un bubon. Desgenettes, qui avait fait de vains efforts pour détourner le général en chef de ces imprudences, alla plus loin. Pour rassurer de pauvres malades déjà perdus, il but dans le verre de l’un d’eux une portion de son breuvage, quoiqu’il sût que la contagion pouvait se communiquer par là. Puis, dans l’hospice d’Haïfa, pour relever l’imagination effrayée des soldats français, il s’inocula devant eux la peste: il trempa une lancette dans le pus d’un bubon, s’en fit trois piqûres à la poitrine, et par cet autre dévouement héroïque rendit le courage à toute l’armée. Desgenettes et Bonaparte étaient des hommes de foi.
On a dit aussi que Bonaparte avait fait empoisonner les pestiférés. C’est un Anglais, sans doute trompé, sir Robert Wilson, qui a le premier publié cette accusation gratuite. Chambure a publié les résultats positifs de l’information qui fut faite à ce sujet devant Napoléon lui-même; et voici sa réponse, qui résume les faits:
«J’étais sur le point d’évacuer Jaffa; déjà le plus grand nombre des malades et des blessés avait été embarqué. On me vint dire qu’il restait encore à l’hôpital quelques individus hors d’état de soutenir le transport. J’ordonnai aussitôt aux médecins de s’assembler et de me donner leur avis à ce sujet. Ils constatèrent qu’il y avait en effet sept ou huit malades désespérés, dont aucun ne pouvait passer vingt-quatre ou au plus trente-six heures. Quelques-uns même de ces malades, qui avaient leur connaissance, craignant qu’on ne les abandonnât à l’ennemi, demandaient la mort avec prières. Larrey fut d’avis que la guérison était impossible, et que ces malheureux ne pouvaient aller au delà de quelques heures; pourtant, ajouta-t-il, comme il pourrait arriver que les Turcs les trouvassent encore en vie, et qu’ils ne manqueraient pas alors de troubler leur fin par des tortures, il pensait que ce serait un acte d’humanité de les y dérober. Desgenettes fut d’une opinion contraire et répliqua que sa. profession était de guérir et non de tuer. Larrey vint immédiatement après s’être informé de ces détails et de la réponse de Desgenettes, et il ajouta qu’après tout celui-ci avait peut-être raison. Mais, continua-t-il, ces malades ne peuvent passer trente-six heures; et, si vous laissez ici une arrière-garde de cavalerie, c’en sera assez pour les protéger contre les partis avancés de l’ennemi, jusqu’à leur dernier moment. En conséquence, j’ordonnai à quatre ou cinq cents hommes de cavalerie de demeurer et de ne quitter la place qu’après la mort du dernier; ce qu’ils firent. Il paraît pourtant que Sidney Smith en trouva un ou deux respirant encore. Voilà l’exacte vérité. Wilson lui-même reconnaît maintenant sa méprise; Sidney Smith ne m’a jamais reproché un pareil acte. Et croyez-vous que si j’avais été capable d’empoisonner mes soldats, ils se seraient battus pour moi avec tant d’enthousiasme et d’amour? Croyez-vous que je serais resté une heure seulement à la tête de l’armée française? »
Haïfa ou Kaïfa fut pris le 16 mars; le 17, l’armée arrivait devant Saint-Jean d’Acre, l’ancienne Ptolémaïs. Le lendemain, cette ville fut investie et le siège signifié. Mais quoique mal fortifiée, cette place importante était défendue par une garnison nombreuse et déterminée. De plus, elle renfermait deux ennemis des Français et de leur République: l’Anglais Sidney Smith, qui était parvenu à s’évader de la prison du Temple, où les républicains l’avaient longtemps resserré ; et l’émigré Phélippeaux, ces deux hommes, officiers d’artillerie et habiles ingénieurs. Comme Sidney Smith, Phélippeaux commandait contre nous une troupe d’Anglais. Ancien compagnon d’études de Bonaparte, il épuisa toute sa science à faire échouer les efforts de son ancien camarade.
Pendant ce siège, qui devait durer soixante jours, nous ne citerons que le combat de Loubi, le 24 mars. Le 28 eut lieu le premier des huit assauts que devait subir la place. Le 31 mars, prise de Saffer, l’ancienne Béthulie; le 2 avril, deux généraux turcs sont blessés à Birambra; le 3, combat de Sour; le 6, bataille de Nazareth; le 9, bataille de Cana; le camp ennemi est pris et l’ennemi refoulé vers le Jourdain; le 16, victoire du mont Thabor; le 17 mai, levée du siège de Saint-Jean d’Acre. Bonaparte dit alors:
«Si Saint-Jean d’Acre fût tombé, je changeais la face du monde.»
Il avait médité la conquête de l’Orient. Mais Dieu, qui le réservait à la France, avait permis qu’il se trompât sur la force de cette place et qu’il ignorât les puissants ennemis qu’elle renfermait. Phélippeaux avait été tué sous les drapeaux anglais, dans une des sorties. Sidney Smith restait pour justifier le général Bonaparte d’une odieuse imputation.
A la bataille du mont Thabor, vingt-cinq mille cavaliers turcs et dix mille fantassins avaient été défaits par quatre mille Français, que commandaient Bonaparte et Kléber. Si ces quatre mille braves fussent demeurés au siège de Saint-Jean d’Acre, peut-être le résultat espéré par le général en chef eût-il été différent. Mais Dieu ne l’a pas permis.
Il fallut donc rétrograder. Dans ce retour, il y eut d’autres glorieuses rencontres, et le 14 juin Bonaparte rentra au Caire, où il réunit les débris de son armée, pour lui donner un peu de repos.
Il était resté des malades à l’hospice d’Haïfa; le général avait voulu qu’on les emmenât tous et qu’on employât à leur transport les chevaux des officiers. Lui-même, pour donner un utile exemple, avait fait beaucoup de marches à pied.
Sa rentrée au Caire fut triomphale; les Arabes le saluaient du nom de sultan Kébir (le Père du feu); et on lisait sur les murailles: «Il est arrivé au Caire le bien gardé ; il est arrivé plein de santé, remerciant Dieu des faveurs dont il le comble.»
Bonaparte avait à peine réuni et reposé ses forces, lorsqu’il apprit qu’une flotte turque de cent voiles, chargée d’une armée nouvelle et commandée par le vizir Mustapha, pacha de Roumélie, débarquait à Aboukir. C’était une occasion assez heureuse de laver la défaite subie aux mêmes lieux une année auparavant. Bonaparte s’élança à marches forcées à sa rencontre, qui eut lieu le 25 juillet 1799. Cette fois encore la discipline et la bravoure savante de l’armée française, réduite de plus de moitié, triomphèrent de la résistance furieuse mais sauvage des masses turques.
«L’ennemi, habilement refoulé de tous les points, fut écrasé par Murat et sa cavalerie. Foudroyé par la mitraille et sabré par les dragons, il ne lui resta d’autre voie de salut que de se précipiter dans la mer. Dix mille hommes y trouvèrent leur tombeau; le reste fut taillé en pièces .» Et Mustapha-Pacha, après avoir rendu, de sa main sanglante, son cimeterre au général Murat, fut emmené prisonnier au Caire.
Sept à huit mille Français avaient ainsi détruit une armée d’élite de plus de trente mille hommes.
Bonaparte revint au Caire en même temps qu’on y emmenait son prisonnier. Mais, dès lors, après l’échec de Saint-Jean d’Acre, ne pouvant recevoir de France aucuns renforts, il jugea que la guerre en Orient devenait stérile. En même temps, il recevait des nouvelles de la République qui se débattait devant une dissolution inévitable: des conspirations de tout genre, fomentées par les royalistes et les ennemis de la France, menaçaient de rétablir l’ancien ordre de choses, ce qu’on appelait l’ancien régime, sur les débris croulants du Directoire. Napoléon comprenait que sa présence était nécessaire dans ce pays que sa campagne d’Italie avait élevé si haut, et qui venait de perdre à peu près toutes ses conquêtes.
Mais il voulut donner d’abord un exemple de générosité, en recevant à quartier le petit nombre de Turcs qui restaient barricadés dans la forteresse d’Aboukir, et en leur rendant la liberté ; ce qui eut lieu le 1er août, jour anniversaire du désastre maritime d’Alboukir.
Après cela, il informa l’armée de la nomination de Kléber au commandement général; et il lui remit ses pouvoirs, en lui disant:
«Vous trouverez joints à ces instructions les papiers anglais et ceux de Francfort jusqu’au 10 juin. Vous y verrez que nous avons perdu l’Italie; que Mantoue et Turin sont bloquées. J’ai lieu d’espérer que la première tiendra jusqu’à la fin de novembre; et j’ai l’espérance, si la fortune me sourit, d’arriver en Europe avant le commencement d’octobre.»
Il exposa ensuite aux chefs de l’armée qu’il abandonnait l’Égypte avec le plus grand regret, et que l’intérêt de la patrie le décidait seul à se hasarder à travers les escadres ennemies pour la relever.
Le 18 août, il partit du Caire pour Alexandrie, où il arriva le 21; et dans la nuit il s’embarqua, avec cinq cents hommes seulement, sur deux frégates françaises. Les mers qu’il fallait franchir étaient sillonnées de toutes parts et en tous sens par des croisières anglaises. Mais Napoléon croyait que la Providence lui avait imposé une mission, cette Providence qu’il appelait son étoile, pour ne pas effaroucher son entourage, qui généralement oubliait son baptême. Il disait à ceux qui voyaient les dangers: «Ne redoutez rien: la fortune ne nous a jamais abandonnés;» et il passa sans être même soupçonné. Sa flottille entra le 1er octobre dans le port d’Ajaccio, et le 9, après quarante-huit jours de navigation évidemment protégée, il était à Fréjus.