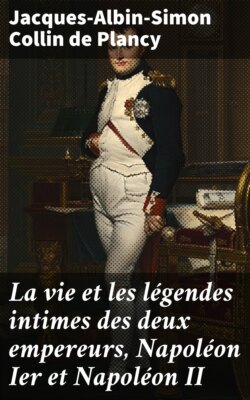Читать книгу La vie et les légendes intimes des deux empereurs, Napoléon Ier et Napoléon II - Jacques-Albin-Simon Collin De Plancy - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV. — NAPOLÉON OFFICIER.
ОглавлениеTable des matières
L’avenir était gros de tempêtes.
BARRUEL.
Lieutenant en second au 4e régiment d’artillerie, le jeune Napoléon vit avec joie s’ouvrir devant lui l’avenir qui était son rêve. Il avait conquis l’estime et souvent l’admiration de ses camarades de Brienne et de ses émules de l’École militaire de Paris; il fut parfaitement accueilli à son régiment, qui partit bientôt pour Valence. Il resta là près de trois ans en garnison, sans rien négliger de ses habitudes régulières ni de sa vie laborieuse.
«J’aimais peu le monde, dit-il à Sainte-Hélène, et je vivais très-retiré. Le hasard m’avait logé près d’un libraire instruit et des plus complaisants. J’ai lu et relu sa bibliothèque pendant trois années de garnison, et je n’en ai rien oublié, même des matières étrangères à mon état.»
Mais le jeune officier était chrétien, et chrétien pieux; les soldats, pour se le désigner, disaient: «C’est celui qui fait si souvent le signe de la croix.» Il avait horreur des mauvais livres.
C’est à Valence qu’il fit les premiers essais de ce qu’on appelle sa carrière littéraire. Et David, son peintre célèbre, avait raison de dire que, si Napoléon n’avait pas eu d’autre ressource, il eût été poëte aussi grand que Corneille, orateur aussi sublime que Bossuet, historien aussi profond que Tacite.
C’est dans cette période de trois ans, que les écrivains qui ont osé gâter par des faits romanesques, complétement imaginés, une vie si pleine de grandeur, c’est en ces jours d’actives études qu’on a dit que le 5 mai de l’année 1786, trente-cinq ans exactement avant la sombre journée de 1821, Napoléon était devenu un Werther, et que, pris du dégoût de la vie, il se disposait à en sortir comme une âme incomprise.
On a été plus loin, en lui faisant écrire des phrases sentimentales sur le suicide. On n’eût jamais imaginé rien de tel en son vivant. A Valence, Napoléon se comprenait: il sentait qu’il avait une mission. Jean-Jacques Rousseau et le Werther de Gœthe n’avaient jamais été ses lectures, et il avait le cœur trop haut pour songer un instant à une lâcheté.
Il a dit, dans O’Méara: «Le suicide est l’acte d’un joueur qui a tout perdu ou d’un prodigue ruiné. J’ai toujours eu pour maxime qu’un homme montre plus de vrai courage en supportant les malheurs qui lui arrivent qu’en se débarrassant de la vie.» Il disait encore: «Les premiers principes de la morale chrétienne et le grand devoir imposé à l’homme de suivre sa destinée, quelle qu’elle soit, m’empêcheront toujours de mettre un terme à l’horrible existence de Sainte-Hélène. »
Il paraît que le jeune Bonaparte, en ses débuts dans la vie d’officier, avait à peu près chaque année un congé de quelques semaines pour aller revoir sa famille en Corse; car on a retrouvé une lettre de lui, datée d’Ajaccio, le 1er avril 1787, et adressée au célèbre médecin Tissot, qu’il consultait pour un de ses oncles attaqué de la goutte, lettre à laquelle le docteur ne répondit pas .
On le voit, en 1789, lieutenant-colonel de la garde nationale d’Ajaccio, secondant Paoli, que Louis XVI avait chargé d’organiser la Corse. On le revoit en France, au printemps de 1791, lieutenant en premier au 4e régiment d’artillerie: il y est capitaine le 6 février 1792.
A travers la marche rapide de la révolution et les excès qui assombrissaient cette marche, le jeune Bonaparte entrevoyait des guerres qui devaient nécessairement éclater et qui s’entamaient de toutes parts autour de la France. Il sentait qu’il allait y jouer un rôle, et son cœur s’enthousiasmait. Toutefois il s’indignait de voir Louis XVI si abandonné. L’émigration avait enlevé cent vingt mille nobles qui auraient dû se serrer autour du roi, disait-il, abandonner comme lui leurs priviléges et arrêter les brigandages. Il voyait dans les émigrés des déserteurs, et il le disait tout haut. Il frémit en gémissant de la faiblesse ou plutôt de l’impuissance du malheureux monarque, qui, entouré de cœurs hostiles, faisait tomber les armes des mains des Suisses fidèles, ses derniers défenseurs; et plusieurs historiens ont raconté que le jeune Bonaparte se trouvait à Paris le 10 août 1792, et que, témoin des excès de cette journée où les Tuileries furent souillées du sang français, il s’écria: «Comment laisse-t-on cette canaille s’approcher ainsi du roi!» Il s’enfuit indigné.
Il ne savait pas que le maire de Paris et le commandant en chef de la garde nationale, et ceux qui alors entouraient le monarque, sympathisaient avec cette tourbe, qu’il nommait de son vrai nom, et qui se composait des parias de Marseille et de l’écume des faubourgs de Paris.
Après le 10 août, il voulut se retirer dans sa famille. Il y pouvait respirer, il l’espérait du moins. Ses chefs, qui devinaient ses désirs, l’envoyèrent en Corse, où la fermentation des esprits inquiétait le gouvernement d’alors.
Paoli, qui s’était, en apparence du moins, rallié à la France, se laissait séduire par les Anglais, qui ne sont pas avares de promesses, et il voulait détacher la Corse de la France, espérant en devenir le souverain sous la suzeraineté de la Grande-Bretagne.
Le jeune Bonaparte était là. Paoli, qui avait pu juger des heureuses dispositions de ce jeune homme, l’obsédait pour le détacher de la France et le rallier à ses projets. Il l’attaqua donc par les propositions les plus séduisantes. Un autre se fût laissé entraîner.
Mais Napoléon devait son éducation militaire à la France. Il était Français de cœur, et il s’indignait intérieurement à la pensée que la Corse, son cher berceau, pourrait devenir terre anglaise. Il demeurait donc sourd aux instances de Paoli, et le vieux batailleur qui l’entreprenait pouvait deviner que, fidèle à son honneur et à ses serments, le jeune Bonaparte ne songeait qu’à rejoindre son corps. Aussi, quoique toutes les côtes, excepté Calvi, fussent gardées par les partisans de l’Angleterre, sachant à l’habile officier un cœur résolu, Paoli donna tout à coup l’ordre de l’arrêter, et ses agents se mirent en marche.
Heureusement pour Napoléon, il était aimé. Un de ses amis, car il en avait de sûrs, entendant dicter cet ordre, se hâta, sans perdre un instant, de lui en faire parvenir secrètement la nouvelle. Aussitôt le jeune Napoléon, dont les résolutions étaient promptes comme l’éclair, vit que la seule voie de salut qui lui restât était de gagner la citadelle de Calvi, que les Français occupaient, et où sa famille s’était peu auparavant embarquée pour Marseille.
Le chemin était long et mauvais. Nimporte! il se rend lestement chez un berger nommé Marmotta, qu’il connaissait et qu’il savait dévoué à son nom. Il lui fait part de sa position:
«Comment! mon officier, s’écria le brave Corse, on oserait vous arrêter 1 Tant que Marmotta et ses gens pourront manier une arme, qu’on s’en garde!»
Le jeune Bonaparte prit donc la direction de Calvi sous l’escorte de quinze paysans bien armés. Dans la crainte de rencontrer les partisans de Paoli, ils durent s’écarter du chemin direct, tout mauvais qu’il était. Ils en prirent un plus affreux à travers des rochers, des maquis et des défilés où deux hommes ne pouvaient passer de front. Le premier qui allait en avant marchait en éclaireur, toujours prêt à faire feu.
La nuit étant devenue très-sombre, quand on eut franchi la chaîne de montagnes qui coupe la Corse du nord au sud, il eût été imprudent de se hasarder plus loin. Suivant donc l’avis de Marmotta, on attendit dans les maquis le lever de l’aurore, et dès qu’on vit poindre le jour, le jeune Bonaparte et son escorte s’avancèrent quatre lieues plus loin. Alors on aperçut à la distance de cinq lieues la citadelle de Calvi. Bonaparte, croyant n’avoir plus rien à craindre, s’obstina à congédier son escorte, qui insistait pour l’accompagner jusqu’au bout. Il tendit affectueusement la main à Marmotta, et après avoir témoigné généreusement sa gratitude aux braves qui l’avaient protégé jusque-la, il poursuivit tranquillement sa route.
Le chemin devenait moins âpre. Il voyait Calvi à une heure de marche, lorsqu’il aperçut assez loin, à sa droite, une colonne d’infanterie, précédée d’une nuée d’éclaireurs. Jugeant bien que c’était un corps qui venait entreprendre le blocus de Calvi, il quitta la route, se jeta dans des gorges profondes, où il perdit de vue la citadelle, et s’égara tout à fait dans les rochers. Après avoir assez longtemps erré, il rencontra un jeune homme qui chassait devant lui un mulet chargé de bois:
«Mon ami, lui dit-il, suis-je encore loin de Calvi?
— Non, signor. Quand vous aurez gravi cette montagne qui est devant nous et qu’on appelle la montagne Noire, vous apercevrez Calvi qui n’en est pas loin.
— Merci! Mais je suis étranger; voudriez-vous me servir de guide pour me tirer de ces chemins où je m’égare?
— Rien n’est plus facile, car je m’en retourne à Calvi.
— Eh bien, j’accepte. Songez seulement que l’ennemi rôde dans les environs, et si vous me trahissez, malheur à vous!
— Fiez-vous à moi, vous dis-je, je vous engage ma parole. Vous devez savoir qu’un brave Corse n’y a jamais manqué. Et d’ailleurs, ne vous eussé-je rien promis, ou l’intention de vous nuire fût-elle dans mon esprit, soyez sûr que je me rirais de vos menaces.»
Ces derniers mots produisirent sur le jeune lieutenant une impression agréable. Il s’abandonna à son guide inconnu, et trois quarts d’heure après il entrait dans Calvi.
Il remit à son guide deux pièces d’argent, qu’il eut de la peine à lui faire accepter. Puis, comme le caractère franc de ce jeune homme lui plaisait, il s’avisa de lui demander son nom.
«Je m’appelle Napolino, répondit le guide.
— Napolino! C’est un nom que je n’oublierai pas. Venez me voir à Paris, dans dix ans; j’y serai.»
Napolino s’éloigna, ravi de la générosité de l’étranger, qui lui dit aussi son nom, et songeant peu au reste.
Le lieutenant monta à la citadelle, pour faire la visite exigée au commandant de la place.
Mais l’amour de l’étude entravant les droits de l’étiquette, le jeune Napoléon se mit, après avoir parcouru les remparts, à lever le plan de la citadelle. Ceux qui le virent, le prenant pour un espion anglais, crièrent si haut à la trahison, que le capitaine Louis Flach, aide de camp du commandant, vint lui ordonner de se rendre aux arrêts.
«Comment, monsieur, s’écria-t-il, j’aurai échappé à Paoli, et ici où je suis en sûreté, dans la seule place que nous ayons conservée, moi, Corse attaché à l’armée française, je subirais une punition!» Voici mon nom, ajouta-t-il en donnant sa carte à l’aide de camp.
Louis Flach n’eut pas plutôt lu ce nom, qu’il tendit cordialement la main au jeune officier, dont le frère aîné Joseph était son ami intime. Il le présenta sur-le-champ au général commandant, qui l’obligea à loger chez lui et l’admit à sa table .
Trois jours après, il s’embarqua pour la France, et nous retrouverons Napolino à l’île d’Elbe.
En apprenant que Napoléon avait rejoint sa famille et la France, les fanatiques de Paoli brûlèrent à Ajaccio la maison des Bonaparte le 18 juin 1793.