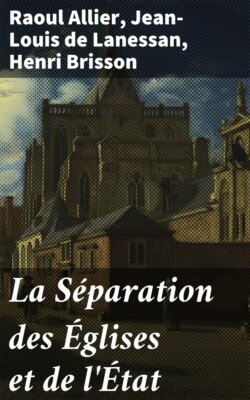Читать книгу La Séparation des Églises et de l'État - Raoul Allier - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Autres questions de propriété
Оглавление1er janvier 1905
La commission a fait sien le projet de M. Combes. Pourtant, malgré toute la complaisance qu’elle y a mise, et bien que l’adoption de ce projet ne soit pour elle qu’une tactique pour amener le grand débat à une date prochaine, elle a exigé que M. Combes lui fasse, sur des points qui ne sont pas de minime importance, quelques concessions. Elle a demandé en particulier qu’un article affirmât la propriété de l’État ou des communes sur certains biens ecclésiastiques.
M. Combes y a consenti et l’article 5 du projet amendé commence par ce paragraphe: «Les édifices antérieurs au Concordat qui ont été affectés à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres: cathédrales, églises paroissiales, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, bâtiments des séminaires, ainsi que les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes sont et demeurent propriétés de l’État, des départements et des communes.»
Une distinction est ainsi faite entre les édifices antérieurs au Concordat et ceux qui ont été construits au courant du siècle dernier. Il me paraît difficile de contester que les premiers appartiennent à la nation. Celle-ci les a mis à la disposition des Églises. Le contrat conclu arrive à son terme. La nation reprend ses biens. C’est à elle de voir à quelles conditions il convient d’accorder la jouissance de ces biens aux associations cultuelles. Pourvu que ces conditions soient suffisamment libérales, pourvu qu’elles tiennent compte de sentiments très naturels et ne contrarient pas comme à plaisir les habitudes générales des populations, on n’est pas en droit de protester contre cette exigence légitime de l’État. Nous aurons, d’ailleurs, à revenir sur ce point très important.
Ces édifices, qui appartiennent à l’État, aux départements et aux communes, ne pourront pas être concédés gratuitement aux associations cultuelles. Ils devront leur être loués à titre onéreux. Pour les autres édifices, construits depuis le Concordat, la question de leur sort futur est réglée par l’article 3 du projet. Dans sa première rédaction, cet article disposait, de la manière que j’ai étudiée, des «biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, consistoires, conseils presbytéraux, etc.». A la requête de la commission, ce texte a été, lui aussi, rendu plus précis. Il traite des biens mobiliers et immobiliers «ayant postérieurement au Concordat appartenu» aux établissements publics préposés aux cultes. Il semble donc que j’ai dit, à propos de l’article 3, tout ce qui concerne ces biens. L’État s’en constitue le gérant, — gérant paternel et autoritaire qui aura mille prétextes d’intervenir sans cesse dans les affaires ecclésiastiques et n’en prétendra pas moins avoir accompli la fameuse séparation.
Mais ce projet est un nid à surprises. Quand on croit en avoir fini avec une difficulté, on trébuche sur une autre. L’article 3 traite, avec l’ironie juridique que l’on sait, de la concession gratuite et précaire qui pourra être faite de ces biens à leurs possesseurs actuels. Puis il ajoute: «Ne pourront être compris dans ces concessions... les immeubles provenant de dotations de l’État, qui lui feront retour.» Que signifie cette restriction? S’applique-t-elle à des immeubles qui auront été donnés entièrement par l’État ou à des immeubles dans l’acquisition desquels l’État est intervenu pour une part quelconque?
Il ne faut pas se le dissimuler, cette question soulève en bien des endroits les préoccupations les plus vives. On se demande avec une inquiétude profonde ce que vont devenir tant d’églises, tant de chapelles, de synagogues et de temples qui ont été élevés avec quelque subside de l’État, mais surtout aux frais des fidèles. Ils ont été bâtis grâce à des ressources qui ont les origines les plus diverses. Si l’État ou la commune ont fait une contribution quelconque, si minime qu’on la suppose, leur possesseur actuel, fabrique ou conseil presbytéral, sera-t-il exproprié ? Ne pourra-t-il en avoir la jouissance, s’il l’obtient, qu’à titre onéreux?
Je prends des exemples. En voici, tout d’abord, deux que j’emprunte au culte israélite et que l’enquête du Siècle nous révélait récemment (3 décembre). Le consistoire israélite de Paris a construit, de compte à demi avec la Ville, les deux grands temples de la rue de la Victoire et de la rue des Tournelles. Les fidèles ont fourni une contribution de trois ou quatre millions. Seront-ils dépouillés de toute part de propriété dans ces édifices? A Sedan, on a construit, il y a quelque trente ans, une synagogue qui coûta 102.000 francs. La commune donna un terrain évalué à 17.000 francs. Elle y ajouta 6.000 francs en espèces, et l’Etat donna la même somme. Les fidèles ont donc versé 73.000 francs sur 102.000. Vont-ils être expropriés?
Autre exemple. L’Église réformée d’Albi a acheté l’immeuble qui lui sert aujourd’hui de temple et l’a aménagé de ses deniers personnels. Cette première dépense a été de 14.341 francs 76. Plus tard, à deux reprises, le conseil presbytéral a fait exécuter des travaux d’agrandissement, d’assainissement et de grosses réparations pour une somme totale, fournie par l’Eglise, de 7.932 francs 50. Depuis, le conseil général a voté trois subventions: 600 francs en 1880, 225 francs en 1887, 450 francs en 1894; et, à cette dernière date, l’État a fourni un subside de 1.800 francs. Mais les frais d’achat et de construction du temple ont été soldés uniquement avec l’argent des fidèles, sans aucune participation ni de l’État, ni du département, ni de la commune. C’est donc environ une somme de 22.000 francs que cette Église réformée a fournie, seule, contre 1.275 francs du département et 1.800 francs de l’État pour grosses réparations. Parce qu’elle a accepté cette aide modeste, va-t-elle être dépouillée?
Il serait facile de multiplier les exemples de ce genre. Et que l’on ne s’y méprenne pas. Il ne s’agit pas d’édifices religieux dont la construction remonte à des temps lointains. Ceux qui ont consenti des sacrifices pour bâtir tel ou tel lieu de culte vivent peut-être encore. S’ils ont disparu, leurs enfants ou leurs petits-enfants sont là. Ils savent ce que leur famille a fait pour l’érection de ce local. Ils s’y sentent chez eux. Ils y sont en réalité. Il est de droit commun en ces matières que ce qui est donné l’est définitivement et sans être sujet à répétition. L’État va-t-il, parce que cela l’arrange, supprimer une règle qui est constante et soutenir que les subventions accordées ne l’étaient pas irrévocablement et qu’elles sont maintenant attributives de propriété ? Qu’on y prenne garde. Si l’État élève cette prétention abusive, d’autres donateurs, lésés dans leurs sentiments les plus intimes, répliqueront par une revendication de même nature. Et ce seront d’interminables procès. Joli moyen de pacification religieuse!
Le projet de la commission avait montré dans quelle direction il faut chercher la réponse à ce problème difficile. Comme toujours, dans les cas pareils, c’est du droit commun qu’il faut s’inspirer. Le tort de la commission sur ce point a été d’indiquer la solution et de s’arrêter à mi-chemin. Le second paragraphe de son article 11 est ainsi conçu: «Les édifices postérieurs au Concordat construits sur des terrains qui appartenaient aux établissements publics des cultes ou avaient été achetés par eux avec des fonds provenant exclusivement de collectes, quêtes ou libéralités des particuliers sont la propriété de ces établissements.» Une moitié de ce texte rappelle le droit commun et l’autre l’annule.
D’après l’article 553 du Code civil, le propriétaire d’un terrain est réputé avoir élevé à ses frais et, par conséquent, posséder à titre de propriétaire, les constructions édifiées sur son propre terrain. Ce principe est formellement admis par l’administration. Il est visé, par exemple, dans la circulaire ministérielle du 15 octobre 1884, qui porte ce qui suit: «A défaut de titres ou de documents certains, la question de propriété doit se résoudre à l’aide de la présomption établie par l’article 553 du Code civil, abstraction faite de l’origine souvent multiple des ressources qui ont permis d’élever les constructions ou d’en assurer l’entretien.»
Il est donc contraire à notre droit civil et à la jurisprudence administrative de prétendre que, si la commune ou l’État a versé une somme quelconque pour la construction ou la réparation de l’immeuble, la fabrique ou le conseil presbytéral, même propriétaire du sol, sera dépouillé de son droit de propriété ? Je ne m’attache pas seulement à ce qu’il y aurait de révoltant dans une interprétation de ce genre. Certes, il y aurait injustice criante de la part de l’Etat, sous prétexte qu’il aurait versé quelques milliers ou quelques centaines de francs, à revendiquer une église ou un temple qui aurait coûté aux fidèles cinq, dix ou vingt fois plus. Mais il y aurait, en outre, violation de la lettre même du Code. Ne fondons pas la séparation sur le mépris des lois qui nous régissent.
Revenons aux principes. La commission l’a fait, quand elle a considéré comme propriété des établissements publics des cultes «les édifices postérieurs au Concordat construits sur des terrains qui appartenaient à ces établissements». Elle a eu tort d’ajouter: ou sur des terrains «achetés par eux avec des fonds provenant exclusivement de collectes, quêtes ou libéralités des particuliers». Cette restriction est inadmissible. Il serait odieux qu’une part, peut-être minime, dans l’acquisition du terrain pût autoriser l’État à revendiquer la propriété du terrain. L’État peut invoquer le droit du plus fort; mais c’est une espèce de droit qui n’a aucun rapport avec la justice.
Huit fois sur dix, quand il s’est agi de construire un édifice religieux, les choses se sont passées de la façon suivante. Avec des fonds qu’il avait sous la main ou qu’il a recueillis, le conseil presbytéral a commencé par acheter le terrain. Cette acquisition faite, il s’est adressé aux fidèles pour avoir les ressources nécessaires à la construction. C’est alors que d’ordinaire a été sollicité et obtenu le subside officiel. Ce secours ne peut pas servir de prétexte à une confiscation.
Le cas semble plus embarrassant, lorsque le terrain a été fourni gratuitement par l’État ou la. commune au conseil presbytéral ou à la fabrique. C’est ce qui est arrivé pour la synagogue de Sedan.
Remarquons qu’aux termes de la loi, celui à qui une chose a été régulièrement donnée en est propriétaire et que le corps ecclésiastique serait parfaitement fondé à revendiquer la possession qu’on lui dispute. Mais ne serait-il pas possible de trouver un moyen terme? Ne pourrait-on pas admettre que, dans le cas où le terrain a été acquis par le conseil presbytéral, il appartient à celui-ci, et que, dans le cas où il a été fourni par l’État ou la commune, l’association cultuelle, prenant la place du conseil presbytéral, pourra racheter ce terrain par une série d’annuités et restera en possession de l’édifice? Ce ne serait pas la justice stricte. Mais, du moins, ce ne serait pas l’injustice exaspérante que l’on fait mine de préparer.
Ce sont là questions. épineuses, je le sais, et qui, pour l’instant, intéressent moins le public que le mystère de la mort de M. Syveton ou les dernières «créations » de l’automobilisme. Mais, dans un an, un autre «Salon de l’automobile» aura fait oublier celui de cette année, et l’on ne parlera sans doute plus de madame Syveton et de son glorieux époux. Mais dans un an, si la séparation est votée, il y aura, dans chaque commune de France, la paix des esprits ou une sorte de guerre civile. Et ceci me préoccupe un peu plus que tout le reste.
Je connais un village, dans les montagnes de la Lozère, où une population très pauvre a construit son temple au siècle dernier. Les gens ont donné peu d’argent: ils n’en avaient presque pas. Mais ils ont apporté le travail de leurs bras. Un tel, par exemple, qui n’avait rien en poche, a charrié sur son dos du sable de la rivière; et ç’a été sa façon de contribuer à la construction de l’édifice. Malgré tout, on manquait de fonds pour acheter le terrain. Alors les familles du village ont procédé à une adjudication des bancs; et chaque banc, dans ce temple bâti par les fidèles, appartient à la famille qui l’a payé ; et celle-ci le tient pour une propriété réelle, qui figure dans les partages, que l’on loue, que l’on vend, que l’on lègue. La prise de possession par l’État entraînerait une foule de procès. Les familles ne se contenteraient pas de revendiquer le bois de leur banc, mais encore son emplacement et jusqu’à la fraction de l’édifice construit, dans un but déterminé, avec leurs deniers. Ce que je sais surtout, c’est qu’une confiscation brutale de cet édifice provoquerait un sursaut de colère dans une population qui n’a jamais cessé, dans toutes les élections, de soutenir de ses votes la République.
Il est de l’intérêt de la République que la séparation contribue à ramener parmi nous un peu de paix religieuse. Et cette paix ne sera possible que par l’équité bienveillante.