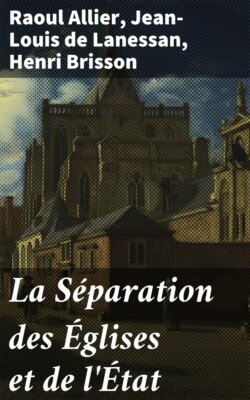Читать книгу La Séparation des Églises et de l'État - Raoul Allier - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÉFACE
ОглавлениеTable des matières
Les lecteurs du Siècle connaissent et les précieuses enquêtes de M. Eric Besnard sur la séparation des Églises et de l’État et les observations si pénétrantes, si fermes et si libérales à la fois de M. Raoul Allier sur le même sujet. En les réunissant au moment où s’ouvre devant les Chambres la discussion des projets relatifs à cette grande réforme, le Siècle apporte sa contribution au débat. Il ne fallait point d’ailleurs que de tels documents et une argumentation aussi éloquente demeurassent perdus dans la collection d’un journal. A la fin de ce recueil, M. de Lanessan doit faire l’analyse et la critique raisonnée des opinions de nos évêques, de nos pasteurs, de nos rabbins, des représentants des divers cultes et aussi des amis de la libre-pensée interrogés par M. Besnard. On me demande d’en écrire la préface et je le fais bien volontiers, afin de prendre aussi ma part dans cette œuvre de la séparation qui couronne, dans la politique, la longue besogne de sécularisation, c’est-à-dire d’indépendance spirituelle, que la science, les lettres, l’école accomplissent depuis des siècles.
Au moment où je prends la plume, de jeunes amis qui fouillent dans les papiers que j’amasse depuis plus de quarante ans me mettent sous les yeux un article de revue publié par moi en 1868; il est intitulé : La Révolution et le salaire des cultes; naturellement, j’y concluais à la séparation. De me dire aussitôt que, s’il est pénible, douloureux même de vieillir, à cause de ceux qui nous quittent, la prolongation de l’existence offre pourtant quelques compensations: la plus douce et la plus haute est de voir mettre en action ce que nous avons pensé.
Je relis cet article; les arguments n’ont pas changé ; ils étaient tout aussi forts en 1868 qu’en 1905; peut-être même trouvaient-ils quelque avantage à se présenter en toute sérénité d’esprit et à ne point être frottés des ardeurs de la polémique. Ce qui a changé, c’est l’état des âmes, des esprits, des partis, de la volonté populaire. Ce qui a changé, c’est que la séparation n’est plus une thèse; elle est un fait; elle vit, elle marche, on la voit. Et le monde attentif regarde la France accomplissant ce grand acte, la fille aînée de l’Église rejetant le papisme dont le poids a pesé si longuement, si lourdement, et pèse encore sur sa vie intérieure, sur sa destinée extérieure.
Les arguments n’ont pas changé, disais-je. En 1868, il y a trente-sept ans, un orateur avait dit, au Corps législatif de l’empire, que «le salaire du clergé était une dette inviolable de l’État, inviolable autant que la rente inscrite sur le grand-livre». Je le réfutais, et j’ajoutais ce qui suit:
Non! Le clergé n’existe pas! Il n’existe pas plus que la magistrature. Et si demain sa dotation était supprimée, cette suppression ne blesserait aucun droit. Comment y aurait-il un droit, en effet, puisqu’il n’existe même pas de sujet sur la tête de qui puisse reposer ce droit?
Sans insister sur ce point, par quelle aberration peut-on assimiler le salaire du clergé aux rentes inscrites sur le grand-livre? Cette assimilation suppose qu’à un moment quelconque les propriétés affectées aux établissements religieux ont eu le même caractère que les propriétés individuelles. Chose qui n’a jamais été vraie, même sous l’ancien régime. Depuis Charles Martel jusqu’à Louis XVI, nombre de biens ecclésiastiques ont été affectés à différents services publics, civils et militaires, donnés, engagés, vendus par l’État à des particuliers, et ce, sans le concours de l’autorité religieuse. Les établissements religieux étaient envisagés au temporel comme tous les autres établissements d’utilité publique; la puissance civile les créait sous ce rapport; elle les dotait ensuite, soit directement, soit en permettant aux particuliers de les doter, à sa décharge et dans l’intérêt de certains services, mais en se réservant toujours le droit de les supprimer, comme elle l’a fait souvent, et de donner aux biens détenus par eux une autre destination.
Aussi fut-il surabondamment prouvé à la Constituante que les établissements ecclésiastiques n’étaient ni propriétaires, ni possesseurs, ni même usufruitiers des biens placés entre leurs mains, qu’ils n’en étaient que les administrateurs, délégués à de certaines causes par la puissance publique. Le clergé de France n’avait point d’ailleurs de propriété collective; aucune loi n’avait fait du clergé un corps permanent dans l’État: aucune loi surtout n’en avait fait un propriétaire. Où serait donc la source de cette propriété qu’on veut lui constituer aujourd’hui? Par quelle filiation d’idées arrive-t-on à présenter le salaire actuel des ministres du culte comme une indemnité qui serait éternellement due à je ne sais quel être de raison? Indemnité de quoi, puisqu’il n’a jamais été propriétaire?
Ce serait une erreur en effet de croire que la Constituante ait, en cette matière, rompu en visière avec les idées de la vieille monarchie française. Elle les a appliquées au contraire, et ç’a été là sa faute; elle a envisagé la religion comme un service public; elle n’a fait que transformer la dotation de ce service. La motion de Mirabeau, votée le 5 novembre 1789 par l’assemblée, était ainsi conçue:
«Tous les biens du clergé sont à la disposition de la Nation, à la charge de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres.»
Envers qui la Nation prenait-elle cet engagement? Envers elle-même. Elle ne pouvait pas le prendre vis-à-vis du clergé, car le clergé, comme ordre politique, était dissous par le vote par tête et par sa fusion volontaire dans la Constituante; comme propriétaire, il n’avait jamais existé. Conséquemment, nul contrat avec lui. Comme ordre politique, il était naturellement soumis à l’opinion publique et aux volontés du peuple sur la meilleure organisation de l’État. Quant aux établissements religieux détenteurs de certains biens affectés à des services donnés, ils en étaient dessaisis puisque la Nation, persévérant alors dans de vieilles conceptions, assumait pour plus ou moins longtemps la charge de doter directement ces services. Mais comment l’Assemblée constituante aurait-elle pu aliéner les droits des générations futures à appliquer un jour leur propre manière de voir sur le rôle de l’État et sur ses devoirs? Tant qu’ils considéraient les cultes comme un service public, les représentants de la Nation pouvaient en charger l’État; mais où auraient-ils puisé le droit de l’en charger indéfiniment et de grever les contribuables français, même pour le jour où ils auraient cessé de considérer le culte comme une charge publique? Les biens des établissements ecclésiastiques étaient la propriété de la Nation; le salaire des cultes est le bien des contribuables. On se trompe donc gravement, dit un des chrétiens les plus fervents de notre temps (M. Edmond de Pressensé), quand on considère l’Église catholique et l’État comme faisant en 1789 un pacte nouveau à certaines conditions non-résolutoires, si bien que le salaire du clergé serait une indemnité due à cette Église en échange de l’aliénation de ses biens; il ne s’est rien passé de pareil à cette époque; l’État a usé de son droit en supprimant une corporation qui n’avait plus sa place dans la société nouvelle; rien ne devait l’empêcher de supprimer plus tard le salaire des cultes s’il le trouvait bon pour compléter ses premières réformes.
La Nation ne s’engageait donc qu’envers elle-même. C’est pour elle qu’elle créait le salaire des cultes; c’est à elle qu’elle le paye. Elle est sa créancière et sa débitrice; elle peut annuler cette dotation le jour où il lui plaira. Elle l’avait annulée en l’an III, et toute la période directoriale s’est passée sous le régime de la séparation de l’Église et de l’État.
Dira-t-on que le Concordat est venu modifier cette situation, qu’il a créé un titre au clergé ? Mais le Concordat ne saurait lier le pays jusqu’à la consommation des siècles. Il procède de la même idée que la motion adoptée par la Constituante, à savoir que la religion est un service public. En contractant avec le Saint-Siège, c’est-à-dire avec une puissance étrangère, le Premier Consul, pas plus que la Constituante, ne pouvait aliéner valablement les droits des générations futures en ce qui concerne l’organisation de l’État. C’est là un de ces droits qui ne peuvent pas faire l’objet d’une convention internationale. Qui ne sent que si, demain, à la suite de désastres militaires ou autrement, la France s’engageait par traité à demeurer toujours ou en monarchie ou en république, cet engagement serait nul? Le Concordat contient de même une clause viciée par essence, ou qui du moins a besoin d’une ratification incessamment renouvelée. Elle peut donc être rapportée d’un jour à l’autre. Le Pape et le Premier Consul se sont mutuellement donné par le Concordat ce qui n’appartenait ni à l’un ni à l’autre: le premier a aliéné la liberté de conscience, le second celle des citoyens. La souveraineté nationale peut toujours reviser de tels pactes.
Il est donc inexact de présenter les ministres actuels des cultes comme les créanciers de l’État; ils n’ont succédé ni à des propriétaires indemnisés, ni à des prédécesseurs investis d’un droit incommutable. Il n’y a point en France de corps ni de fonctionnaires investis d’un privilège de cette nature. Sous le régime du suffrage universel surtout, il ne saurait y avoir dans notre pays que des services qui peuvent être supprimés et des serviteurs qui peuvent être congédiés. Tout ce que l’on peut dire, c’est que si la Nation supprime un service et congédie des serviteurs, sans motifs qui leur soient personnels, elle sera chargée, dans une certaine mesure, d’assurer leur sort d’une façon provisoire et individuelle, de manière soit à leur faciliter la transition à un nouvel état, soit à les empêcher de finir leurs jours dans le dénuement; on peut faire valoir, en leur faveur, qu’il y a un engagement; mais ce sont là des engagements limités à une certaine catégorie de personnes, qui s’éteignent avec chacun des individus intéressés, qui prêtent à l’interprétation et à l’arbitrage, suivant le mérite ou le démérite de chacun d’eux, suivant leur situation personnelle et la durée des services qu’ils ont rendus, selon enfin que l’ordre de choses détruit leur conférait ou non l’inamovibilité. Ils ont pu légitimement croire à la permanence de cet ordre de choses; mais elle ne leur était point garantie, ils n’y avaient aucun droit. Aussi, quelle distance entre l’idée de cette liquidation, plus humaine encore que juridique, de certaines situations individuelles, et cette prétention que l’Église aurait éternellement droit, pour ses lévites, à la manne du budget! Quelle différence entre cette série de mesures équitables, applicables dans certains cas, et la comparaison des ministres des cultes avec les rentiers de l’État, pourvus d’un titre qui mentionne le prêt par eux fait et qu’ils peuvent aliéner à des tiers!
Voilà donc la question déblayée de ces ridicules affirmations. La religion peut, sans iniquité, devenir un service privé. L’équité commande même qu’elle devienne un service privé : le régime des concordats comporte toujours en effet une influence réciproque de la religion sur la politique et de la politique sur la religion. C’est là ce que repousse la raison moderne.
La religion, en effet, n’ayant pas d’autre objet que la recherche de l’origine et de la fin des choses, ne peut donner, des questions qu’elle embrasse, que des solutions hypothétiques. Or, la première condition de toutes les sciences, des sciences morales et politiques comme des autres, est la possibilité d’arriver à la détermination de lois générales acceptables par tous les esprits. Les croyances religieuses ne peuvent donc être ni l’origine ni l’objet de la loi civile, il est impossible de leur attacher, soit passivement, soit activement, l’idée d’obligation. La société politique et les associations religieuses doivent, par cette raison, être indépendantes. Le citoyen prétend avec justesse ne pas être obligé dans la vie civile par une hypothèse théologique, et le croyant répugne non moins raisonnablement à être réglementé par l’État dans sa foi, dans sa manière d’honorer Dieu et de choisir ses ministres. Celui-ci voudrait introduire le système électif dans la nomination des évêques; mais, quoi! si les fidèles préfèrent le mode discrétionnaire? Et réciproquement.
Tout concordat blesse et le droit politique et la liberté religieuse. Il fait de la religion une institution publique, une subdivision du pouvoir; il légifère sur les choses de la conscience. Il impose aux incrédules des obligations diverses que les croyants seuls doivent pouvoir s’imposer ou ne pas s’imposer à leur gré. Il livre l’État à l’Église et l’Église à l’État, suivant les circonstances. Il ouvre les codes à des pénalités spéciales qui entravent la discussion philosophique. Il cimente, au détriment de la liberté, l’union des deux pouvoirs, ou bien il organise entre eux une lutte, tantôt sourde, tantôt éclatante, toujours funeste. Il justifie la puissance temporelle du pape; car la dépossession du Saint-Père n’est qu’un épisode particulier de l’indépendance réciproque du temporel et du spirituel. La séparation de l’Église et de l’État peut seule consommer la ruine du droit divin, affranchir la conscience de tout pouvoir extérieur et le citoyen de toute autorité non consentie. Elle doit être le premier principe du parti libéral.
Du parti libéral, pouvais-je écrire il y a trente-sept ans; et, en effet, je citais comme partisan de la séparation M. Edmond de Pressensé ; M. Édouard de Laboulaye, que ses écrits mettaient alors à la tête du parti libéral, s’était prononcé aussi pour la sécularisation complète de l’État. Il semble aujourd’hui que les libéraux, ou du moins ceux qui prennent ce nom, n’en soient plus. Cinquante-cinq années de fonctionnement de la loi Falloux et surtout dix ou douze ans de pratique de la politique du «ralliement» les ont jetés de l’autre côté. Auront-ils la force de revenir à leurs premières amours, qui furent les nôtres? On ne sait. Ils ne savent. Ils grognent, ils boudent; ils écrivent «souvenirs et regrets». Leur oreille est encore charmée par les toasts du cardinal Lavigerie et la Marseillaise des Pères Blancs. Cette rhétorique lénifiante, cette musique héroïque jusqu’à eux, mais devenue laxative grâce à ces moines, leur ont-elles pour jamais fait perdre le goût des breuvages d’antan? Ils pleurent Léon XIII. Ah! disent-ils, en voilà un qui n’aurait jamais écrit la Note pontificale du 28 avril 1904!
Peut-être; mais elle a été écrite, cette malheureuse note sur le voyage de M. le Président de la République en Italie. Elle a frappé en plein visage la nation française dans la personne de son premier magistrat. Je disais plus haut que, dans cette affaire, tout avait changé, sauf les arguments de raison. Eh bien, c’est la Note, la fameuse note, l’irréparable note, qui a tout changé, qui a fait de la séparation, thèse doctrinale, une nécessité impérieuse.
Tout à l’heure, je me permettais de reproduire ce que j’écrivais sur cette thèse, en 1868, sous l’empire, comme écrivain de l’opposition républicaine, à trente ans.
Vingt années plus tard, en 1885, à cinquante ans, me voilà président du Conseil, ministre de la justice, avec la grosse affaire du Tonkin sur le dos. Je sens que je ne puis pas faire la séparation; mais je ne veux pas laisser périmer ce postulat du parti libéral et républicain, et je m’en explique en ces termes, le 8 septembre, devant les électeurs parisiens:
La politique religieuse,
disais-je,
n’est pas une des moindres difficultés de l’heure présente. Nous avons vu en France, et hors de France, les politiques les plus puissants et les esprits les plus résolus vaciller dans leur conduite sur cette question. C’est qu’ici l’on se heurte à des complications, à des préjugés, à des usages, (marques d’approbation) et qu’enfin, que surtout l’on risque de rencontrer devant soi ou tout au moins de se donner l’apparence de rencontrer la conscience humaine et de se heurter ainsi à ce qu’il y a de plus délicat, de plus incoërcible au monde. (Très, bien! très bien!) Disons-le pourtant, et disons-le bien haut, ce n’est là, ce ne peut jamais être qu’une apparence. Le respect de la conscience religieuse est le premier principe de la Révolution française; c’est en partie de ce principe qu’elle est néc, et son malheur a été précisément d’avoir à lutter contre le pouvoir de l’Église, c’est-à-dire contre le plus grand oppresseur de consciences que les siècles aient connus. (Vifs applaudissements) La religion en tant que religion, la religion n’est pas en cause; elle n’y a jamais été. (Non! non!) Quoi que l’avenir réserve à l’humanité, quel que soit l’empire que la science doive prendre sur les âmes, et quels que soient les progrès de cet empire, l’homme politique doit prendre les choses telles qu’elles sont au moment où il agit.
La science circonscrit ses investigations au cercle des faits positifs; arrivera-t-il un jour où l’âme humaine acceptera les mêmes limites, où l’imagination et le sentiment, moins provoqués par ce que les réalités de la vie offrent de douloureux et souvent de contradictoire, cesseront de chercher au delà de la mort de nouvelles perspectives, des consolations, que sais-je? Toujours est-il que le nombre est grand encore de ceux qui ne peuvent pas supporter le doute sur les questions d’origine et de fin et que la foi personnelle subsiste, non seulement comme un sentiment respectable devant lequel il faut s’incliner, mais qu’encore elle est à son tour, un fait, un fait positif, et que ne saurait considérer comme une quantité négligeable la sagesse des gouvernements. (C’est vrai! Très bien!)
Aussi bien n’est-ce pas là ce qui fait la difficulté, mais l’existence des sociétés religieuses et notamment de la plus puissante de toutes, de l’Église catholique. L’Église, autrefois, gouvernait et réglait de haut toutes choses; rien n’échappait à son empire: ni le for intérieur, ni le for extérieur, ni la règle des mœurs, ni l’éducation, ni l’instruction publique, ni, pourrait-on dire, les sciences elles-mêmes. Depuis, que de choses ont été sécularisées, laïcisées comme on dit aujourd’hui, et qui, jadis et naguères, étaient dans le domaine de l’Église! La séparation de l’Église et de l’État, ou plutôt la séparation des intérêts religieux et des intérêts politiques, de la pensée théologique et des affaires civiles, cette séparation s’accomplit tous les jours dans l’école, dans l’administration, partout. Ce qui demeure, c’est un parti politique qui, sous le nom de religion, disposant de grandes influences, crie à la persécution toutes les fois qu’on lui enlève un moyen de persécuter autrui ou que l’on restitue à la société civile un de ses droits (applaudissements répétés) et qui donne à la fois une cohésion et une direction à toutes les rancunes, à tous les regrets ligués contre la démocratie, contre la République. Que ce parti ait trop souvent trouvé des instruments dans les chefs ou dans les membres du clergé, que ceux-ci se soient faits les agents des résistances que rencontrait la volonté nationale, c’est ce que l’on ne saurait nier. Nombre d’esprits espèrent couper court à cet état de choses en opérant tout d’un coup la séparation de l’Église et de l’État, et en supprimant le budget des cultes.
Ce serait le terme de cette évolution qui sécularise toutes choses autour de nous; nous l’avons dit bien des fois entre nous, soit dans nos entretiens électoraux, soit dans nos conférences spéciales sur le sujet; mais bien des fois aussi, une fois surtout, dans une réunion dont vous vous souvenez, je vous ai signalé les complexités et les difficultés du problème. Sans doute la séparation de l’Église et de l’État affranchira seule définitivement et la conscience religieuse et le citoyen libre-penseur, car le régime des concordats implique toujours une influence réciproque de la religion sur la politique et de la politique sur la religion; mais beaucoup de nos concitoyens semblent redouter qu’après la séparation définitive la démocratie ne retrouve, plus puissantes devant elle, plus agissantes surtout, ces forces ecclésiastiques que brident aujourd’hui dans une certaine mesure le besoin que l’Église a de l’État, la prise qu’a celui-ci sur le clergé par le temporel. Ces craintes sont-elles fondées?
Il est permis de penser que ce qui fait la puissance de l’Église, comme parti militant, c’est sa puissante hiérarchie, et de supposer que le Concordat assure dans une certaine mesure à cette hiérarchie le concours de l’État. Le jour où l’Église serait séparée de l’État, peut-être serait-elle travaillée par cet esprit de schisme et de sectes auquel semblent vouées les religions abandonnées à elles-mêmes; on peut encore penser que, dans une société comme la nôtre, où l’on n’aime pas à payer une contribution, facultative ou non, sans contrôler l’emploi de ses deniers, l’élément laïque, l’élément financier, l’élément de libre administration, prendrait le pas sur l’élément ecclésiastique proprement dit; que chaque ministre du culte serait beaucoup plus obligé de compter avec ses paroissiens qu’avec son évêque, auquel il obéit passivement aujourd’hui. Si ces prévisions étaient justes, on pourrait espérer de voir, dans un délai plus ou moins long, des associations religieuses moins bien reliées entre elles, et pénétrées peut-être d’un esprit très différent, succéder à cette force redoutable, puissamment concentrée, qui marche aujourd’hui comme un régiment, suivant la parole même d’un prélat. Si telle était la solution de la question, les âmes religieuses, qui n’ont pas besoin de tout dominer pour être vraiment libres, y trouveraient leur compte, aussi bien que les libres-penseurs et la démocratie, qui ne se sentent l’envie de persécuter personne. (Approbations nombreuses et applaudissements)
Mais il faut convenir que ce n’est là qu’une vue, presque une prédiction, et que cette vue est loin de sembler partagée par la majorité des Français. Non seulement un très grand nombre de citoyens et, parmi eux, de nos meilleurs amis, craignent que, livrée à elle-même, la grande association catholique ne devienne pour l’État républicain un plus grave péril, mais ils redoutent de blesser par une pareille mesure des usages reçus, avec lesquels la raison de nos concitoyens n’est pas partout prête à rompre, et de compromettre par là, avec la paix religieuse, la sécurité même de la République; ils pensent également que les problèmes accessoires de la séparation de l’Église et de l’État ne sont pas encore assez clairement posés dans les intelligences; (Oui, c’est vrai!) ils pensent enfin voir là de graves embarras au-devant desquels ce n’est pas le moment de courir. Ils disent par surcroît, — et c’est là ce qu’il y a de plus vrai, — que la propagande n’est pas encore suffisamment faite sur cette question. (Oui! oui! — C’est cela!)
Ce sont là, messieurs, de grosses, de sérieuses objections; la plus grosse, en fait, c’est que la majorité des Français, à l’heure où je vous parle, paraît ne pas vouloir de la séparation de l’Église et de l’État. Cette objection elle-même n’entame pas mes convictions personnelles sur ce point. (Applaudissements)
Notre devoir, sur cette question, demeure celui-ci: défendre énergiquement les droits de la société civile; tenir les ministres du culte écartés de l’école et de la politique. On ne soupçonnera pas de faillir à ce devoir le ministère qui a rendu le Panthéon à sa destination laïque. (Non! non! Bravos. Double salve d’applaudissements)
Si j’ai reproduit, dans cette préface, mon écrit de 1868 comme écrivain de l’opposition et mon discours de 1885 comme président du Conseil; si j’ai reproduit, telles qu’elles furent notées alors, les marques d’adhésion de mes auditeurs, ce n’est pas pour montrer la persistance de mon opinion sur le sujet. C’était d’abord pour reproduire les raisons d’ordre intellectuel et d’ordre politique, qui militent en faveur de la séparation, pour rappeler aussi les objections, les scrupules, les craintes, si l’on veut, qui s’élevaient contre elles, je dis dans les rangs républicains. De 1868 à 1885, je l’ai dit, l’état de la question n’avait pas beaucoup changé.
Vingt années se sont écoulées de nouveau depuis 1885, et la situation n’avait guère changé davantage; ni les électeurs, ni les majorités, ni les gouvernements, même les plus avancés, n’avaient osé pousser à la séparation. M. Waldeck-Rousseau avait conclu au maintien du Concordat; M. Combes aussi à ses débuts. L’exécution de la loi du Ier juillet 1901, la loi sur la suppression de l’enseignement congréganiste, avaient bien tendu les rapports entre l’Église et l’État; elles ne semblaient pas devoir nous conduire à la rupture. Les aventures des évêques de Dijon et de Laval ne paraissaient pas non plus, bien que fortement grossies, devoir amener à cette brusque conclusion. Tout-à-coup éclate la Note pontificale du 28 avril 1904 sur le voyage de M. Loubet en Italie. A cette lueur d’éclair, le peuple français, le pays républicain, ont revu, comme ramassée en un raccourci puissant, toute la politique néfaste où le papisme a entraîné la France depuis plus de cinquante ans: l’expédition de Rome et ses conséquences, — notre isolement de 1870, — la démence des évêques français pétitionnant en 1871, quand l’ennemi campait encore sur notre territoire, en faveur du rétablissement du pouvoir temporel par les armes françaises; — les pèlerinages provoquants conduits à Rome par nos jésuites; — la Triple-Alliance nouée par Victor-Emmanuel à Vienne et à Berlin, au lendemain d’une de ces provocations; — le 24 mai; — le 16 mai; — le Sacré-Cœur; — la Boulange; — le Nationalisme; — les scènes de Reuilly et d’Auteuil, etc., etc.
Tous ces désastres, tous ces périls extérieurs et intérieurs, le voile hypocrite et pieux du «ralliement» les masquait depuis une dizaine d’années; mais le voile était déchiré, la nue s’entr’ouvrait, une lumière crue tombait, et sur les naïfs qui avaient célébré «l’esprit nouveau», et sur les conspirateurs, sur les dupes et sur les complices. Plus un coin d’ombre où se cacher.
La rupture des relations avec le Vatican ne suffisait plus. La séparation s’imposait. Elle s’imposait si fort que, même après la chute de M. Combes, un ministère nouveau, dont quelques-uns peut-être caressaient la venue dans l’espoir d’écarter la séparation, se trouve conduit à la pousser du même effort que son prédécesseur.
Le projet est prêt, le rapport est déposé ; la discussion est ouverte; malgré les efforts d’opposition et d’obstruction dont nous allons être les spectateurs, il paraît bien difficile que la séparation ne l’emporte pas, au Sénat comme à la Chambre, dans un délai relativement court.
Heureux ceux qui sont jeunes! Ils verront le développement de la lutte qui s’ouvre; car ce n’est point une fin, c’est un commencement. La papauté me semble arrivée à l’une de ces crises qui marquent son histoire: l’hérésie des Albigeois, le schisme d’Orient, la Réforme, la philosophie du dix-huitième siècle. A chacune de ces secousses, elle a su trouver de nouvelles forces pour reconquérir tout ou partie du terrain perdu; car, il ne faut pas se le dissimuler, l’histoire du dix-neuvième siècle est l’histoire de la réaction catholique. Déjà Macaulay pouvait écrire, en 1840, que le pouvoir de l’Église sur les cœurs et les esprits était bien plus grand alors qu’au moment où paraissait l’Encyclopédie. Qu’aurait-il dit, au moins de la France, s’il avait vu l’expédition de Rome, la loi de 1850, les pèlerinages de Lourdes, l’érection du Sacré-Cœur et, pour couronner le tout, une fraction du parti républicain abjurer comme Henri IV?
La papauté s’est-elle crue la maîtresse au point d’avoir volontairement provoqué la crise nouvelle? Il semble aujourd’hui qu’il y ait eu chez elle plus d’imprévoyance que de véritable calcul. On a sur ses dispositions actuelles des rapports contradictoires: elle oscillerait de l’intransigeance la plus farouche aux transactions les plus modestes. En fait, elle attend; elle va voir ce que sera la discussion, ce que seront les votes; probablement, elle prépare quelque action souterraine, et c’est là ce sur quoi les républicains feront bien de veiller.
Quant à nos évêques, ils battent l’estrade. A Rennes, on parle de chouannerie; à l’autre bout du territoire, l’évêque de Tarentaise rêve d’une sorte d’inquisition au petit pied; tout cela n’est pas sérieux.
Deux points doivent préoccuper les esprits attentifs:
Je parlais tout à l’heure d’une action souterraine où le papisme doit avoir la main: à la suite d’incidents que la presse catholique cherche à prolonger, il peut essayer de remettre la main sur l’armée et des mesures récentes ou proposées pourraient, de ce côté, lui donner quelque espoir.
Enfin, l’on peut se demander si la séparation de l’Église et de l’État sera bien faite tant que l’École ne sera pas réellement séparée de l’Église et que celle-ci pourra, sous des masques divers, élever les générations futures et donner surtout cet enseignement où se forment les cadres de la Société. On assure que, dans certaines administrations, des postes élevés appartiennent à des hommes que leur éducation a dû plutôt incliner à souhaiter le succès de l’Église que celui de la République laïque. Au Sénat, récemment, une campagne était entreprise pour concentrer l’enseignement entre les mains de l’État ou d’instituteurs agréés par lui; cette campagne échouait devant l’indifférence et même l’opposition du gouvernement; mais alors, le coup de foudre de la note pontificale du 28 avril 1904 n’avait pas éclaté, le ministère et l’ensemble du parti républicain n’avaient pas pris parti pour la séparation. Aujourd’hui qu’une impérieuse nécessité les a conduits à cette résolution si grave, il est permis de se demander si la République pourra laisser longtemps, au milieu de la France enfin affranchie, cette citadelle de la loi de 1850, de la loi Falloux, d’où le papisme est sorti victorieusement et d’où il pourrait sortir encore pour reprendre tant de positions perdues?
Je me rappelle avoir dans ma jeunesse habité quelque temps Deïr-el-Nehas, sur les bords du Nil, en un lieu presque désert, auprès du Vieux-Caire.
Je me trouvais là, pour ainsi dire, au carrefour de quatre religions, et lesquelles!
De l’autre côté du fleuve et par dessus l’île des Roses, pleine d’ibis et de tourterelles, j’apercevais de ma fenêtre le Sphinx et les trois grandes Pyramides, vestiges écrasants de ce polythéisme que la Grèce devait affiner en lui donnant, après la pérennité de la masse, l’immortalité plus sûre du nombre et de la beautés.
A quelques pas de ma demeure, le point où la légende veut que Moïse ait été retiré des eaux.
Non loin, les ruines de la mosquée d’Omar, le conquérant musulman de l’Égypte.
D’un autre côté, l’arbre où l’on assure que, durant sa fuite, la Sainte Famille s’est arrêtée.
J’étais seul, et dans cette solitude, mère de liberté et de sincérité, je me sentais envahi par cette pensée d’Auguste Comte: l’Humanité se compose de plus de morts que de vivants; je n’éprouvais alors, je n’éprouve encore que du respect pour ces vastes systèmes de théologie et de métaphysique sous lesquels la pensée et l’activité de nos pères se sont abritées et se sont complu.
Mais, en poursuivant mes voyages, j’ai vu trop souvent, au front ou au pied des monuments élevés par les religions, la trace des guerres qu’elles se sont livrées, du sang qu’elles ont versé, des désordres qu’elles ont causés, des crimes qu’elles ont commis, et j’ai compris pourquoi les hommes cherchent en dehors d’elles et la règle des mœurs et les principes du gouvernement des sociétés, ou, lorsqu’ils leur demandent le réconfort de leur vie intérieure, s’efforcent de les confiner, privées d’armes politiques, dans un domaine purement spirituel.
HENRI BRISSON
10 mars 1905.