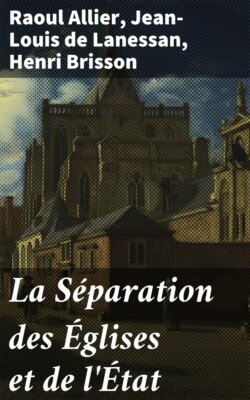Читать книгу La Séparation des Églises et de l'État - Raoul Allier - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеXII
Table des matières
Les édifices antérieurs au Concordat
15 janvier 1905
Des discussions épineuses, en dépit d’un texte qui prétend tout trancher, ne manqueront pas de surgir à propos des édifices religieux qui ont été construits depuis le Concordat. J’ai essayé de montrer dans quelle direction il faut chercher la solution pacifiante des problèmes posés. On ne se disputera pas moins à propos des édifices antérieurs au Concordat. Mais, sur ce sujet, le débat sera d’une autre nature. Il ne peut se terminer par un simple appel aux principes de notre droit présent et écrit. Il se complique, et beaucoup, de considérations historiques.
A qui appartiennent les édifices en question? M. Combes avait négligé, dans la rédaction primitive de son projet, de se prononcer sur ce point. La commission l’a trouvé trop discret. A sa demande, l’article 5 du projet a été complété de la façon suivante: «Les édifices antérieurs au Concordat qui ont été affectés à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises paroissiales, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, bâtiments des séminaires, ainsi que les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de l’État, des départements et des communes.»
Voilà qui est net, mais voici qui ne l’est pas moins: «C’est indûment, disait naguère la Vérité française, c’est indûment que l’État s’est adjugé les églises et qu’il en dispose comme d’un bien propre. Les églises, qui étaient autrefois, et incontestablement, la propriété des communautés diocésaines et paroissiales, aux frais desquelles et par lesquelles elles avaient été bâties, ont été attribuées expressément par le Concordat aux évêques, qui les ont transmises aux fabriques. C’est donc aux évêques et aux fabriques qu’elles appartiennent. Tel est le droit. Au point de vue de la législation actuelle, comme au point de vue du passé, il est incontestable.» Il est impossible de rêver une antinomie plus radicale que celle qui oppose cette thèse catholique et la thèse gouvernementale.
Au point de vue de la législation actuelle, contrairement à ce qu’affirme la Vérité française, le gouvernement paraît bien armé. Il y a des avis du Conseil d’État des 3 nivôse, 2 et 6 pluviôse, 9 messidor an XIII, qui ont absolument affirmé le droit de propriété des communes sur les églises et presbytères rendus au culte par la loi de germinal an X. Il ne faudrait point ne voir dans ces déclarations du Conseil d’État que de simples décisions de jurisprudence. Ce sont, à la lettre, des textes législatifs. Ils sont d’une date à laquelle le Conseil d’État avait le droit d’interpréter souverainement les actes législatifs par des avis ayant force de loi. Il n’y aurait, pour s’en assurer, qu’à porter devant le Conseil d’État actuel ou devant la Cour de cassation un cas auquel ces avis pussent s’appliquer. On serait vite édifié.
Un rédacteur du Gaulois, M. Julien de Narfon, a cru récemment (16 novembre 1904) mettre la main sur un texte qui apporterait «la preuve la plus catégorique» du droit de propriété des fabriques sur les édifices qu’elles administrent. C’est un décret du 17 mars 1809; il statue sur la destination de quelques églises, aliénées sous la Révolution, puis rentrées dans le domaine de l’Etat pour cause de déchéance de leurs acquéreurs et enfin remises à la disposition du culte catholique. En voici l’article 2, tel que le cite M. de Narfon: «Néanmoins, dans le cas de cédule souscrite par les acquéreurs déchus, à raison du prix de leur adjudication, le remboursement du prix de cette cédule sera à la charge de la paroisse à laquelle l’église ou le presbytère sera remis. Comme aussi, dans le cas où les acquéreurs déchus auraient commis des dégradations par l’enlèvement de quelques matériaux, ils seront tenus de verser la valeur de ces dégradations dans la caisse de la fabrique qui, à cet effet, est mise à la place du Domaine.»
Le texte serait intéressant; il permettrait en tous cas d’épiloguer... s’il était exact. M. de Narfon l’a reproduit, de très bonne foi, tel qu’il est inséré sans doute dans quelque livre. Mais M. Clemenceau a eu la curiosité de remonter aux sources mêmes, et il a découvert que, d’après le véritable texte du décret, le remboursement des dégradations ainsi prévues devait être fait à la caisse de la commune et non pas à celle de la fabrique (voir l’Aurore du 21 novembre 1904). Ce décret se retourne donc contre ceux qui l’invoquent. M. Clemenceau a trouvé, d’autre part, le texte du rapport où Regnaud de Saint-Jean d’Angely demandait à l’empereur de signer ce projet de décret (Aurore du 10 décembre 1904): les communes y sont seules visées comme propriétaires, et c’est visiblement à cause de leur situation financière que le remboursement des sommes dues aux acquéreurs déchus est mis à la charge des fabriques.
Donc, à s’en tenir aux textes, tels que les tribunaux les interpréteraient, la thèse du gouvernement est inattaquable. C’est pourquoi l’on invoque l’histoire et un droit supérieur à notre législation de fait. «Le Conseil d’État, dit M. G. Théry, ancien bâtonnier, dans une consultation rédigée sur la demande de l’archevêque de Cambrai, le Conseil d’État a pu déclarer par plusieurs avis que les communes étaient propriétaires des Églises. Il n’était pas au pouvoir de l’État de dépouiller légitimement l’Église d’une propriété qui était sienne et qu’il lui avait conventionnellement restituée lors du Concordat.»
Le premier point soulevé par cette objection est de savoir si le Concordat a opéré une véritable restitution. L’article 12 de la convention de Messidor porte ceci: «Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques.» L’article 75 des Organiques est ainsi conçu: «Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement entre les mains de la nation, à raison d’un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au ministre des affaires écclésiastiques.»
Les mots que je viens de souligner me paraissent avoir une importance capitale. Quand on fait une «restitution », on la fait dans la mesure de ce qu’on doit et non dans la mesure des besoins présumés de la personne à qui l’on remet un bien. Si, dans la pensée des contractants, il s’était agi de rendre ce qui avait été pris injustement, il aurait fallu le rendre en entier ou du moins en rendre tout ce qui était disponible. Le premier consul n’a consenti qu’à la remise de ce qui était nécessaire pour assurer ce qu’il considérait comme un service public. Avec les convictions que j’ai et dont je ne fais pas mystère, l’idée d’une religion ramenée au niveau d’un service public et d’une gendarmerie auxiliaire me répugne jusqu’à l’écœurement. Mais la question n’est pas de savoir ce que je puis éprouver devant l’œuvre de Bonaparte; elle est de savoir ce que Bonaparte, agissant au nom de la nation française, a prétendu faire. Or ceci n’est point douteux.
Eh! sans doute, le pape a affecté de comprendre d’une autre façon l’acte du premier consul. Et, à force de répéter cette façon de le comprendre, on a fini par en établir une interprétation qui est devenue traditionnelle. Mais si le commentaire orthodoxe était le bon, pourquoi Pie VII n’a-t-il pas exigé, avec une obstination irréductible, la totalité de ce qui avait été pris par la nation? Pourquoi a-t-il apposé sa signature au bas d’un document qui mettait à la disposition des évêques, non pas purement et simplement les églises non aliénées, mais seulement les églises «nécessaires au culte» ?
La vérité, c’est que le pape a fort bien senti qu’il y a des faits accomplis sur lesquels on ne revient pas. S’il avait prétendu revenir sur celui-là, jamais le Concordat n’aurait été signé. Cent ans se sont passés depuis cette acceptation officielle du fait. Ce n’est pas après un siècle qu’on recommence l’histoire.
On peut discuter, — et ceci, je l’accorde, — sur les événements révolutionnaires. Le 2 novembre 1789, par 568 voix contre 346, l’Assemblée Constituante décréta: «Tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres.» Il est indubitable que la Constituante n’a voté la sécularisation des biens de l’Église qu’avec le dessein de consacrer une partie du revenu de ces biens à l’entretien de cette même Église. Mais, sous la pression des événements, la Révolution devait aboutir à cette autre formule: «La nation reconnaît tous les cultes et n’en salarie aucun.» Tout a été dit pour et contre ces actes successifs. Il n’y aurait qu’un intérêt rétrospectif à le rappeler. L’historien s’intéresse à ces débats. L’électeur clérical ou anticlérical n’y comprend rien en général, même quand il prétend le contraire. Ce n’est pas son opinion réfléchie sur le passé qui détermine sa conviction et son attitude d’aujourd’hui. C’est la passion dont il vibre actuellement qui lui suggère son opinion sur le passé...
Mais il y a eu le coup d’éponge donné par Pie VII et par Bonaparte. Personne n’en peut supprimer les effets. Bonaparte, il est vrai, accordait à Pie VII le budget des cultes. Pie VII, cela n’est pas moins vrai, n’a pas spécifié que ce budget était une compensation des biens sécularisés. Si l’on soutient qu’il le sous-entendait une remarque ne sera pas inutile. Le Concordat a promis au clergé une rente de douze millions et demi. Que l’on calcule le budget réel qui a été payé, en fait, à travers tout le dix-neuvième siècle, jusqu’au jour où la séparation sera accomplie, au début du vingtième siècle. On verra qu’en plus de la somme acceptée par Pie VII il a été versé à l’Église par l’État près de trois milliards. Le total est rondelet. Il serait exagéré de dire que la société civile, à moins d’être accusée de vol, n’a pas le droit de se libérer.
Non, on ne refait pas l’histoire après un certain temps écoulé. Je suppose que des protestants viennent et disent: «A la suite de la grande iniquité de 1685, on a confisqué nos temples, nos hôpitaux, nos presbytères, nos académies, tous les biens de nos Églises. La petite part que nous avons dans le budget des cultes ne représente pas, — il s’en faut de beaucoup, — la rente de ce qui nous a été ravi. Pour ce motif, nous nous opposons à la séparation des Églises et de l’État.» Je n’invente pas ce raisonnement. Des hommes le tiennent, qui pourraient fournir les renseignements les plus curieux sur les spoliations opérées à la suite de la Révocation de l’Édit de Nantes. Aurait-il quelque chance d’être écouté ? On leur répondrait: «La conclusion dépasse les prémisses. Ce que vous pouvez demander, c’est de la bienveillance, — une bienveillance qui équivaut à de l’équité, — dans les conditions faites pour l’usage des locaux; mais il ne peut pas s’agir d’une revendication proprement dite de propriété.» Je ne distingue pas ce que l’on répliquerait justement à cette réponse.
Je conclus donc sur ce premier point. Quelle que soit notre pensée sur ce que nous aurions approuvé ou blâmé en 1789 ou en 1795, nous vivons en 1905. Or, en 1905, l’État ne consentira pas à déclarer qu’il n’est pas propriétaire des édifices ecclésiastiques antérieurs au Concordat. Il faut partir de ce fait pour chercher ensuite la fin la plus apaisante des difficultés qui persistent et que pourtant il est nécessaire de résoudre. Nous la chercherons sans parti pris.