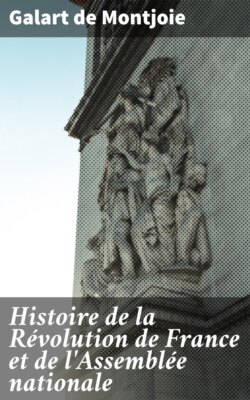Читать книгу Histoire de la Révolution de France et de l'Assemblée nationale - Galart de Montjoie - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE IX.
ОглавлениеTable des matières
Portrait de M. de Mirabeau; effet que produit son opinion prononcée dans les états de Provence; plaintes de la noblesse; protection accordée aux séditieux; portrait de M. Mounier; dispositions des esprits à Paris; manœuvres sur les grains; indécence des plaisirs du carnaval; grossières images exposées sur les quais; projet d’un mariage entre mademoiselle d’Orléans et M. le duc d’Angoulême; triomphe décerné à M. de Mirabeau aux portes d’Aix; mandemens de deux évêques; opinion du peuple sur quelques grands personnages; portrait de M. l’abbé Syeyes; menées d’un sieur Rutleidge; anecdote sur MM. d’Adhémar et de Guibert; intrigues pour les élections; tentatives de M. de Calonne pour être élu; empressement de quelques autres personnes pour obtenir cet avantage.
Février... Mars1788.
L’OPINION de M. de Mirabeau lui valut la faveur du tiers-état, et dès ce jour on n’a cessé de voir des hordes de brigands et d’assassins appuyer le succès de ses discours. On chercheroit en vain dans les fastes de l’histoire un homme qui put lui être comparé. Avide de célébrité, il semble moins jaloux d’inspirer l’estime que la terreur. Tourmenté dès son enfance, d’une inquiétude farouche, il déshonora sa jeunesse par des vices honteux, fit le désespoir de sa famille, et n’eût point d’amis. Dans un âge plus mûr, les prisons le dérobèrent au glaive de la justice. Son ame indomptable s’aigrit dans les fers, et c’est là peut-être que son caractère haineux le porta à enfanter des projets funestes. Rendu à la société, il ne cessa d’occuper de lui le public, en écrivant toujours sur les objets qui, dans le moment, fixoient davantage l’attention universelle. La bizarrerie de ses paradoxes, l’originalité de son style donnèrent une grande vogue à ses écrits. Envoyé dans une cour étrangère, il y joua bassement le rôle d’espion subalterne, et comme pour se venger de son infamie personnelle, il publia un libelle scandaleux contre le premier homme de son siècle, qui n’eut d’autre tort envers lui que de n’avoir su l’estimer. Dans ses discours comme dans ses écrits, moins éloquent qu’audacieux, moins profond qu’original, il semble lui-même chercher plutôt à insulter qu’à convaincre le parti qu’il combat; et dans la tribune aux harangues, il se montre avec la physionomie d’un baladin, encore plus qu’avec les talens d’un orateur; insensible, en apparence, aux outrages, il porte à ses ennemis des coups invisibles. Enfin, avili même dans l’esprit de la multitude, il la meut à son gré, et c’est elle qui donne tout le succès à ses harangues.
Tel est cet homme que le gouvernement eût pu acheter, et que peut-être il n’acheta pas, parce qu’il le dédaigna trop. Son opinion dans les états de Provence, fut suivie du phénomène qui depuis a accompagné ses plus importantes motions. Sortis de la salle, les gentilshommes furent environnés et insultés par des gens de la lie du peuple; M. de Mirabeau fut porté en triomphe.
Depuis ce moment, la noblesse de Provence, comme celle du reste du royaume, n’a plus eu que des affronts et des injustices à dévorer. Profondément affligée de cette première insurrection, elle déposa sa douleur dans le sein de son auguste chef; elle écrivit au monarque.
«Nous portons à vos pieds l’expression de notre fidélité et de notre douleur. Nous avons souffert des outrages… L’autorité de V.M., celle des lois sont méconnues. Le clergé, la noblesse, le président des états sont insultés.
» Nous avons fait tous les sacrifices au bien de votre service, au désir de rétablir l’union dans le pays. Nous avons même oublié cette noble et juste sensibilité, qui forme le partage de notre état; mais la fidélité que nous vous avons jurée, et la loi de l’honneur, nous imposent le devoir de ne jamais abandonner notre constitution, établie par tant de titres, et sur-tout dans le sein de ces mêmes états, où nos pères se donnèrent avec autant de confiance aux augustes prédécesseurs de V.M.
» Cet acte synallagmatique nous procure l’inapréciable avantage de vous avoir pour maître. Ce titre sacré nous assure secours et protection de la part de V.M. Nous lui demandons cette justice, cette protection, ce secours pressé. On trompe le peuple: on ose nous présenter à lui comme des oppresseurs, au moment où nos sacrifices pour l’état excèdent nos moyens, et où nous offrons des soulagemens pour la classe indigente de la nation.
» Les fauteurs des systêmes nouveaux sont trop favorisés. Ces systêmes tendent au renversement des principes de la monarchie, à établir l’égalité des rangs et des propriétés, à détruire votre autorité et la dignité de la noblesse».
Le tems a vérifié le pressentiment de la noblesse de Provence, et ce n’est pas sans sujet qu’elle se plaignoit de la protection accordée aux fauteurs des systêmes nouveaux; car le roi ayant cassé, par un arrêt de son conseil, le vœu de l’assemblée tumultuaire et illégale que le parlement d’Aix avoit déja frappé d’un décret, les membres dispersés de cette assemblée, se vantoient hautement d’une protection spéciale; ils disoient avoir des députés en cour, qui y étoient accueillis et bien traités; ils entretenoient une correspondance qu’on pouvoit dans ce moment regarder comme séditieuse, et qu’ils annonçoient comme autorisée. Cette correspondance, les écrits séditieux, et la popularité de M. de Mirabeau, réduisirent la Provence à un état déplorable.
La Bretagne, le Dauphiné et le Béarn avoient fait eu commencement des troubles, une sorte de confédération. Dès qu’il s’agit de la convocation des états-généraux, le Dauphiné se retira de l’association, et ses habitans adoptèrent d’autres principes: ils déclarèrent qu’ils se regardoient moins comme Dauphinois, que comme François; le résultat du conseil fut transcrit sur les registres des états. Les négocians de Grenoble écrivirent même à ceux des autres villes commerçantes, qu’ils n’ambitionnoient point d’envoyer des députés particuliers aux états-généraux, parce qu’ils pensoient que les membres de cette assemblée ne dévoient pas être les représentans des corporations particulières, mais ceux de la nation. Un homme qui réunissoit à un cœur pur, à une ame sensible et aimante, à une imagination riche, à un esprit orné, à une réputation enfin sans tache, la noble ambition de rendre ses concitoyens heureux, travailloit avec ardeur à les éclairer sur leurs véritables intérêts; mais il répandoit des flots de lumière, et ce n’étoit qu’une lumière douce qui pouvoit dissiper les nuages qui s’ammonceloient dans la France. M. Mounier fut cet homme vertueux que trop de patriotisme égara; il se pénétra trop des droits du peuple, et pas assez des obligations sacrées qui le lient à ses chefs. Il eût une trop haute idée d’une nation corrompue dans ses mœurs, et voulut lui faire adopter une forme de gouvernement, que le climat, le génie, les goûts, l’étenduede cette nation, proscrivoient également. Il vouloit faire des hommes parfaitement libres, et après une longue suite de travaux pénibles qui l’honoreront à jamais, il ne rencontra que de vils séditieux. Il falloit resserrer les liens qui unissoient les sujets au monarque, et soulever doucement le joug qui pesoit sur la classe infortunée; mais M. Mounier brisa et les liens et le joug. Ses écrits n’en sont pas moins précieux; ils sont pleins d’une douce philosophie qui éclaire en même tems qu’elle fait aimer la vertu, et les erreurs mêmes qu’on y rencontre font chérir leur auteur.
A Paris, on attendoit avec une extrême impatience la lettre de convocation qui devoit lui être particulière: on se méfioit toujours des iutentions du gouvernement; on craignoit, ou on affectoit de craindre des démarches hardies de la part du parlement; on s’attendoit que les membres du haut clergé s’assembleroient avant de quitter la capitale, et on paroissoit soupçonner une coalition entre eux et les magistrats du parlement.
Aucune de ces craintes ne se vérifia: la cour s’occupoit sans relâche du travail nécessaire à la tenue des états-généraux; le parlement restoit dans l’immobilité, et les prélats se retiroient paisiblement dans leurs diocèses, pour se trouver aux élections.
Les factieux seuls s’agitoient; les écrivains se divisoient en deux partis; les uns, ayant M. Cérutti à leur tête, élevoient des autels à M. Necker; les autres le croyoient dans la ferme résolution de refuser l’opinion par tête: car c’étoit là la question qu’on traitoit dans tous les cercles, dans tous les écrits.
La licence aussi étendoit ses progrès; dans un des cafés du Palais-Royal, on brûla le dernier arrêt du parlement de Franche-Comté, dont j’ai parlé plus haut; mais ce qui servoit encore mieux les séditieux, c’étoit la disette du pain; les manoeuvres qui se pratiquoient dès-lors, et qui n’ont plus discontinué jusqu’au séjour du roi à Paris, sont un des grands moyens qu’on n’a cessé d’employer pour porter le petit peuple au désespoir, et du désespoir à la rébellion. Le parlement voulut développer toute cette intrigue dès sa naissance; mais il ne put jamais atteindre l’extrêmité du fil de cette horrible trame.
Dans les fauxbourg S. Antoine et S. Marceau, dans le centre même de Paris, on afficha des placards qui menaçoient d’une sédition, si l’on ne diminuoit le prix du pain; et sur le Pont-Neuf, on distribua aux passans une feuille imprimée qui étoit une dénonciation au peuple de différens accapareurs de grains, et tous ceux qu’on y désignoit, étoient des hommes en place, et des hommes a qui, depuis, on a donné l’odieuse qualification d’Aristocrates..
Les plaisirs du carnaval donnèrent occasion au petit peuple de manifester tous les sentimens de la basse et injuste jalousie qu’on lui inspiroit contre les deux premiers ordres. Par-tout on ne rencontroit que des images qui les insultoient. Là c’étoit une voiture que remplissoient des hommes en haillons; sur le siége du cocher étoient assis deux prélats, et derrière, des particuliers décorés de cordons bleus servoient de laquais. Là c’étoit un fantôme portant sur ses épaules une sorte d’abbé sans têts, et sur la soutane duquel étoit écrit: voilà le clergé; le corps de cette hideuse figure, étoit, depuis le col jusqu’à la ceinture, couvert d’une riche étoffe rehaussée d’un cordon bleu, et sur laquelle on lisoit: voilà la noblesse. Enfin, depuis la ceinture jusqu’aux pieds, le fantôme n’étoit couvert que de guenilles, et sur ces guenilles étoit écrit: voilà le tiers-état qui ne peut se soutenir.
Tout homme bien vêtu qui, pendant ces dégoûtantes lupercales, traversoit les rues, étoit arrêté; on lui demandoit auquel des deux ordres il appartenoit, de la noblesse, ou du tiers-état; et s’il eût répondu qu’il étoit gentilhomme, il eût mit sa vie en danger.
Les murs aussi de nos quais et de nos places publiques se couvroient d’estampes grossières qui vouoient aux insultes de la canaille les nobles et les ecclésiastiques. L’une de ces estampes offroit trois figures rangées sous la même ligne qui servoit de niveau: la figure qui tenoit le milieu étoit sans vêtemens, et touchoit de la tête le niveau, et des pieds la terre; c’étoient les roturiers. La figure placée à la gauche de la première, étoit ensevelie dans la terre jusqu’aux genoux, et touchoit le niveau, au moyen d’un grand casque; c’étoit le noble. La troisième figure, enfin, étoit couverte de terre jusqu’au milieu du corps, et touchoit le niveau, à l’aide d’un long bonnet carré; cette troisième figure représentoit le clergé. On vouloit par-là donner à entendre que le tiers-état étoit tout par lui-même, et que les deux autres ordres n’étoient rien que par les avantages que le premier lui laissoit.
Ces quelques exemples, que j’ai choisi parmi ceux que la décence me permettoit de citer, prouvent que les moyens les plus méprisables n’étoient pas indifférens pour ceux à qui il importoit de déterminer le peuple a essayer enfin ses forces. L administration voyoit sans inquiétude ces séditieuses manœuvres; elle ne sembloit occupée que des préparatifs de la prochaine tenue des états-généraux; et tandis qu’on faisoit courir à Paris le bruit qu’elle étoit remise au mois de juin, la cour donnoit ordre aux commandans et aux intendans des provinces d’être rendus dans leurs départemens; aux officiers, dans leurs garnisons; et aux ambassadeurs, dans leurs cours respectives, avant le premier mai.
Le parlement, instruit des véritables intentions de la cour, convoqua une assemblée de chambres, à laquelle se trouvèrent les pairs, et où il fut pris des arrangemens pour que cette compagnie conservât un tel nombre de magistrats, que les fonctions de la justice ne fussent pas interrompues, tandis que l’autre se rendroit aux assemblées des bailliages.
Il se négocia pendant ces entrefaites un mariage qui, s’il eût eu lieu, eût peut-être apporté quelque changement aux affaires: M. le duc d’Orléans promit Mademoiselle d’Orléans, sa fille, qui n’avoit pas encore douze ans, à M. le duc d’Angoulême, fils aîné de M. le comte d’Artois, qui étoit clans sa quatorzième année. Ce mariage devoit se célébrer au commencement du mois de septembre suivant. La jeune princesse seroit retournée, après la célébration, au couvent de Belle-Chasse, et la réunion des deux époux ne se seroit faite que lorsque la princesse aurait atteint quinze à seize ans. Le prince son père lui eût assuré, le jour du mariage, 400mille livres de rentes, et le jour de la réunion, 600autres mille livres de rentes, indépendamment d’un partage dans la succession.
Il se répandit aussi, à la même époque, qu’il se négocioit avec le roi de Naples un mariage entre M. le duc de Chartres, fils aîné de M. le duc d’Orléans, qui avoit atteint alors sa quinzième année, et une des princesses de Naples. Si ces deux alliances se fussent contractées, il est vraisemblable qu’en réunissant à deux maisons souveraine la branche d’Orléans, elles eussent confondu les intérêts de cet dernière maison avec ceux des deux autres, et les mécontens eussent perdu tout espoir de trouver un protecteur parmi les Bourbons.
Leur crainte que les états-généraux ne fussent encore reculés, n’eut plus de prétexte: tout annonçoit que l’ouverture s’en ferait eu effet le27avril. Les baillis d’épées quittoient journellement Paris, et se rendoient dans leur bailliage: M. le prince de Poix fut un des premiers à se rendre clans le sien. A Versailles, on travailloit avec beaucoup de célérité aux préparatifs de la salle. Dans les provinces, on se réunissoit. M. de Thyard parut à la cour, et y vint chercher les ordres nécessaires pour la manière de convoquer les assemblées primaires: il donna l’assurance que le calme étoit rétabli en Bretagne; que les bourgeois avoient déposé leur drapeau dans son hôtel, et promettoient de s’en rapporter absolument à lui.
M. le comte de Mirabeau parut aussi a Paris; il n’y resta que quatre jours: il se répandit qu’il étoit chargé d’une mission particulière de la part du tiers-état de Provence, dont il possédoit toute la confiance. A son retour dans cette province, son entrée dans la ville d’Aix fut un véritable triomphe; la foule accourut au-devant de lui; on détela les chevaux de sa voiture, et des gens du peuple se mirent en devoir de la traîner, mais il ne voulut jamais le permettre. Son épouse, qui étoit restée à Paris, et qui, depuis long-tems n’habitoit pas avec lui, reçut une lettre fort agréable, qui lui étoit écrite au nom du tiers-état de Provence, dans laquelle on lui faisoit de grands éloges de la conduite que tenoit son mari, et on l’exhortoit à venir se réunir à lui, l’assurant qu’il auroit pour elle la même affection qu’il témoignoit à ses concitoyens du troisième ordre.
Il étoit naturel qu’à la vue de la crise qui se préparoit, les ministres de la religion exhortassent les peuples à l’union et à la concorde. Messieurs l’archevêque de Lyon et l’évêque de Clermont furent les premiers à publier des exhortations, dont le but étoit de rappeler tout-à-la-fois les vérités de la religion, qui s’effaçoient de l’esprit du petit peuple, et les principes de tout état bien ordonné, que l’on prenoit à tâche de détruire dans la multitude d’écrits, prétendus politiques, oui sortoient chaque jour des presses. Les deux mandemens furent mal accueillis par le tiers-état, parce qu’il vouloit qu’on fit plier toutes les vérités de religion et de morale au gré de ses prétentions.
Le tems d’ailleurs étoit venu de regarder comme une folie le respect envers les citoyens consacrés au service des autels, ainsi qu’envers ceux que la naissance avoit placés dans Un rang éminent. Parmi ces derniers, M. le prince de Condé étoit déjà, et peut-être sans le savoir, l’objet de soupçons odieux et d’insinuations perfides. On faisoit courir le bruit que s’il alloit dans son gouvernement, il y recevroit des mortifications; le bruit se trouva faux, car il alla en Bourgogne, et il n’y reçut que les témoignages de respect et de reconnoissance, dûs à son nom, à ses qualités personnelles et à ses services.
M. le maréchal Je Broglie étoit exempt de cette prévention vouée à tous les grands; il passoit encore pour être l’ami du peuple; on prétendit qu’ayant été invité par le roi à aller prendre le commandement des troupes qui étoient en Bretagne, il s’en étoit excusé sur son grand âge; mais qu’il avoit confié à ses amis, que le véritable motif de son refus étoit l’inébranlable résolution qu’il avoit formée de ne jamais marcher que contre les ennemis de l’état.
On exaltoit beaucoup aussi la sagesse de M. de Narbonne qui, maigre les sujets de division communs aux trois ordres, et particuliers dans le Languedoc aux membres de la noblesse, avoit su maintenir dans cette province la plus grande tranquillité.
Quant à M. le duc d’Orléans, sa faveur auprès du peuple ne faisoit que s’accroître, et il ne cachoit plus la part qu’il prenoit aux affaires publiques; il supprima les capitaineries de ses domaines, et cette suppression fut agréable, parce qu’elle portoit sur un privilège qui avoit toujours paru odieux. Il fit donner dans ses terres, et dans les bailliages qui en dépendoient, des ordres qui ne furent ignorés de personne, et qui portoient d’avoir pour le peuple les plus grands égards. Il voulut aussi que tout le monde fut instruit du parti qu’il alloit embrasser; il publia un plan d’instruction à remettre aux députés qui seroient envoyés par ses bailliages aux états-généraux; dans ce plan, le prince engageoit à demander le retour périodiques des assemblées nationales, l’égale répartition des impôts, et, ce qui étonna davantage encore, l’introduction du divorce en France. Cette dernière demande parût si extraordinaire, et on crut si peu vraisemblable qu’elle pût jamais trouver faveur dans une nation catholique, que personne ne s’arrêta alors à la combattre.
Le plan de M. le duc d’Orléans fit la plus grande sensation dans le public, autant par la nouveauté des demandes qui y étoient formées, que par la manière captieuse dont elles étoient présentées. Les partisans du tiers-état dévoroient cet écrit qui fut rédigé par M. l’abbé Syeyes, homme ignoré jusqu’alors, et qui, adoptant les opinions du moment, se fit un grand nom: versé dans les subtilités de la dialectique, aimant à s’enfoncer dans les profondeurs de la métaphisique, il donna un air de nouveauté aux idées adoptées; elles parurent séduisantes parce qu’elles humilioient les grands, et flattoient la multitude; il se plût dans ses propres conceptions, et s’il fit illusion, à ses lecteurs, c’est qu’il se l’étoit faite à lui-même. Son ouvrage intitulé, qu’est-ce que le tiers-état, parut un chef-d’oeuvre, ennivra cet ordre d’ambition, et plus qu’aucun, le convainquit qu’il étoit l’arbitre suprême des destinées du reste de la nation?
Le moment étoit propice pour tous ceux qui aspiroient à la gloire de jouer un rôle. Un homme appellé Rutleidge, qui n’étoit encore connu que par des libelles contre un de ses bienfaiteurs, voulut aussi attirer sur lui les yeux de la foule: il se fit une sorte de parti parmi les boulangers. Ceux-ci que les murmures du peuple d’une part, invitoient à diminuer le prix du pain, et que la disette des grains de l’autre, obligeoit à le rencherir, furent pressés par cet homme de mêler leurs plaintes à celles de la multitude. Il leur composa un mémoire peu respectueux, dans lequel un particulier fut désigné comme l’auteur d’un monopole qui, à l’abondance, substituoit la pénurie. Ce particulier fut représenté comme l’agent d’une société composée d’hommes en place. On promettoit en outre au peuple, dans ce mémoire, des éclaircissemens qui lui montreroient à découvert ceux qui conspiroient contre sa vie; c’étoit plus qu’il n’en falloit pour soulever les fauxbourgs.
Cette requête adressée au roi, fut présentée a M. Necker qui, connoissant peut-être mieux que personne le fil de toutes ces intrigues, refusa de prendre connoissance de l’affaire, et la renvoya au parlement. Cette compagnie écouta les boulangers qui parlèrent avec hauteur, et se tinrent renfermes dans des allégations vagues; elle entendit aussi le particulier inculpé, et après l’avoir entendu, elle fut convaincue qu’il étoit calomnié. Les boulangers alors poussèrent les hauts cris, dirent qu’ils demandoient d’autres juges que les magistrats du parlement, prétendant que plusieurs d’entre eux étoient parties intéressées dans l’affaire des accaparremens, et offrant, disoient-ils, d’indiquer les magasins secrets où les monopoleurs cachoient les grains. Ils ne prouvèrent rien de ce qu’ils avoient avancé; mais le parlement, qui n’avoit pas pu faire droit à des plaintes qu’il n’avoit pas cru fondées, n’en fut que plus odieux au peuple, et c’est peut-être tout le fruit qu’on attendoit de ces machinations.
Le syndic des boulangers, qui avoit signe le mémoire que leur avoit rédigé le sieur Rutleidge, fut attaqué un soir en rentrant chez lui; des hommes l’environnèrent et le frappèrent avec des bâtons; on ne manqua pas de dire qu’ils étoient des émissaires, ou de la société que l’écrit promettoit de démasquer, ou de la police, ou même du parlement; ainsi tous les moyens étoient bons aux calomniateurs et aux fauteurs des troubles.
Ccependant, dans toute l’étendue du royaume, les assemblées pour l’élection des députés aux états-généraux se formoient; à Paris on recueilloit, avec avidité, les premières nouvelles qui arrivoient des provinces, et on se félicitoit, comme d’autant de conquêtes, des humiliations que le haut-clergé ou la haute-noblesse recevoient dans ces assemblées. L’aventure sur-tout de MM. le comte d’Adhémar et de Guibert fit grand bruit. Ces particularités méritent d’être connues, parce qu’elles font voir dans quel esprit les peuples se préparoient à une régénération.
M. le comte d’Adhémar, en sa qualité de grand-bailli d’épée des bailliages de Mantes et Meulan, avoit indiqué non-seulement le jour, mais le lieu de l’assemblée. Le lieutenant-général de Mantes indiqua un autre lieu; M. d’Adhémar s’y rendit, et commença un discours adapté aux circonstances; il fut interrompu vivement par un membre de l’assemblée, qui cria que les préliminaires étoient inutiles, et qu’il falloit sur-le-champ délibérer sur les intérêts du peuple. M. d’Adhémar, qui avoit déja eu la déférence de se rendre dans un lieu qu’il n’avoit pas lui-même indiqué pour l’assemblée, se plaignit de ce nouveau procédé. On répondit à ses représentations par des invectives; on m’a même assuré que le lieutenant-général s’emporta jusqu’à lui faire un geste qui réimissbit l’insulte à la menace, et que si le grand-bailli n’eût pas pris le parti de se retirer, on eût converti la salle en une arène de gladiateurs.
M. le comte d’Adhémar avoit joui jusqu’à ce moment de la considération universelle, et il la méritait. Envoyé long-tems à Bruxelles, ambassadeur ensuite à Londres, il avoit montre, dans ces deux places, de grandes et d’aimables qualités. Appliqué à l’étude, tout entier à ses nobles fonctions il fit considérer et chérir le nom françois dans les deux cours. Affable, obligeant, il fut, et dans les Pays-Bas et en Angleterre, moins le protecteur que l’ami de ceux de ses compatriotes que leurs affaires ou leurs plaisirs y conduisoient. Mais M. d’Adhémar avoit la faveur de ses maîtres, faveur qu’il ne s’étoit acquise que par d’importans services; c’étoit là son crime, et on aima mieux se priver des lumières qu’il pouvoit donner, que de ne pas le punir d’un délit qui l’honoroit.
Il rendit compte à la cour de cette scène; le lieutenant-général en écrivit, de son cote, a M. Necker. Ce ministre eut une conférence à ce sujet avec le roi qui, au sortir de la conversation, dit, en parlant de M. d’Adhémar, «que puis-je faire à cela? aurai-je jamais fini, s’il me faut faire attention à tous ces détails? Les gens de la cour doivent s’attendre à trouver beaucoup de franchise, mais peu d’urbanité parmi ceux de la campagne. Au surplus, ceux qui craignent de pareilles scènes, n’ont qu’à s’exclure des assemblées».
L’aventure de M. de Guibert fut encore plus scandaleuse; mais celle-ci ne doit pas être imputée au tiers-état, elle doit être reprochée à la noblesse seule. Arrivé à Bourges, M. de Guibert crut devoir, avant de se trouver à l’assemblée, communiquer en particulier à MM. l’Archevêque de Bourges, le duc de Charost, le marquis de Bouthillier, et à quelques autres personnes, le discours qu’il se proposoit d’y lire. Ce discours étoit commun aux trois ordres; M. de Guibert s’y proposoit de les rallier à des principes et à des idées uniformes sur l’objet des états-généraux, sur les devoirs des assemblées de bailliages, qui en étoient les élémens, sur la nature des pouvoirs, sur la marche du travail des cahiers, enfin sûr le choix des députés. Le bruit se répandit que ce discours étoit contre la noblesse en faveur du tiers-état. M. le duc de Charost en fit l’observation à M. de Guibert; il lui représenta que lire des discours ou des mémoires communs aux trois ordres, ce seroit ouvrir des sources de débats et d’animosités; il insista, en particulier, sur la disposition défavorable où étoient déjà les membres de la noblesse, à l’égard de cette lecture.
M. de Guibert se rendit et promit de ne point lire son discours, mais seulement de le déposer sur le bureau, pour le livrer à l’impression. S’étant rendu à l’assemblée, et ayant voulu parler, lorsque M. de la Châtre qui la présidoit, en eut donné la permission, plusieurs voix s’écrièrent: Point, point, nous ne voulons rien entendre. Le bruit étant un peu appaisé, M. de Guibert protesta contre cette manière illégale d’ôter à un citoyen la liberté de parler. Le tumulte et les clameurs alors recommencèrent; on cria de nouveau: Non, non, point.–Il a fait établir la punition des fers pour les officiers.–Il a fait rendre des ordonnances qui humilient la noblesse... . M. de Guibert ayant voulu entreprendre une justification, les cris couvrirent sa voix, les uns disoient: Les fers aux ofificiers.–Des coups de bâton aux soldats; d’autres: Qu’il se justifie; mais un plus grand nombre: Non, non, ne l’écoutons pas, rompons l’assemblée»
Le tiers-état, qui, comme par-tout ailleurs dans ces sortes d’assemblées, occupoit le fond de la salle en face du président, s’échauffa en faveur de M. de Guibert, et voulut qu’il parlât. Un officier dinfanterie voyant ce mouvement, s’approcha de lui, et lui demanda sa parole que les punitions dont on venoit de parler, ne seroient point dans le nouveau code militaire. Il assura sur son honneur qu’il n’en avoit jamais été, et qu’il n’en seroit jamais question. Messieurs, cria aussi-tôt l’officier, il donne sa parole d’honneur, soyons contens.–Non, non, point, point, crièrent plusieurs autres voix.
Le tiers-état persistant à vouloir qu’il fût entendu, on cria aux membres de cet ordre: Il a proposé aussi de couper les jarrets aux déserteurs. Le tumulte ne faisant que s’accroître, il fut proposé, par quelques membres de la noblesse, de rompre l’assemblée; le président s’y opposa, assura que l’intention de M. de Guibert n’étoit pas de lire son discours, et celui-ci dit: «Messieurs, je me justifierai sur le reste; voilà mon manuscrit; je le dépose entre les mains de M. de la Châtre, et je demande qu’il soit imprimé.– Oui, oui, imprimé, imprimé, s’écrièrent les membres du tiers-état.–Non, non, ni lu, ni imprimé, répondirent quelques gentilshommes».
Le tumulte s’étant appaisé, et ayant été mis aux voix si on délibéreroit en commun ou en chambres, il fut décidé que chaque ordre délibéreroit en particulier. La noblesse se retira donc à l’hôtel-de-ville pour y tenir son assemblée; M. de Guibert s’y présenta; mais il en fut repoussé par les cris tumultueux: Point de Guibert, point de rapporteur du conseil, point de Guibert. Il ne lui fut ainsi jamais possible de prendre place dans les assemblées de son ordre.
Cette extrême prévention contre M. de Guibert venoit en partie du crédit dont il jouissoit auprès des ministres, mais plus particulièrement encore de la facilité avec laquelle il innovoit dans la discipline des troupes qu’il fatiguoit, et par l’adoption des systêmes qu’il imaginoit, et par la rigidité avec laquelle il exigeoit ensuite l’exécution de ses plans. Comme on lui connoissoit ce caractère de rigidité, les corps militaires ne le virent qu’avec peine entre dans le conseil de la guerre, où on supposoit que sa qualité de rapporteur lui donnoit une grande influence. C’étoit, au surplus, un excellent militaire, brave, zélé, studieux, plein d’amour pour son état; ses écrits seront toujours recherchés; son style est animé, ses expressions sont pittoresques, et la manière dont il présente ses idées, étonne et le met au rang des écrivains de génie. Son seul défaut lui fut commun avec presque tous ceux qui, dans ces derniers tems se sont élevés au-dessus du vulgaire; il voulut quitter les routes battues, il rechercha trop les nouveautés, et en regrettant qu’une mort prématurée l’ait enlevé, peut-être n’est-ce pas un malheur qu’il n’ait point été député à l’assemblée nationale, qui ne contient dans son sein que trop d’ardens novateurs.
Quant aux reproches qui lui furent faits dans l’assemblée primaire de Bourges, et qui, si je les laissois subsister, pourroient ternir sa mémoire, voici comme il s’en expliqua lui-même dans une lettre qu’il n’écrivit au comte de la Châtre, que lorsqu’il fut bien convaincu qu’il étoit absolument rejeté de son ordre.
» On m’accuse d’avoir, comme rapporteur du conseil de la guerre, proposé d’infliger aux officiers l’infamante punition des fers, et contribué à faire rendre diverses ordonnances qui tendoient à deshonorer la noblesse françoise.
» Je m’empresse de repousser formellement et hautement cette accusation inique, en donnant ma parole d’honneur qu’il n’a jamais été proposé au conseil de la guerre, depuis qu’il existe, aucune loi faits avec cette intention
Il est en effet aisé à tout le monde de se convaincre, par la lecture des ordonnances rédigées au conseil de la guerre pendant que M. de Guibert en étoit membre, qu’il n’y est nullement question des punitions qu’on supposoit qu’il avoit proposées. Sa lettre fut lue dans l’assemblée de son ordre, mais elle n’y produisit aucun effet, quoique MM. de la Châtre de Bouthillier, de Charost, et de Rochedragon, certifiassent la vérité de ce qui y étoit contenu. M. de Guibert voyant que sa justification étoit inutile, et qu’on n’en persistoit pas moins dans l’exclusion prononcée contre lui, se vit réduit à déposer dans le sein de l’assemblée qui donnoit de si dangereux exemples d’injustices, des vérités qu’on n’a cessé, depuis cette époque, d’outrager. Il protesta Io. contre la violation qui avoit été faite en sa personne du droit qu’a tout citoyen convoqué à une assemblée libre, de titre tout ce qu’il croit utile à la chose commune, et il remarqua avec raison que cette infraction annulloit le premier principe des assemblées nationales, et de toute liberté publique.
Il protesta de plus contre les proscriptions tumultueuses, violentes et illégales, prononcées en sa présence à l’assemblée, sans qu’il y eût jamais eu d’autres imputations articulées que celles exposées dans sa lettre.
Les tems de la justice étoient passés, et comme les peuples ne sont jamais plus chastes dans leur langage, que lorsqu’ils n’ont plus de mœurs, de même à mesure que nous nous sommes montres plus avides de liberté, nous sommes devenus plus esclaves; dans la plupart des autres assemblées de bailliages, il ne regnoit guères plus de justice que dans celle de la noblesse de Bourges. Il y eut dans celle de Melun de tels différends, que la cour fut obligée de lui envoyer M. de Lessart, pour prendre connoissance des difficultés, et rapprocher les opinions qui étoient fort divisées. Il y eut dans ce bailliage de grandes intrigues pour l’élection des députés. Les suffrages y furent long-tems balancés entre les deux concurrens que la révolution a immortalisés. MM. le duc du Châtelet et Fréteau, conseiller au parlement de Paris, eurent d’abord un égal nombre de voix. Tous les deux desiroient avec une vive et égale ambition de paroître aux états-généraux. Enfin M. Fréteau l’emporta, et M. du Châtelet se replia sur un autre bailliage.
A Bordeaux, M. de Cicé, archevêque de cette ville, eut des désagrémens à essuyer. Plusieurs personnes lui disputèrent la place d’honneur; M. le baron de Budos tenta même de la lui ôter. Un autre gentilhomme appelé M. de Marcellus blâma la conduite de M. de Budos, et lui en fit des reproches. Cette querelle se termina par un duel; le premier reçut une blessure dangereuse, dont il mourut quelques jours après; il fut peu regretté de son ordre où il ne s’étoit pas toujours montré vaillant chevalier. Etant en effet âgé de26à27ans, il avoit eu au spectacle un démêlé avec un autre gentilhomme; dans la chaleur de la dispute, celui-ci le frappa à la joue. M. de Marcellus ne tira d’autre vengeance de ce traitement, que d’en aller porter sa plainte à M. de Richelieu, alors gouverneur de Bordeaux; et qui, en voyant le gentilhomme offensé, se contenta de lui dire: «dans quel état, Monsieur, paroissez-vous devant moi? Allez vîte laver le sang qui est à votre joue».
A Rheims, un gentilhomme s’étant fait un parti assez considérable parmi le petit peuple, voulut se faire aggréger au tiers-état, et obtenir ses suffrages pour un de ses députés; désespérant d’y parvenir, il donna le signal; les gens qu’il avoit apostés entrèrent tout-à-coup dans l’assemblée, et y causèrent un grand désordre.
A Meaux, M. le Noir, ancien lieutenant de police, fut accueilli avec des huées et des menaces; il avoit été précédé par un écrit qu’un de ses ennemis publia contre lui, et dans lequel il étoit dépeint comme le plus malfaisant des hommes. Il fut obligé de quitter et l’assemblée et la ville.
Dans une autre ville, lorsque les trois ordres furent réunis, le troisième adressa à l’évêque ce laconique compliment, qui exprimoit bien la prévention du moment: Vous êtes des hommes de bien, mais vous êtes des évêques.
A Aix, la noblesse protesta contre les assemblées par bailliages et sénéchaussées, s’assembla en corps; et ce fut dans cette forme illégale qu’elle fit une première nomination de ses députes.
A Blois, M. de Lavoisier fut insulté: on lui reprocha, comme un crime de haute trahison, d’avoir concu et fait exécuter le plan des murs qui forment l’enceinte de Paris; et, sur cette accusation, il fut renvoyé de l’assemblée.
Plus heureux à Etampes, M. de la Borde fils obtint les suffrages du tiers-état; mais après sa nomination, un membre de cet ordre lui adressa ces paroles: «Vous voilà notre représentant; nous attendons de vous que vous répondiez à notre confiance: vous ne devez pas douter que si vous veniez a la trahir, vous auriez sujet de vous en repentir». M. de la Borde a été fidèle aux avis de ses commettans, mais plus encore aux insinuations qui lui ont été données en arrivant aux états-généraux, par un homme dont, dans d’autres tems, il eût dédaigné les éloges qu’il en a reçus.
A Tulles, en Limosin, M. le duc d’Ayen put comprendre aux discours qui lui lurent adressés, que les dignités et les richesses accumulées dans sa maison excitoient la jalousie de cette partie de la noblesse, que ses goûts où la modicité de sa fortune tenoient éloignée de la cour. Un membre de l’assemblée lui adressa même un compliment qui n’étoit qu’un persiflage, et qu’il termina par cette franche déclaration: «Quant à moi, je ne vous donnerai point ma voix».–Ni moi, dit un autre gentilhomme: un troisième fit entendre le même vœu; et les deux mots, ni moi, circulèrens de bouche en en bouche.
Les intérêts particuliers et les passions, comme l’on voit, se démasquoient; il en étoit de même des hommes et des opinions. On eût cru, dans ces premiers momens, qu’il n’étoit plus qu’une seule ambition, celle de venir se montrer sur le théâtre de la nation: chacun y briguoit une place, chacun, suivant son humeur et les vues qu’il se proposoit, faisoit mouvoir différens ressorts. M. de Calonne se montra aussi parmi les candidats; il essaya de se concilier les esprits, en publiant une lettre au roi, qui contenoit d’excellentes maximes de gouvernement mais le discrédit dans lequel il étoit tombe, étoit trop récent pour qu’il pût dissiper toutes les préventions. On trouva d’ailleurs que dans cette lettre il parloit plus le langage d’un courtisan que celui d’un homme d’état; on prit pour flatterie la justice qu’il rendoit aux princes, au cierge, a la noblesse, à la magistrature: ceux a qui il la rendoit, la regardèrent comme trop tardive, et ne lui en surent aucun gré; les autres la regardèrent comme une insulte qui les humilioit, et le moment étoit venu où, pour se placer à une certaine hauteur, il falloit être aidé par la multitude.
Cette lettre ne fut donc d’aucune utilité pour les nouveaux projets de M. Calonne. Les bruyans aréopagites du café de Valois, s’assemblèrent lorsqu’elle parut; ils la condamnèrent, par un burlesque jugement, à être brûlée. La sentence fut executee; les cendres du livre furent recueillies dans un paquet qu’on envoya à l’auteur par la poste, et qu’on accompagna de la menace de lui faire subir le même traitement qu’à son ouvrage, s’il reparoissoit à Paris.
Il n’en persista pas moins à vouloir être député aux états-généraux; il passa en France, et s’approcha même de la cour. Il se montra d’abord à Douai. Y étoit-il venu en vertu d’un sauf-conduit, ou de son propre mouvement? C’est ce que j’ignore. Je sais seulement que M. le prince de Robecq, qui commandoit en Flandres, écrivit au roi pour savoir comment il devoit se comporter à son égard. Environ quarante personnes, fondées pour lui de procuration, se présentèrent dans l’assemblée d’élection du bailliage de Bailleul; plusieurs autres membres lui donnèrent leur voix; mais le reste de l’assemblée refusa obstinément d’avoir aucun égard aux pouvoirs. Le tiers-état, de son côté, qui savoit que M. de Calonne attendoit dans la ville le résultat des délibérations, lui envoya une députation pour le prier de s’éloigner. Il se retira à Poperingues, où il ne désespéra pas d’être plus heureux dans un autre bailliage. Toutes ses tentatives furent inutiles; s’étant même remontré sur les terres de France, et ayant été reconnu, sa voiture, qu’escortoient cependant cinq cavaliers de maréchaussée, fut investie par des gens de la campagne, qui, aux invectives, ajoutèrent les voies de fait; on lui lança des pierres; il échappa à ce danger, mais il fut obligé de s’éloigner pour toujours.
Ce n’étoit pas seulement une injustice que l’exclusion donnée à M. de Calonne, puisqu’elle le dépouilloit, sans motif légal, d’un droit qui appartenoit à tout François réunissant les qualités requises par le règlement pour être éligible; ce fut encore une grande erreur en politique. L’admission de M. de Calonne, parmi les députés du royaume, l’eût mis aux prises avec M. Necker; ils s’y fussent mesurés, pour ainsi dire, corps à corps; il eût résulté de cette intéressante lutte, d’abord la décision de la querelle élevée entre ces deux ministres, et nous avons laissé échapper la seule occasion où elle auroit pu se terminer d’une manière avantageuse pour la chose publique; il eut résulté encore du choc des discussions qui se seroient élevées entre les deux combattans, des révélations importantes sur tout ce qui tient au gouvernement de la France, et en particulier des vérités salutaires sur l’administration des deniers publics. Nous devons d’autant plus regretter que M. de Calonne n’ait pas obtenu la justice qui ne pouvoit lui être refusée par ses concitoyens, que la cause de la plus part des erreurs où est tombée l’assemblée nationale vient de ce qu’elle ne renferme dans son sein aucun administrateur, aucun homme d’état, aucun politique instruit des secrets des cabinets. M. de Calonne se consola peut-être de cette nouvelle disgrace, en se voyant remplacé aux états-généraux par un autre de son nom. M. l’abbé de Calonne en effet, son frère, fut élu par le clergé de Melun; mais cette ressource fut nulle et pour la nation, et pour ce ministre. Pour paroître avec avantage dans la tribune aux harangues, il faut des qualités physiques, dont la nature a privé M. l’abbé de Calonne. D’ailleurs dans le combat singulier qui devoit avoir lieu entre l’ancien ministre et M. Necker, personne au monde ne pouvoit remplacer le premier.
MM. les duc du Châtelet, d’Harcourt, le cardinal de Rohan, et l’évêque de Coutances, et le marquis de Villette se distinguèrent parmi ceux qui montrèrent de l’empressement à être au nombre des représentans de la nation.
Le premier, comme je l’ai dit, ayant échoué à Melun, se transporta à Bar-le-Duc, et y vit son ambition satisfaite; il fut accusé d’avoir employé les caresses, les largesses même pour obtenir des suffrages; je suis bien loin de croire à cette accusation qui fut débitée avec affectation, mais qui ne fut jamais prouvée; et je la remarque pour montrer l’opinion où l’on étoit que parmi les élus il s’en trouvoit qui ne dévoient pas leur élévation à des moyens bien légitimes. Il faut croire au reste que M. du Châtelet, en se livrant avec tant d’ardeur à la poursuite de l’objet de ses desirs, comptoit trouver dans le poste où il est parvenu, plus de satisfaction et de gloire qu’il n’en a recueilli de cette petite victoire.
M. le duc d’Harcourt, retenu par sa place auprès de l’héritier présomptif de la couronne, chargea de sa procuration un des membres de l’assemblée du bailliage de Caen. Les électeurs refusèrent de reconnoître le représentant de M. d’Harcourt, et mirent celui-ci dans l’alternative, ou de donner sa démission de la place honorable qui* le retenoit à la cour, ou de renoncer à son droit d’être élu. Ce seigneur ne balança pas, et resta dans le poste où l’avoit placé la confiance du roi; ce fut encore une perte pour les états-généraux, que celle d’un homme qui, à des qualités morales et à des lumières, reunissoit une connoissance intime de la cour.
M. le cardinal de Rohan fut élu unanimement, et de la manière la plus flatteuse; mais à peine élu, il refusa avec instance et absolument, de se rendre aux desirs de ses commettans: il allégua, pour motif de son refus, le mauvais état de sa santé, qui fut en effet toujours chancelante depuis les humiliantes disgraces qu’il avoit essuyées; mais ce motif n’étoit qu’un prétexte. Il fut instruit que la cour ne le verroit pas avec plaisir siéger parmi les députés; et comme alors on craignoit encore de ne pas regarder comme des ordres absolus, les intentions connues du roi, M. le cardinal de Rohan se conforma à l’avis qui lui étoit donné. Dans la suite, lorsqu’il vit que la puissance dont il s’éloignoit par une juste soumission, respectoit elle-même une autre puissance, il s’approcha de celle-ci sans craindre les ressentimens de l’autre, mais ce fut pour s’abreuver de nouveaux chagrins.
M. l’évêque de Coutances trouva, dans les trois ordres, de grandes oppositions à ses desirs; le tiers-état rejetta, même avec hauteur, l’offre que lui firent le clergé et la noblesse, de faire tous les sacrifices qui dépendroient d’eux pour lui prouver que tous les François étoient concitoyens et frères. Dans son ordre, le prélat trouva portée à un plus haut degré la prévention, et peut-être la jalousie, qui existoit presque par-tout ailleurs parmi les curés. Ils se divisèrent: environ trente d’entr’eux se transportèrent chez un notaire, et y firent une sorte de déclaration par laquelle ils entendoient que le clergé n’eût plus désormais le droit de s’imposer lui-même. Enfin le prélat parvint à réunir les deux partis, et obtint tous les suffrages. Les anxiétés qu’il avoit éprouvées furent peut-être la seule cause de la maladie qu’il fit au moment où il se vit exaucé. Il avoua ingénuement à ses amis qu’il fut mort de douleur s’il n’eût pas obtenu, de la part de son clergé, cette preuve de confiance qu’il méritoit par ses vertus.
Enfin, quant au marquis de Villette, il se mit aussi sur les rangs: il parut dans les assemblées du bailliage de Senlis; on y rendit hommage à son esprit; on le nomma un des commissaires pour la rédaction des cahiers; mais on s’en tint là, et heureusement pour les mœurs publiques, la nation n’eût pas à rougir de compter parmi ses représentans, un homme avili même parmi les hommes vils.
Je vais, dans le chapitre suivant, mettre en scène deux personnages qui ont eu sur la révolution, une bien toute autre influence, et dont, par cette raison, je suivrai soigneusement tous les pas jusqu’à la fin de cette histoire.