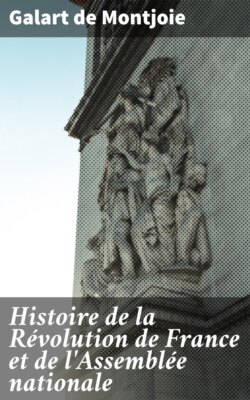Читать книгу Histoire de la Révolution de France et de l'Assemblée nationale - Galart de Montjoie - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE XXI.
ОглавлениеTable des matières
PLAN de cette seconde partie. Premières calomnies contre M. l’archevêque de Paris; stupeur de la capitale; singulière tentative pour exciter un attroupement; mort de M. le dauphin; immobilité de la cour; situation des provinces? inondation de brigands aux environs de S.-Quentin; même calamité dans la Limagne; exemple frappant d’ingratitude envers M. de Talaru; mouvemens de la bourgeoisie en Bretagne y opinion qu’il faut se faire des modernes factieux; mécontentement du petit peuple dans les villes et dans les campagnes; causes de ce mécontentement; développement des véritables vues de M. Necker; sécurité du parlement; atroce assassinat commis en Dauphiné.
Suite de Juin1789.
ME voilà donc parvenu à l’époque où commence véritablement l’histoire de, la révolution. J’entre dans cette nouvelle carriere, sans aigreur comme sans partialité contre les auteurs même de nos maux. Je perce ai les ténebres où ils ont préparé le funeste poison, qui, en quelques mois, a procuré la dissolution de la plus belle monarchie de l’Europe; mais en les démasquant, en les dénonçant, je n’oublierai doint que c’est à la postérité, et non à moi, à les juger, à les flétrir.
Je suivrai dans cette seconde partie, la méthode que je me suis tracée dans la premiere: je m’attacherai sur-tout à indiquer, à développer les causes qui ont engendré des calamités dont la France aura peut-être à gémir pendant plus d’un siecle, et dans la foule des acteurs qui vont se produire, je n’omettrai le portrait d’aucun de ceux dont le génie, les moeurs, les habitudes, le caractère, les opinions ont le plus influé sur les événemens que j’ai encore à décrire.
Quels événemens! Quels tableaux! La France au sein de la paix, couverte de séditieux, déchirée par de cruelles dissentions, par une guerre intestine et atroce; des citoyens distingués, les uns par leur naissance, les autres par leurs places, égorgés sous les yeux même de ceux qui avoient usurpé la magistrature; des troupes de brigands dévastant, incendiant impunément les propriétés; toutes les provinces soulevées, la religion profanée, ses ministres outragés; les hommes des différentes sectes nous donnant un nouvel ordre de prêtres; la plupart de nos temples fermés; les moeurs d’un peuple doux devenues tout à coup féroce; des têtes augustes proscrites; nos frontieres couvertes d’exilés; les nations voisines s’étonnant de leur affluence, et s’enrichissant de nos trésors; les meurtres dans les villes, le pillage dans les campagnes; les biens, les honneurs, la naissance, la probité, tout ce que les hommes ont de plus grand, de plus respectable, devenu funeste. Le luxe, le faste, l’insolence des parvenus, plus insupportables que les crimes qui les ont élevés; les uns s’appropriant les dignités du sacerdoce, de la magistrature; les autres, l’administration des provinces, les places de la cour, les secrets du cabinet; enfin tout l’état bouleversé, confondu; les valets dénonçant leurs maîtres, les amis craignant de donner asile à leurs amis.
Cependant au milieu de ces désordres, on voit encore briller des vertus: la vérité, l’innocence ont de courageux défenseurs. La religion et la patrie ont de glorieux martyrs. De fideles sujets du roi cimentent son trône de leur sang; et parmi les victimes que moissonne la révolution, il en esc dont la mort est comparable à celles que nous vante l’antiquité.
Avant de reprendre le récit où je l’ai laissé, je dois dire quel étoit l’état de la capitale et des provinces, au moment où les trois ordres alloient se réunir, ou plutôt se confondre. A Paris, on continuoit à se nourrir de fables et d’impostures. On attribuoit principalement à M. l’archevêque de Paris, le peu de succès qu’on avoit recueilli des menées qui s’étoient pratiquées auprès des curés.
On épioit toutes les démarches du prélat. Il alloit quelquefois à Meudon, visiter M. le dauphin, dont la maladie donnoit les plus grandes inquiétudes. La reine s’y rendoit aussi très-fréquemment; il étoit naturel que sa majesté et M. l’archevêque de Paris s’y rencontrassent. Le prélaty étoit conduit par le devoir de sa place, et la reine autant par son devoir que par sa tendresse pour l’auguste enfant. On remarqua que l’un et l’autre y arriverent le30mai, vers les onze heures du matin, et n’en partirent que vers les six heures du soir. On prétendit que, dans cette longue entrevue, il avoit été pris des mesures pour détacher les curés du tiers-état, et depuis ce jour on ne regarda plus la maladie de M. le dauphin, que comme un prétexte qui fournissoit aux conjurés l’occasion de se réunir à Meudon, et à la tête de Ces conjurés, on mettoit la reine et M. l’archevêque de Paris. Tout curé qui parloir au prélat, étoit évidemment une victime de la séduction. Ainsi s’aiguisoit le fer avec lequel on tenta bientôt après, de frapper un des plus vertueux homme de ce siecle.
Cette défection des curés, qu’on croyoit certaine, ne donnoit matiere à tant de calomnies, que parcequ’elle déjouoit pour le moment, les projets des factieux. Ils croyoient n’avoir plus, dans leur parti, que huit ecclésiastiques, dont quatre encore tenoient au haut clergé, et environ40nobles. Il est évident qu’un aussi petit nombre de déserteurs, n’auroit pas pu donner, aux députés du tiers-état, le droit de former à eux seuls les états-généraux.
Le roi à qui il tardoit de parvenir à cette régénération pour laquelle il avoit fait tour ce qu’il étoit en son pouvoir de faire, voyoit avec impatience, les retards qu’on y apportoit. Le peuple qui rendoit encore justice à ses intentions, se flattoit que le tiers-état n’avoit pas de protecteur ni plus zélé, ni plus sincere. On fit circuler dans le public une réponse qu’on prétendit que ce généreux prince avoit faite à des députés de la noblesse, qui lui apportoient un arrêté de leur chambre.
«Messieurs, faisoit-on répondre au roi, depuis très-long-tems je suis habitué à vos protestations de zele, de fidélité, d’amour et de respect pour moi; mais c’est avec douleur que je me vois forcé de vous dire que j’en attends encore aujourd’hui les effets».
Jamais le roi ne fit une telle réponse à sa fidelle noblesse qui, en cherchant à détourner l’orage dont elle étoit menacée, combattoit moins pour sa propre sûreté, que pour le trône qu’elle avoit fondé, et qui est tombé avec elle. Mais en supposant au roi un mécontentement qu’il ne pouvoit pas avoir, on entretenoit le peuple dans la persuasion, qu’il falloit que la conduite de la chambre de la noblesse fût bien extraordinaire, bien injuste, puisque le prince intéressé à faire cause commune avec elle, la désapprouvoit.
Il se répandit une autre absurdité: on disoit, pour expliquer un des motifs de la répugnance des deux premiers ordres, à vérifier leurs pouvoirs en commun, qu’en venant aux états-généraux, ils avoient reçu de leurs commettans un double cahier, l’un ostensible et imprimé, l’autre manuscrit et secret. L’événement a prouvé que cette fourberie étoit de l’invention de ceux qui, dans ces premiers instans d’effervescence, ne savoient à quelles calomnies recourir, pour noircir les deux premiers-ordres.
Il n’y avoit pas jusqu’au désordre qui régnoit dans la salle du tiers état, dont on ne voulut rendre le clergé et la noblesse responsables. Si les délibérations des communes, disoit-on, sont aussi tumultueuses, c’est à cause de la multitude de valets que les prélats et les gentilshommes envoyent à chaque séance, et qui sont gagés pour faire un vacarme effroyable à chaque parole que disent les orateurs. Leurs maîtres, ajoûtoit-on, esperent par cet artifice, convaincre les communes elles-mêmes de la nécessité de fermer leur salle au public.
Ces impostures et mille autres de ce genre ne produisoient cependant pas encore dans la capitale, tout l’effet qu’on en attendoit. Les parisiens vivement préoccupés des débats entre les trois ordres, fixoient uniquement leur attention sur cette lutte, et dans l’attente de son issue, ils sembloient ne pouvoir éprouver d’autre sentiment que celui de la curiosité. Ils étoient immobiles, et ne s’appercevoient pas même des efforts qu’on faisoit pour les porter à quelque mouvement extraordinaire, qui fit enfin pencher la balance où se pesoient les destinées des deux premiers ordres.
3.
Dans cet état de stupeur où étoit plongée la capitale, les tentatives que l’on faisoit pour exciter le peuple à la sédition, étoient inutiles, et une scène bizarre que vraisemblablement on n’avoit ménagée que pour occasionner un attroupement, ne fit aucune sensation. Un particulier, d’un extérieur honnête, d’une physionomie douce, et dont les yeux ne laissoient appercevoir aucune trace d’égarement, se présenta, vers les dix heures du matin, devant la principale porte de l’église Notre-Dame. Là il se mit à genoux, et levant un pain qu’il tenoit à la main droite, il repéra par trois fois, d’une voix haute et sonore, cette étrange priere:
» Mon dieu, je vous offre ce pain que votre bonté a bien voulu m’accorder. Recevez cette offrande, et daignez, ô mon dieu, faire en sorte que notre bon roi se hâte de trouver les moyens d’en procurer à son peuple qui, hélas! meurt de faim.»
La singularité de ce spectacle attira bientôt, au tour de cet homme, une foule assez considérable: le suisse de l’église accourut au bruit, et, par sa prudence, parvint à faire finir cette scène sans bruit. Il s’approcha fort civilement de l’inconnu, et lui représenta qu’il feroit bien plus décemment sa priere dans l’église même; que d’ailleurs, placé ainsi à la porte, il en empêchoit l’entrée à ceux que leur piété invitoit à venir assister aux saints mysteres
La sagesse de ces représentations, et l’air dont elles étoient faites, parurent convaincre celui à qui elles s’adressoient; il s’y rendit et se laissa conduire dans l’église même, où il répéta sa priere aussi souvent qu’il voulut. Lorsqu’il eût fini ce pieux manège dont on n’a jamais connu le but, le suisse qui ne l’avoit pas quitté, le reconduisit à la porte, et, en prenant congé de lui, lui donna les mêmes témoignages de civilité avec lesquels il étoit venu le recevoir. Quelques jours plutôt ou plus tard, une pareille scène eût fait accourir tout le peuple des fauxbourgs.
La cour étoit, comme la capitale, dans l’immobilité. La mort du jeune dauphin, arrivée à Meudon dans la nuit du3au4, y avoit répandu une tristesse bien justifiée par les espérances que faisoit évanouir cette mort. Jamais, dans un âge aussi tendre, on n’avoit vu tant de qualités aimables, plus de reconnoissance, plus de sensibilité, plus de résignation et surtout plus de patience à souffrir des douleurs que l’homme du tempérament le plus robuste eut trouvées insupportables. Lorsque ce digne rejetton d’une maison qui a donné tant de héros et de bienfaiteurs à la France, voyoit le visage de son auguste mere se mouiller de pleurs, il la caroissoit, la consoloit, et lui faisoit entendre ces touchantes paroles: ah! maman, mes maux ne sont rien, je ne souffre que lorsque je vous vois affligée. Ses souffrances étoient-t-elles que quelques heures avant de mourir, elles, lui arracherent un cri qui retentit bien avant dans le coeur de ceux qui l’entendirent: » Eh! mon dieu, mon dieu, que vous ai-je donc fait pour me faire tant souffrir?» Il étoit né au château de Versailles, le22octobre1781; il avoit pour noms Louis-Joseph-Xavier de France. Il fut enterré, avec la pompe ordinaire, à Saint-Denis, dans la sépulture de nos rois. La cour porta son deuil pendant deux mois et demi. Louis Charles, duc de Normandie, né le27mars1784, est devenu par cette mort dauphin et héritier présomptif de cette couronne dont la licence et l’ingratitude ont arraché tant de prérogatives. Que de désastres ont environné le berceau de ce jeune prince qui réunit dans ses veines le sang des Bourbons à celui de la maison d’Autriche! Puisse le ciel nous conserver ce gage de sa bonté, et continuer à le protéger au milieu des périls qui l’attendent encore!
La capitale et la cour jouissoient au moins d’une apparence de tranquilité; mais les provinces étoient toujours dans une grande agitation: on continuoit a en effrayer les peuples par la crainte d’une inondation extraordinaire de brigands. Cette crainte n’étoit pas partout chimérique: les environs de Saint-Quentin furent au loin ravagés par des hordes de scélérats qui fouloient aux pieds et fauchoient les moissons encore en herbe. On leur donna la chasse, on en emprisonna quelques-uns, on les interrogea; mais leurs interrogatoires ne donnèrent aucune lumiere. On n’en publioit pas moins que cette dévastation étoit commandée et payée par le clergé et la noblesse. On arrêta entre autre un particulier qui fut mis dans les prisons de Douay. Il se répandit qu’il appartenoit à M. le prince de Condé. Le fait qui n’a jamais été prouvé, fut-il vrai, et en supposant encore que ce particulier fut véritablement un des chefs de l’émeute, il faudroit simplement en conclure que, dans le nombre considérable des gens attachés au service du prince, il se trouvoit un mal-honnête homme.
Il étoit d’autant plus absurde d’attribuer ces émeutes au clergé et à la noblesse, que presque par-tout elles se dirigeoient contre les deux premiers ordres. Les ecclésiastiques étoient insultés, et les châteaux des nobles pillés et incendiés dans plusieurs provinces. Le fertile pays de la Limagne en Auvergne fut couvert tout à-coup par quatre mille brigands qui s’attachoient surtout à dégrader les propriétés des nobles. Les paroisses de Tour, de Mauzan, de Roissonnelle, de Fournolle, de la Chapelle-d’Aignon, de Monischal, de Thiers furent ravagées par des légions de ces malheureux.
La qualité de gentilhomme étoit déjà devenue si odieuse, que, lors qu’on en étoit revêtu, les vertus les plus éminentes, les plus grands bienfaits ne donnoient aucun droit ni à la considération ni à la reconnoissance. On en eût un exemple bien déplorable à Yssy, petit village distant de quelques lieues de la capitale. M. de Talaru, seigneur d’une terre aux environs de ce village, y avoit toujours joui de l’amour de ses vassaux. Il s’éroit acquis cette douce jouissance par sa tendre sollicitude envers les malheureux; il n’y en avoit plus dans sa terre; ses libéralités en avoient banni la pauvreté; il les redoubla pendant la longue calamité du désastreux hiver de1788à1789; sa fortune en fut considérablement endommagée, mais aussi il acquit le glorieux surnom de pere de ses vassaux.
Dans les premiers jours de juin ils le payerent bien cruellement de rant de généreux sacrifices. Un nombre considérable d’entr’eux prit les armes, et se porta Vers une digue qui conduisoit l’eau à un moulin bannal qu’on savoit être la propriété de M. de Talaru. La digue fut entièrement détruite, et M. de Talaru se vit par ce moyen privé du moulin. Il en porta sa plainte au parlement, dont un arrêt ordonna aux ingrats vassaux de rétablir la digue. Ces malheureux, oubliant qu’ils ne devoient la vie qu’aux bienfaits de leur seigneur, déclarerent que non seulement ils ne rétabliroient pas la digue, mais que si M. de Talaru la faisoit relever, ils iroient au nombre de trois cents, et bien armés, la détruire de nouveau.
C’est mentir et insulter à la postérité, de vouloir attribuer ces excès à ceux qui en étoient les victimes. Quoique cet événement se passât pour ainsi dire sous les yeux des Parisiens, ils n’en étoient pas moins persuadés que le brigandage qui dévastoit le royaume&dont ils se croyoient eux-mêmes menacés d’un moment à l’autre, étoit l’effet des menées du clergé&de la noblesse. Il leur arrivoit journellement des différentes provinces, et en particulier de la Bretagne, des relations mensongères qui les entretenoient dans cette pitoyable erreur, qui a fini par les porter à l’insurrection.
Toutes les scènes, cependant, qui se passoient en Bretagne, prouvoient que dans cette province, comme dans les autres, les factieux ne s’agitoient, les brigands ne s’armoient que pour outrager la noblesse. Là, comme ailleurs, les gentilshommes étoient spectateurs immobiles de la tempête qui les menaçoit. La bourgeoisie étoit bien loin de montrer cette tranquillité. Quarante mille jeunes Bretons environ, prirent les armes; ils n’avoient, disoient-ils, d’autre intention que de veiller à la sûreté de leurs concitoyens, et de préserver leurs possessions du pillage. Ils se disoient tous prêts à marcher contre les vagabonds et les mal-intentionnés. Chacun d’eux portoit à la boutonniere un double ruban, l’un verd, sur lequel étoit empreinte la fraction1/3, l’autre herminé, sur lequel on voyoit une fleur de lys; à ces deux rubans, ils avoient ajouté une branche de lierre et une de laurier. Ils prirent même un arrêté menaçant contre ceux qu’ils supposoient mettre obstacle à la réunion des ordres, et empêcher par leurs menées que les états ne produisissent aucun effet.
C’étoit-là un véritable parti, et jamais l’occasion n’eut été plus favorable pour quiconque eut eu la volonté et le génie de dominer seul l’empire françois. Mais il faut le dire, puisque j’y suis entraîné par mon sujet; dans tout le cours des différens changemens dont je fais l’histoire, nous n’avons vu que des attroupemens, que des factions tumultueuses, que des séditieux, et il ne s’est pas rencontré un seul chef de parti. De tous ceux qui ont bouleversé la patrie, aucun n’a montré de la grandeur, même dans le crime; tous, sans en excepter ceux qui s’étoient plus fortement conquis la faveur populaire, n’ont été que des rhéteurs dans l’assemblée des états-généraux, et au-dehors que des factieux subalternes. Ils se sont agités en tous sens; ils ont remué, ils ont brisé toutes les bases de l’empire; en un mot ils ont tout détruit et ont laissé tout à naître; c’est à quoi se réduisent les conceptions, les travaux de ces hommes que nous avons cru grands, tandis qu’ils n’étoient qu’audacieux. Ils ont envahi une fortune qui les a tout-à-coup fait monter à un degré d’opulence dont ils se sont étonnés eux-mêmes; c’est tout ; le fruit qu’ils ont recueilli de tant de mouvemens. cette fortune se dissipera avec autant de promptitude qu’ils l’ont acquise Que leur restera t-il alors? le jugement de la postérité qui écrira sur leurs tombeaux; c’étoit bien la peine de se vouer au crime.
Aucun n’a développé ces vues et ces moyens d’ ambition qui étonnent, parce qu’ils supposent une ame forte qui maîtrise les hommes, les événemens, et se joue des obstacles. Aucun n’a su sattacher les gens de guerre, n’a compris tous les prodiges qu’il est possible d’opérer avec les bonnes grâces de la multitude. Si, parmi ces ligueurs, il se fût trouve un homme courageux, adroit, profond dans larte a dissimulation, savant dans la connoissance de l’histoire et du coeur humain, que n’eût-il pas pu entreprendre dans ces jours de trouble, où il a été libre, à chacun, de se frayer une route? Il eût pu s’élever à la dictature, au protectoriat, monter même plus haut. Il eût dit au peuple: ce sceptre que je prends un instant, va briser pour toujours le despotisme des ministres; il eût dit aux grands, ma main va poser une barrière, que la licence du peuple ne franchira plus. Il eut dit a tous: lorsque l’édifice public sera achevé, je déposerai la force qui en aura protégé la construction.
L’usurpateur qui eût conçu et exécuté un tel projet, n’eût été, sans doute, qu’un scélérat, mais la grandeur même de son forfait eût imprimé une certaine gloire à son nom. Quelle gloire au contraire recueilleront ceux qui, ayant chassé du trône leur légitime roi, ont terminé leurs exploits, par briguer, les uns une place de juge de district, ceux-là une part dans l’administration d’un département, d’autres enfin, le commandement d’un bataillon de milice bourgeoise? Si César ou Cromwel eussent été témoins, d’une telle chûte, qu’eussent-ils pensé du génie, de l’ame, du courage de celui qui l’auroit faite? Ils eussent ri, comme J.J. Rousseau, de ces hommes avilis qui, se laissant ameuter par des ligueurs, ont osé parler de liberté, sans même en avoir l’idée, et le coeur plein de tous les vices des esclaves, se sont imaginés que pour être libres, il suffisoit d’être des mutins.
Je reviens à la situation de la France. Les provinces, non moins avides de nouveautés que la capitale, se trouvoient dans une situation pénible, par l’inactivité des états-généraux. Elles avoient soif, si je puis parler ainsi, d’un changement quel qu’il fût. Dans toutes les parties de l’Empire, on soupiroit donc, ou après la réunion, ou après la rupture formelle des trois ordres. Cependant on n’étoit pas sans appréhension sur les suites que pouvoit avoir la secousse qui termineroit les débats entre le tiers-état et les deux premiers ordres. On craignoit une guerre civile,&toutes les lettres qui venoient des différentes villes, annonçoient qu’on y étoit dans l’attente d’une épouvantable explosion.
Les incursions des brigands ajoutoient à l’effroi; et ce qui y mettoit le comble, c’etoit l’impatience, le mécontentement des paysans et du petit peuple, Les uns et les autres avoient lieu d’être mécontens. Ils n’obtenoient l’aliment dt première nécessité, qu’avec des efforts, et quand ils l’avoient obtenu, ils étoient tourmentés de la crainte d’en manquer le lendemain. A Fontainebleau, on en vint à ne plus distribuer le pain que par des guichets. On se portoit enfoule à ces ouvertures, et ceux qui avoient obtenu cette nourriture, n’étoient pas toujours certains de pouvoir la distribuer à leur famille. Ils étoient souvent assaillis sur la route par ceux dont l’espoir avoit été trompé, et l’aliment leur étoit arraché des mains.
Cette situation étoit véritablement pénible, A Paris la disette n’étoit pas encore portée à cette extrémité, mais on se voyoit à la veille d’endurer les mêmes angoisses. Les boulangers se plaignoient amèranent de la rareté des grains, et se disoient entraînés à la nécessité d’en augmenter le prix. Le gouvernement, pour empêcher l’effet de ces menaces, leur fit distribuer une somme de300,000livres, en dédommagement de la perte qu’ils faisoient sur la vente journaliere; foible secours qui, par la publicité qu’on lui donna, ne fit qu’accroître la terreur.
Les députés des villes arrivoient journellement chez les ministres, pour réveiller leur sollicitude sur une calamité dont personne ne voyoit la cause. Des habitans de Beauvais entr’autres, firent à M. Necker un tableau si effrayant de la cruelle situation de cette ville qu’ils lui dirent sur le point d’être ravagée par la famine, qu’il leur accordât, sur-le-champ, un convoi de vivres.
Dans presque tous les marchés, il se faisoit sur les grains, un mouvement extraordinaire. La ville qui s’en trouvoit abondamment pourvue, se les voyoit tout-à-coup enlever, sous l’escorte de gens de guerre. Comme les habitans, à qui ils étoient arrachés, n’en connoissoient point la destination, ils se répandoient en conjectures injurieuses au gouvernement.
Si ces enlevemens n*avoient eu pour objet que d’alimenter les villes, qu’afligeoit la disette, du superflus de celles qui étoient dans l’abondance, ils eussent été sans doute excusables; mais l’éclat qu’on leur donnoit, étoit une mal-adresse, s’il n’étoit pas une perfidie.
Aujourd’hui que nous commençons à voir ces premiers événemens avec quelque sang-froid, nous ne pouvons nous dissimuler qu’il y avoir de l’affectation dans l’appareil bruyant et militaire qui accompagnoit ces transports de grains, de marché en marché. L’agitation qu’ils devoient produire, étant le premier ressort de la révolution qui se préparoit, on n’est plus étonné actuellement de l’ardeur avec laquelle on travailloit à l’entretenir, à l’accroître, à la diriger.
Mais comme aucun des hommes venus aux états-généraux n’avoit encoreassez d’influence dans l’empire, pour s’introduire dans les greniers publics, et disposer à son gré de leurs trésors, il est naturel de soupçonner que la main qui opéroit ces manoeuvres, étoit une de celles qui renoient les rênes du gouvernement. Il est tems pour moi de changer ces soupçons en réalité, et je dois cet éclaircissement aux faits qui vont suivre.
M. Necker, nourri d’idées républicaines, ayant la présomption de se croire né pour réformer l’empire françois, saisit avec avidité les circonstances de la convocation des états-géuéraux, pour opérer cette réforme. il les accorda, quoique lui-même ne les crut pas nécessaires, parce qu’il vit dans cette grande assemblée, les instrumens qui l’aideroient à exécuter ses projets, il en devança leterme, parce qu’il étoit pressé d’arriver à son but.
Ce ministre s’étoit fait de grandes illusions sur notre gouvernement. Les richesses du clergé, l’influence de la noblesse, l’autorité des parlemens, l’avoient effrayé. Il regardoit ces trois corps, non comme des barrières tucélaires qui sauvoient, tout à-la-fois, le trône, des attentats de la licence, et le peuple, des erreurs et des crimes du despotisme; mais comme trois colosses qui, en même temps qu’ils écrasoient de leur poids la classe la plus nombreuse de l’empire, affoiblissoient le pouvoir du roi, et lui rendoient le bien pénible à faire. En deux mots: rendre le monarque plus absolu, et le peuple plus heureux; tel étoit le rêve dont se berçoit M. Necker.
Cette chimère flattoit d’autant plus le ministre, qu’elle tranquillisoit sa conscience; en y fixant, avec complaisance, son imagination, il se rendoit le témoignage de se montrer, autant qu’il étoit en lui, reconnoissant envers son auguste bienfaiteur, par l’accroissement de puissance qu’il donnoit au roi actuel et à ses successeurs; et d’un autre côté, quelle noble ambition de rendre le bonheur à vingt-deux millions d’hommes, qu’il regardoit comme courbés sous le joug du despotisme des grands!
Pour opérer ces deux miracles de politique, M. Necker croyoit nécessaire d’abaisser le clergé, la noblesse, et, sur-tout, les parlemens. De-là, son systême des administrations provinciales, dont l’établissement eût fini par priver la magistrature du droit d’enregistrement, par initier les classes même inférieures du peuple aux sciences administratives, et l’on sçait que par l’exécution de ce plan, toute la force publique concentrée au tour du trône se développoit sans effort comme sans obstacles.
M. Necker n’étoit pas tellement étranger à nos principes et à nos moeurs, pour ne pas savoir qu’il eût échoué honteusement, s’il eut voulu heurter, brusquement et à la fois, le triple colosse qui l’effrayoit. Voilà encore pourquoi, en voulant réaliser ces administrations provinciales, qui avoient été imaginées longtems avant lui, il proposa de se borner à leur établissement successif.
En désirant l’abaissement du clergé, de la noblesse de la magistrature, M. Necker pensoit que le premier ordre, comme corps politique, étoit inutile et dangereux à l’état; il n’eût voulu laisser à la noblesse que son blason; et quant aux parlemens, il trouvoit de grands avantages dans leur entiere destruction, et n’y voyoit aucun inconvénient.
Ce politique de deux jours, ayant ainsi applani toute la surface de l’empire, ne voyoit plus sur ce plan, qu’une éminence, c’étoit le trône. Sur ce trône, il voyoit son maître absolu, pouvant atreindre à ses sujets, et ceux-ci, à leur tour, atteindre à leur roi, sans intermédiaire. Telles étoient les conceptions de M. Necker; c’est ainsi que dans ses rêveries sur le gouvernement des états, il croyoit pouvoir allier le despotisme du monarque avec le bonheur des peuples. Elevé dans une petite république, imbu de tous les préjugés d’une secte, dont les dogmes et les formes sont populaires, il étoit entraîné par son penchant et par les habitudes de son enfance, vers la démocratie. Jetté ensuite dans une grande monarchie; frappé de l’ordre et de la police qui en enchaînoit toutes les parties; ne pouvant se dissimuler les avantages de cette harmonie; comblé de bienfaits par le monarque, il conçut le projet d’ajouter quelques rayons à la gloire qui environnoit le trône françois. Ainsi dans ses méditations politiques, il mêloit aux fruits de son éducation, ceux de ses nouvelles observations.
En, développant la situation d’esprit de M. Necker, au milieu de ses travaux ministériels; je ne donne rien aux conjectures, et j’aurai occasion, dans la suite, de dire que la cour elle-même, vers ces derniers jours, s’étoit rapprochée de son systême. C’est en considérant ce ministre sous ce point de vue, qu’on n’est plus étonné de l’apparente contradiction qui se trouve entre ses principes et sa conduite. Dans ses écrits, il ne connoîten France d’autre loi que la volonté du monarque; Richelieu, n’eût pas enseigné des maximes plus favorables à l’autorité absolue; dans sa vie politique, au contraire, il se montre toujours couvert du manteau de la démagogie.
Pour rendre le roi indépendant de toute autre loi que de celle de sa volonté, il falloit abattre les puissances qui invoquoient des loix fondamentales. Pour les abattre, il falloit une force supérieure à celle même du monarque, et il n’y en avoit pas d’autre que celle du peuple. M. Neker eut donc recours à la force du peuple; mais le peuple, s’il connoît tout ce qu’il peut, franchit toutes les bornes. Ainsi, le lion déchire l’imprudent qui brise les barreaux de sa loge.
Ce n’est pas que M. Necker prétendit déployer cette puissance dans toute son étendue. Il se proposoit d’en ménager l’usage, et d’une manière si insensible, que le peuple lui même, ne s’appercevant pas qu’on le faisoit avancer, se seroit arrêté au gré de la main qui l’auroit guidé.
Tout, comme l’on voit, étoit folie dans ce roman. Les dispositions où étoit M. Necker, n’étoient pas inconnues aux novateurs, quoiqu’il eût toujours cherché à envelopper sa conduite, et ses écrits d’un nuage mystérieux. Ils l’entretinrent donc dans ses dispositions, et entrant dans son sens, ils le flaterent des plus folles espérances. Il se convainquit toujours plus qu’il falloit contraindre le clergé, la noblesse et la magistrature, à céder du terrein, et au roi et au peuple. Il ne vit pas de meilleur moyen, pour y parvenir, que de les menacer de ce dernier. De-là, son silence sur les entreprises du tiers-état, sur les outrages des libellistes contre les deux premiers ordres, sur tous les mouvemens qui provoquoient les bourgeois à prendre les armes. De-là, ces ordres bisarres qui présentoient sans cesse l’image de la famine aux yeux du petit peuple, afin de le tenir dans un état de fermentation dont les deux premiers ordres fussent effrayés, et l’on pensoit bien que le clergé et la nobesse, redoutant les suites d’une insurrection qu’on dirigeoit contre eux, se résigneroient à tous les sacrifices qu’on en exigeroit. De-là enfin cette double représentation accordée au tiers-état, qui ne laisseroit plus aucun moyen aux deux premiers ordres d’échapper à l’influence du troisieme; influence que M. Necker avoit la simplicité de regarder comme un instrument qu’il manieroit à sa volonté.
Ceux qui arriverent aux états-généraux, avec un plan de révolution, et avec la ferme intention de l’exécuter, n’eurent garde de développer au ministre, toutes leurs vues. Ils lui persuaderent au contraire, qu’ils n’avoient d’autre but que de seconder les siennes. Sa présomption, son imprévoyance, le firent, tomber dans tous les piéges qu’ils lui dresserent. Il s’étoit flatté qu’il seroit leur oracle et leur guide,&il ne fut que leur complice, jusqu’à ce qu’enfin, ne leur étant plus bon à rien, parce que, pour parler familièrement, il avoit, entierement perdu la tête, ils l’abandonnerent, et n’eurent garde de lui tendre la main, lorsqu’ils le virent se précipiter des marches du trône où ils l’avoient soutenu pendant quelque-tems.
Il s’étonna de la résistance que lui montrerent les commissaires du tiers-état lorsqu’il offrit ses soins et sa médiation pour rapprocher les trois ordres: il en témoigna de l’humeur; son mécontentement perça parmi le peuple qui lui en sut mauvais gré; on dit que sa réputation étoit comme les généalogies, qui, depuis un an, perdoit quatre-vingt pour cent. M. Necker se rassura bientôt; outre qu’il se croyoit fertile en ressources, et toujours maître de tirer, de l’évenement qui arriveroit, des moyens pour parvenir à ses fins, il se persuada aisément, autant par ses fausses conjectures que par les adroites insinuations de ceux qui le leurroient, que si cette premiere victoire restoit toute entiere aux deux premiers ordres, il ne seroit jamais possible de les abaisset et de les faire concourir malgré eux, aux prétendues réformes qu’on vouloit faire dans l’ empire. Il n’étoit, au contraire, que trop aisé de prévoir que si cette première victoire restoit toute entiere au tiers-état, elle alloit être la source d’où découleroit tous les poisons qui dissoudroit la monarchie.
Toute autre idée que l’on se feroit de M. Necker seroit erronée, et ne donneroit aucune intelligence sur les événemens de la révolution; il ne fut pas le Cromwel du siècle; il étoit bien loin d’en avoir le génie; mais il n’en avoit pas non plus les vues. Il seconda les factieux, tantôt ouvertement, tantôt sourdement, dans la seule intention d’effrayer le clergé, la noblesse, la magistrature, d’armer contre eux l’opinion, et de les amener au point où il seroit le maître et l’arbitre de leurs destinées. Ce fut là tout son plan, et je répéte qu’il se promettoit, de son exécution, de grands avantages pour la puissance du roi, et pour la félicité du peuple.
Le clergé et la noblesse entrevoyoient bien le précipice où on les entraînoit, quoiqu’ils n’en connussent pas toute la profondeur. Que pouvoient ils faire? Ils se débattoient avec les seules armes de la justice et de la raison, contre ces légions d’ennemis dont on les environnoit, et dont le nombre grossissoit tous les jours. La situation des deux premieres chambres étoit d’autant plus critique, qu’elles éroient divisées; il étoit indubitable que si une partie d’entr’elles se réunissoit au tiers-état, et que, si le silence du roi autorisoit cette démarche, ceux qui seroient restés fermes à leur poste, n’avoient plus aucune protection à attendre, aucun intérêt à inspirer; ils eussent été représentés et considérés comme des rébelles, et eux-mêmes pouvoient se regarder comme autant de victimes qu’alloient immoler la haîne et le préjugé.
Quant à la magistrature, sa sécurité étoit complette, et ce que la postérité aura peine à croire, c’est qu’à l’instant où alloit se faire la plus terrible explosion, les membres du parlement de Paris s’occupoient de rubans. Ils avoient dressé un réglement qu’ils se proposoient de faire adopter par les états-généraux. L’objet de ce réglement étoit d’établir une distinction ostensible entre les présidens et les conseillers du parlement, ainsi qu’entre les différentes cours souveraines, au moyen d’un ruban qui auroit été attaché a la boutonnière, et d’un noeud d’épée. La couleur du ruban et du noeud d’épée auroit varié suivant les grades de la hiérarchie établie entre les membres et les corps de la magistrature,
Quand on volt le parlement s’occuper gravement de ces puérilités, à l’instant ou l’on allumoit autour de lui le feu de la sédition, on se demande: quel étoit donc le prestige qui fascinoit les yeux des membres de cette compagnie? Cette sécurité suffit: seule pour prouver combien ils étoient éloignés de troubler les opérations des états-généraux, et combien ils étoient impassibles au milieu des manoeuvres qui couvroient la France de factieux et de brigands.
Les citoyens que le tourbillon n’entraînoit point, et qui conservoient assez de sang-froid pour méditer sur ces premières démarches des séditieux, s’allarmoient d’autant plus des suites qu’elles pourroient | avoir, que le petit peuple, en s’élançant vers l’indépendance, développoit déjà un grand caractère de férocité. On a vu dans la première partie de cette histoire les cruautés que la populace exerça sur l’infortuné maire d’Aups. Les mêmes horreurs se renouvellèrent, dans les premiers jours de juin, à Claix, petite ville du Dauphiné. Un huissier, à qui l’on n’avoit d’autre reproche à faire que d’exercer ses fonctions, fut assailli par les habitans auxquels s’étoient réunis ceux d’un autre bourg appelle Cotteys. tous ensemble se jetterent sur ce malheureux; et, avant de l’égorger, gouterent le plaisir barbare de lui faire endurer toutes les sortes de tourmens. Son supplice dura cinq heures, et son cadavre servit encore long-tems de jouet à cette horde d’assassins; voilà le peuple. Mené par lui-même, dit Montesquieu, il porte toujours les choses aussi loin qu’elles peuvent aller; tous les désordres qu’il commet sont extrêmes.
Telle étoit la disposition des esprits, la situation de la cour, de la ville, et des provinces, à l’intéressante époque de la première victoire que le tiers-état remporta sur les deux premiers ordres, et donc je vais écrire l’histoire dans le chapitre suivant.