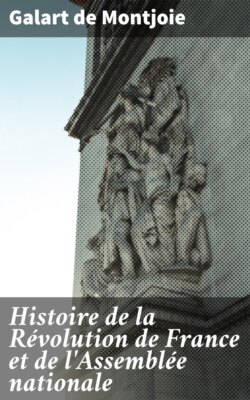Читать книгу Histoire de la Révolution de France et de l'Assemblée nationale - Galart de Montjoie - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE VI.
ОглавлениеTable des matières
Seconde assemblée des notables; soulèvement du tiers-état; nouvelles associations au Palais-Royal; débordement d’écrits incendiaires; scène touchante à Nîmes; mémoire des princes; arrêté remarquable du parlement; conquêtes du tiers-état; libéralités d’un prince du sang.
Novembre et Décembre1788.
LES notables cependant étoient de nouveau assemblés à Versailles, et il n’étoit plus un point dans le royaume, qui ne se ressentit de l’agitation que les efforts impuissans de M. de Brienne avoient imprimés. Déja on calomnioit sans ménagement les intentions des deux premiers ordres et de la magistrature; on sembloit même reprocher à M. Necker, de ne pas énoncer avec assez de franchise l’opinion favorable où il étoit à l’égard du tiers-état. Cette partie de la nation se soulevoit contre le reste de la France. Les principales villes de Normandie énoncèrent leur vœu pour la double représentation. En Languedoc, on s’èlevoit contre les priviléges du clergé et de la noblesse. En Bretagne, dans tous les diocèses, le tiers-état fit scission ouverte avec ces deux ordres; il se retira même de la commission intermédiaire de la province, et la ville de Nantes envoya en cour douze députés chargés d’un mémoire qui ne contenoit que des griefs contre les ecclésiastiques et les gentilshommes. Il est aisé de voir qu’en rompant ainsi d’avance toutes les digues du torrent, on vouloit qu’il entraînât M. Necker: on réussit; il céda à cette commotion qu’il appela le bruit sourd de l’Europe, et dans ces derniers tems, il lui est échappé de dire: si je n’eusse pas accordé au tiers-état la double représentation, il ne fut pas venu aux états-généraux. Foible excuse, qui ne lavera pas ce présomptueux ministre aux yeux de la postérité, du reproche d’avoir violé les lois fondamentales de la monarchie, qu’il étoit appelé à protéger.
Aussi long-tems que dura cette seconde assemblée de notables, le duc d’Orléans se montra peu à Versailles; il ne voulut point présider son bureau, et, par cette conduite, il laissa et la cour et le peuple, dans l’incertitude du parti qu’il se proposoit de prendre. Quant aux autres notables, à l’exception de ceux qui ne composoient pas le bureau de Monsieur, favorable aux prétentions du tiers-état, la malignité les calomnioit; on leur prêtoit les propos les plus absurdes, et qu’aucun d’eux ne tint jamais. De tous ces propos, je n’en citerai qu’un seul, pour faire voir avec quels contes on nourrissoit la crédulité du peuple, et on cherchoit a l’égarer. On supposoit une conversation entre un notable et un membre du tiers-état. «Ces gens-là sont bien heureux, faisoit-on dire au premier, que nous leur permettions de n’être plus serfs.–Et vous, répondit l’autre, vous êtes bien heureux que le tiers-état ne vous assome pas avec les chaînes dont il s’est débarrassé, et que vous voudriez lui faire reprendre». Ces odieuses fables, quelques absurdes qu’elles fussent, étoient propagées avec ardeur, saisies avec avidité, et disposoient le petit peuple à une insurrection.
De tout côte, les prétentions les plus étranges se manifestoient; dans le sein même du parlement, un conseiller osa demander qu’on supprimât des provisions accordées au premier président, ces mots: aussi long-tems qu’il nous plaira; il ne donnoit d’autre raison de cette demande, sinon que cette formule étoit despotique. Le despotisme étoit le cri de ralliement des perturbateurs; on voyoit le despotisme dans les actes d’autorité les plus légitimes. Une femme ayant été arrêtée, parce que, contre les reglemens de la police, elle tenoit chez elle une assemblée scandaleuse de jeu, son mari dénonça cette arrestation au parlement, comme un des abus du despotisme.
Les associations du Palais-Royal devenoient de plus en plus insolentes; on y crioit qu’un roi doit jouir seulement d’un revenu suffisant pour le payement de sa maison, de ses plaisirs, des dons et des graces accordées à ses serviteurs, et qu’il ne doit point toucher au surplus de l’argent déposé au trésor royal. Ces maximes préparoient à d’autres. La cour prenoit ces déclamations pour des extravagances; elle dédaignoit de sévir contre les membres de ces associations, et le roi lui-même se contentoit de leur donner un nom que la raison et la justice ont depuis donné aux membres d’un parti bien plus formidable; S.M. les appeloit les enragés, et c’est toute la vengeance qu’elle tiroit des forcenés qui ont creusé l’abîme où est venu se précipiter le trône.
L’incendie se propageoit, et embrasoit les provinces: la réclamation en faveur de la double représentation étoit presque universelle. En Bretagne, le maire de Vitré s’érigeant, en quelque sorte, en chef de parti, convoquoit tout le tiers-état à Ploërmel; plusieurs habitans de Nantes écrivirent à quelques gentilshommes une lettre de provocation fort insolente; dans cette lettre, faisant allusion à un des quartiers de leur ville, qui s’appelle la Fosse, ils marquoient a leurs adversaires, qu’ils les attendoient sur le bord de la fosse. Les villes de Nîmes, d’Uzès, de Carcassonne, celles du Vivarais et du Gévaudan, firent parvenir au roi des mémoires qui contenoient les mêmes demandes que celles formées par le tiers-état de Bretagne. La ville de Nîmes, dont tant de citoyens ont payé de nos jours, de tout leur sang, leur attachement à la religion et à la patrie, rappella dans sa requête, que la province de Languedoc fut la première, en1355, à accorder des secours pour la rançon du roi Jean, et que les dames de Nimes vendirent leurs joyaux, pour en employer le prix à la rançon de ce roi. Cette preuve de fidélité honora sans doute la province et la ville qui la donnèrent, mais elle étoit commune aux trois ordres.
La conspiration contre les deux premiers étoit donc à-peu-près universelle; et les conjurés ne cachoient plus leurs intentions. Dans un cercle où se trouvoient quelques-uns des hommes, qui depuis ont poussé la multitude à leur gré, l’un d’eux demandoit s’il étoit vrai que les notables ne vouloient favoriser le tiers-état d’aucune concession.–D’aucune, lui répondit-on.–Et pourquoi? demanda-t-il encore.–Parce que, lui fut-il répliqué, ils sont comme cet enfant, qui, déterminé à ne pas apprendre à lire, n’osoit dire A, de peur qu’on ne lui fit dire B.–Eh bien! dit le conjuré, je déclare que la résistance est inutile; car les mesures sont si bien prises, qu’on leur fera dire tout l’alphabet. On voit que la prédiction s’est parfaitement accomplie,
La partie étoit en effet si bien liée, que le public voyoit avec la plus grande indifférence les travaux des notables. Voici quels furent les principaux points du résultat de leurs délibérations; ils furent tous suivis, à l’exception malheureusement du second.
Io. Les états-généraux seront composés de députés de tous les bailliages.
2o. Le nombre des députés de chaque ordre sera égal.
3o. Les lettres de convocation seront adressées aux gouverneurs, et ceux-ci les enverront à chaque bailli ou à son lieutenant.
4o. Les baillis les adresseront aux juges inférieurs de leur ressort.
5o. Quand l’assemblée d’élection sera formée, chaque ordre se retirera à part pour nommer ses députés. Le clergé sera présidé par l’évêque, la noblesse par les baillis d’épée, et le tiers-état par le lieutenant-général du bailliage.
Ce résultat fut à peine connu à Paris, que les écrits scandaleux et les libelles diffamatoires se multiplièrent avec une effrayante profusion. Ils étoient presque tous dirigés contre le parlement, et contre les membres de ce corps. Tels étoient ceux qui avoient pour titre, l’onguent pour la brûlure les protestations de M. Linguet; les gémissemens de Thémis. Ce dernier avoit pour épigraphe: jappelle un chat un chat, et Follet un frippon. Son auteur avoit pour but de ne trouver que des malhonnêtes gens dans un corps de magistrature, qui avoit la vénération de l’Europe entière, et qui avoit donné à la France les hommes les plus vertueux et les plus éclairés. J’indique ces misérables satyres, parce que ceux qui voudront les lire, y connoîtront l’esprit que les factieux cherchoient à répandre sur la France, à la fin de1788.
Ce débordement impur de brochures incendiaires, fixa la sollicitude du bureau présidé par M. le prince de Conty. On y prit à ce sujet une délibératiou que le prince remit à Monsieur, et que Monsieur fit passer à tous les autres bureaux. Ceux de Monsieur et de M. le duc d’Orléans la rejettèrent; ceux du duc de Bourbon et du prince de Coudé y adhérèrent; et celui de M. le comte d’Artois en renvoya l’examen à un autre moment. Dans ce dernier, M. de Castillon, procureur-général au parlement d’Aix, appuya la réclamation du bureau de M. le prince de Conty, et son avis fut qu’il convenoit de solliciter du roi de faire rendre par son conseil un arrêt qui flétrit tous ces écrits. M. de la Fayette combattit cet avis, et prétendit qu’un arrêt du conseil étoit un acte d’autorité arbitraire; que la loi le proscrivoit, et qu’elle seule pouvoit et devoit proscrire ces sortes d’écrits. Je remarque cette opinion de M. de la Fayette, parce qu’on ne peut lui supposer d’autre sens, sinon que celui qui l’énonçoit ne reconnoissoit point les lois alors existantes. C’étoit de bien bonne heure mettre la coignée au pied de l’arbre.
Le respect pour le monarque n’étoit cependant pas encore entièrement oublié: parmi ceux-mêmes qui faisoient valoir avec plus de chaleur les prétentions du tiers-état, le nom et les vertus du meilleur des rois n’avoient pas perdu tout droit à la vénération et à la reconnoissance. Il se passa, en effet, à Nîmes, dans ces premiers momens d’effervescence, une scène qui en est une preuve touchante, et qui doit être consignée dans une histoire de la révolution.
Un jour donc que les comédiens de cette ville avoient annoncé qu’ils représenteroient le drame qui a pour titre Richard-Cœur-de-Lion, les habitans, avant que la pièce commençât, allèrent trouver M. du Caylar, lieutenant de roi, le prièrent de leur permettre de porter une cocarde blanche, et de vouloir bien en porter une lui-même. Cet officier, ayant consenti à une proposition faite aussi respectueusement, fut porté en triomphe jusqu’à la porte de la salle: le peuple marchoit en silence, précédé des tambours et de toute la musique du régiment de Guyenne. Dès qu’on fut arrivé dans la salle, tous les spectateurs la firent retentir des cris vive le roi! vive du Caylar! vive le tiers-état! Un grouppe ensuite des plus notables bourgeois parut sur le théâtre, portant le portrait du roi, couronné et entouré de guirlandes, et le présenta au public: les acteurs se rangèrent en haie, mirent une cocarde blanche à leur chapeau, se couvrirent, par ordre de l’assemblée, et chantèrent, en l’honneur du roi, des couplets qui furent mille fois interrompus par les cris: Vive le roi! vive du Caylar! vive le tiers-état! Le spectacle fini, M. du Caylar fut reconduit chez lui avec la même pompe, le même cortège et les mêmes témoignages d’affection, et pendant toute la nuit, il y eut un concert sous ses fenêtres. J’ai cité d’autant plus volontiers cette anecdocte que l’esprit, qui inspira cette fête, est encore aujourd’hui le même dans la partie la plus nombreuse du peuple de Nîmes; et cette ville jouira auprès de la postérité, de la gloire d’avoir été le théâtre où ont été immolés les premiers martyrs du royalisme.
Tandis que le directeur des finances voyoit, avec une funeste indifférence, circuler le venin qui devoit dissoudre les bases du trône, les princes crurent devoir avertir la vigilance du souverain; ils publièrent un mémoire, dans lequel ils prédirent tous les maux dont nous sommes aujourd’hui affligés. Quant au parlement, sa marche étoit. incertaine; il approuvoit le mémoire des princes, et n’y adhéroit point; il procédoit contre un écrit intitulé: Petition des six corps, et dont on attribuoit la, rédaction à M. Guillotin; il recevoit la dénonciation d’un autre écrit qui a pour titre: Délibération du tiers-état à prendre par toutes les municipalités du royaume. Ce fut l’évêque de Châlons-sur-Marne qui dénonça ce dernier écrit, qu’on fit passer, en effet, à toutes les municipalités du royaume. En le dénonçant, l’évêque de Châlons dit: «La teneur de cet imprimé ne peut laisser de doute que son envoi n’ait eu pour objet de mettre le trouble dans tout le royaume, en excitant le tiers-état contre le clergé et la noblesse».
Le parlement rendit un arrêt contre cette production; quelques jours après toutes les chambres s’assemblerent; les princes et les pairs y furent convoqués: aucun des premiers n’y parut, et parmi les derniers, les seuls ducs de Luynes, de Gêvres, de Luxembourg, d’Aumont, et l’évêque de Châlons, se trouvèrent à la séance, qui fut fort longue. Il en émana un arrêté, duquel on espéroit un grand effet. Il portoit pour titre: Arrêté sur la situation actuelle de la nation. Le parlement y disoit qu’on ne pouvoit concevoir qu’une assemblée fût vraiment nationale, si en la convoquant il ne plaisoit pas au roi de déclarer:
Le retour périodique des états-généraux.
Leur droit d’hyppothèquer aux créanciers de l’état des impôts déterminés.
Leur obligation envers les peuples, de n’accorder aucun autre subside qui ne lût défini et pour la somme et pour le terme.
Leur droit de fixer et d’assigner librement, sur les domaines du roi, les fonds de chaque département.
La résolution du roi de concerter d’abord la suppression de tous les impôts distinctifs des ordres, avec le seul qui les supporte; ensuite leur remplacement avec les trois ordres, par des subsides communs également répartis.
La responsabilité des ministres.
Le droit des états-généraux d’accuser et traduire devant les cours, dans tous les cas intéressant directement la nation entière.
Les rapports des états-généraux avec les cours souveraines, en telle sorte que les cours ne dussent ni ne pussent souffrir la levée d’aucun subside qui ne fût accordée, ni concourir à l’exécution d’aucune loi qui ne fût demandée ou consentie par les états-généraux.
La liberté individuelle des citoyens, par l’obligation de remettre immédiatement tout homme arrêté dans une prison royale, entre les mains de ses juges naturels.
Enfin, la liberté légitime de la presse.
Si la prévention n’eût pas été dès-lors à son comble, la cour et le peuple eussent vu, dans cet arrêté, la route qui devoit conduire sans efforts la nation au plus haut degré de prospérité; il étoit d’autant plus naturel d’y appercevoir cette perspective, que les deux premiers ordres manifestoient déjà l’intention de renoncer à tout privilège pécuniaire. Les pairs adressèrent à ce sujet une lettre au roi, dans laquelle ils le supplioient de recevoir leur vœu de supporter tous les impôts, dans la juste proportion de leur fortune.
Je consigne ici cette lettre comme un double monument, et de la générosité de la noblesse françoise, et de l’injustice de la génération présente.
» Sire, les pairs de votre royaume s’empressent de de donner à votre majesté et à la nation des preuves de leur zèle pour la prospérité de l’état, et de leur désir de cimenter l’union entre tous les ordres, en suppliant votre majesté de recevoir le vœu solemnel qu’ils portent au pied du trône de supporter tous les impôts et charges publics, dans la juste proportion de leur fortune, sans exemption pécuniaire quelconque; ils ne doutent pas que ces sentiments ne fussent unanimement exprimés par tous les autres gentilshommes de votre royaume, s’ils se trouvoient réunis pour en déposer l’hommage dans le sein de votre majesté».
Cette lettre fut signée de tous les pairs.
Les personnes qui méditoient la ruine de la monarchie, étoient peu touchées de ces sacrifices, qu’elles représentoient comme des signes de crainte, et des avances qu’on n’avoit pas envie de réaliser. Le peuple étoit trompé par ces insinuations, et toutes les intrigues qu’on mettoit en jeu pour tenir toujours le pain à un prix élevé, entretenoient son inquiétude et son mécontentement, qu’augmentoit encore l’excessive rigueur de l’hiver.
L’arrêté du parlement, bien loin de ramener les esprits, fut tourné en dérision. M. d’Eprémesnil, qui l’a voit rédigé, publia en même tems des réflexions fort sages, qu’il fit précéder de cette épigraphe, qui contenoit sa profession de foi.
Assurer à chacun ses légitimes droits,
Et mourir, s’il le faut, pour fonder sur les lois
La liberté, la paix, la fortune publique,
Voilà mes vœux, voilà toute ma politique.
Tel étoit donc l’aveuglement, que l’arrêté et les reflexions, bien loin de chauger la dispositions des esprits, donnerent lieu à de fades plaisanteries, qui contribuèrent encore à égarer l’opinion.
Parmi ces plaisanteries, j’en dois distinguer une que les personnes attentives à la marche que prenoient les affaires purent regarder comme une véritable prophètie. Le parlement donc ayant, à l’occasion du mémoire des six corps dont j’ai parlé plus haut, mandé le médecin à qui on en attribuoit la rédaction, ainsi que les notaires qui recevoient les signatures du tiers-état, on fit circuler cette épigramme, qui fut saisie avec avidité par les ennemis du parlement, dont le nombre grossissoit tous les jours.
Le parlement touche-t-il à sa fin?
Il mande, à ce que l’on publie,
Le notaire et le médecin:
Ah! que cela sent Vagonie!
Quoique les deux premiers, ordres fussent encore dans la sécurité, et que ceux qui les composoient ne pussent pas prévoir que cette prophètie les regardoit également, cependant quelques nobles n’attendirent pas plus long-tems pour aller au-devant de la nouvelle puissance qui s’avançoit. Un gentilhomme entr’autres, de la maison de Noailles, qui depuis un siècle attiroit à elle la plus grande partie des bienfaits de la cour, l’abandonna, et vint se ranger sous la bannière du tiers-état. Un propos qu’on supposoit qu’il avoit tenu en faveur de cet ordre, donna lieu à deux couplets que je rapporte pour montrer l’opiniâtreté avec laquelle on s’efforçoit de persuader que le clergé et la noblesse, quoiqu’on sut bien le contraire, ne vouloient point contribuer aux charges de l’état.
Un grand voulut prouver que
La France est dans Versailles,
Qu’il faut faire la banque-
Route, et que le tiers n’est que
Canaille, canaille, canaille.
Noailles rit, et répliqua:
Si le tiers est canaille,
Par fierté nous n’avons qu’à
Payer tout pour lui, jusqu’à
La taille, la taille, la taille.
Mais de toutes les conquêtes du tiers-état, aucune ne fut plus importante pour lui que celle qu’il fit parmi les princes même du sang. L’un d’eux, qui jusques-là ne s’étoit livré qu’à des spéculations d’intérêt, qui, pour accroître son patrimoine, avoit eu recours à des voies que je ne veux appeller qu’odieuses, qui enfin avoit toujours bravé et méprisé l’opinion publique, devint tout-à-coup libéral et populaire. Etoit-ce donc par un pressentiment de ce qu’il seroit un jour, qu’un de ses a yeux eut tant de peine à le enter sur la tige des Bourbons?
Saisissant la circonstance de la rigueur excessive d’un hiver si froid qu’aucun homme de la génération actuelle ne se souvenoit d’en avoir vu un semblable, il se livra à des prodigalités que toutes les trompettes de la renommée, que tous les journalistes publièrent avec emphase, et qui le rendirent cher au petit peuple.
Parmi ces libéralités, je n’en citerai qu’une seule, que je ne vois point consignée dans les journeaux du tems. Ce prince passoit un jour dans un des quartiers éloignés du fauxbourg Saint-Germain; il étoit seul dans son cabriolet; il parut ému de l’image de misere qui se présentoit de toute part à lui. Arrivé près le palais Bourbon, il apperçoit deux remises à louer; il s’avance vers la maison qui étoit vis-à-vis, et demande à qui elles appartiennent. On fait venir le propriétaire; le prince les lui loue pour six mois, et trois heures après on vit arriver dans ces remises des cuisines de campagne. Des cuisiniers même du prince y faisoient rôtir de fortes pièces, qu’on distribuoit aux malheureux, avec le pain qui leur étoit nécessaire.
De pareilles générosités étoient répétées dans presque tous les quartiers, et elles étoient sans bornes dans une des principales paroisses de la capitale. Les gens éclairés s’en alarmèrent, et la multitude, qui n’avoient jamais pu estimer ce prince, commença à lui témoigner moins de mépris et d’aversion. Je ne veux point sonder les motifs de la haine secrete qu’on lui supposoit pour ses souverains et plus particulièrement pour la reine; mais si cette haine étoit réelle, il est vraisemblable que, croyant l’occasion favorable pour ne plus contraindre ses penchans, il l’auroit saisie avec joie, et se seroit enfoncé dans ce labyrinthe, dont n’auroient pu ensuite le tirer les forfaits du6octobre; et dans cette supposition, il faudroit ajouter foi a l’opinion qui veut qu’il ait été, tout-à-la-fois, l’instrument et le moteur des hommes les plus vils du royaume; il est vraisemblable encore qu’aux premières idées de vengeance, se seroient bientôt mêlés les mouvemens d’une ambition que le régicide seul auroit pu satisfaire.
Ici finit l’histoire des convulsions qui ont précédé l’anéantissement de la monarchie; ici commence un nouvel ordre de chose. Tout ce qui suit est l’histoire même de la révolution; elle naît à l’époque où furent promulguées les lettres pour la convocation des états-généraux. Dès cet instant, les opinions, les hommes, les événemens, tout se dirige avec rapidité vers le but où une force irrésistible semble nous avoir entraînés.