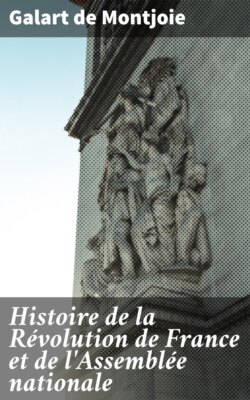Читать книгу Histoire de la Révolution de France et de l'Assemblée nationale - Galart de Montjoie - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE XXII
ОглавлениеTable des matières
NOUVEAUX doyens; portrait de M. Bailly; tentatives du tiers-état de communiquer directement avec le roi; issue de cette tentative; premier discours de cet ordre au roi; réponse de sa majesté; arrêté des trois chambres sur les voies de conciliation, proposées par M. Necker; lettres de cachet; contes populaires; paroles de bienfaisance portées par le clergé; rumeur et mécontentement qu’elles occasionnent dans le tiers-état; portrait de M. Populus; réponses du tiers-état et du roi à la proposition du clergé.
Suite de Juin1789.
Le grand âge de M. le Roux lui rendant ses fonctions extrêmement pénibles dans une assemblée tumultueuse où il falloit une force physique peu ordinaire pour établir au moins une apparence d’ordre, il demanda un successeur. On lui en nomma un, à la pluralité des voix, le premier juin. Le choix tomba sur M. d’Ailly, qui, comme son prédécesseur, est resté jusqu’à ce moment dans l’obscurité. Le regne de M. d’Ailly ne fut pas de longue durée. Monté sur le trône du tiers-état le premier juin, il en descendit le3du même mois. La foiblesse de sa santé, et celle de sa voix, dit le journal de Paris, dans une assemblée où une voix étendue paroît nécessaire, ne lui ont permis de remplir ses fonctions que pendant deux ou trois séances.
C’est ainsi que les journaux racontent l’histoire du jour. La vérité est qu’à peine M. d’Ailly, fut nommé doyen, que M. Necker s’en empara, et en cela le ministre ne donnoit pas une grande preuve de jugement. M. d’Ailly n’étoit point initié dans les mystères de la révolution, et il n’avoit aucun moyen d’acquérir de l’influence sur sa chambre. Simple et droit, il ne refusa pas une conférence secrete que lui proposa le ministre; on le sut dans la chambre du tiers-état, et on lui en fit un crime; le mécontentement qu’on lui témoigna, et dans le particulier et en public, l’obligea de donner sa démission, qui fut acceptée. Il fut remplacé par M. Bailly, que nous avons vu depuis, et que nous voyons encore aujourd’hui, jouer un rôle pour lequel il sembloit si peu fait.
M. Bailly, né de parens obscurs, s’est élevé insensiblement, et sans effort. Il n’a point été poussé dans la route de la fortune; elle s’est ouverte devant lui; il l’a parcourue paisiblement, parce qu’il n’a jamais trouvé de concurrent. Confondu, dès sa jeunesse, avec le petit nombre de savans de la capitale, il n’inspira jamais de jalousie à aucun d’eux. Dans les cercles où ils se rassembloient, il écoutoit avec docilité, ne donnoit point son avis, et se bornoit à proposer modestement des doutes. Sans intrigue, en apparence, sans ambition, il ne blessoit ni les prétentions, ni l’amour-propre de personne; on l’avoit, dans les différentes sociétés où il étoit admis, surnommé le bon-homme Bailly. Les gens de lettres, en un mot, et les savans, le regardoient moins comme un rival, que comme un adepte, que comme un protégé. Il fut reçu successivement dans chacune des trois académies, sans avoir paru s’être donné aucun mouvement pour obtenir cette triple couronne. Il y entra plutôt comme la créature que comme l’égal de chacun des membres qui les composoient. Il ne faisoit point ombrage, et ceux qui l’avoient élevé, se croyant des droits à sa gratitude, se trouvoient bien plus flattés qu’humiliés de son élévation.
Sans avoir une grande étendue de connoissances; &quoiqu’il ne fut doué que d’un esprit ordinaire, M. Bailly, cependant, nourri, dès son enfance, des bons auteurs, et ayant toujours vécu avec des hommes enrichis de tous les trésors de la littérature et des sciences, se trouva capable d’obtenir du succès dans la république des lettres. Ses ouvrages ne lui firent point d’envieux; mais aussi la considération qu’ils lui acquirent, fut paisible comme son caractère. Comme il ne donnoit ses livres au public qu’après en avoir long-tems confié le manuscrit à ceux qui dirigeoient l’opinion, et leur avoir laissé la liberté d’y faire tous les changemens, qu’ils jugeroient à propos; il arrivoit que, lorsque ces livres paroissoient, chacun de ceux qui auroient pu les critiquer, les regardant comme sa propre production, la satyre n’ôtoit rien à la gloire de l’auteur. Son seul écrit sur l’Atlantide, trouva un censeur; ce censeur étoit un journaliste obscur, ignorant et mal famé. Le jugement d’un tel homme, bien loin donc de nuire au succès de l’écrit, fit présumer qu’il en étoit digne; et, ce qui contribua à accroître la présomption, ce fut le silence de tous ceux qui étoient réellement capables d’apprécier l’ouvrage.
Jusqu’au moment où se formèrent, à Paris, les assemblées primaires, pour la convocation des états-généraux, M. Bailly n’avoit pris aucune part aux affaires publiques; il se trouva cependant dans son district; il y parla peu; personne ne le connoissoit; mais le peu qu’il dit, son air de bonhommie, le préjugé qu’inspiroit en sa faveur son aggrégation à trois académies, lui firent trouver place parmi les électeurs. Dans cette nouvelle assemblée, il parla davantage, et commença à se faire remarquer; mais ceux qui le connoissoient particulierement le croyoient si peu propre à se montrer avec éclat aux états-généraux, que je me souviens que les gens de lettres, lorsqu’on parloit de ce qui se passoit dans les séances des électeurs du tiers-état, faisoient toujours cette question: mais que fait là le bon-homme Bailly?
Je me souviens encore que la plupart des électeurs répondoient à cette question, qu’ils n’avoient nulle intention de lui donner leur suffrage pour la députation; et lorsqu’il eût été nommé, les électeurs disoient qu’ils ne savoient comment cela s’étoit fait.
En parlant un peu plus, M. Bailly se fit un peu plus connoître, et il gagna à être connu. Il montra beaucoup d’intérêt pour la cause du peuple contre celle de la cour; et comme il ne tenoit rien du peuple; comme il n’avoit aucun patrimoine, et ne vivoit que des bienfaits du roi, on prit la conduite qu’il commençoit à tenir, pour de la générosité, pour du désintéressement; parce qu’on présumoit qu’en se rangeant parmi les détracteurs des ministres, il renonçoit à leur appui, et pouvoir, à tout instant, descendre au dernier degré de la misère.
M. Bailly n’étoit pas assez borné pour ne pas comprendre qu’ayant une fois manifesté un systême qu’il croyoit devoir déplaire aux ministres, il n’avoit plus rien à attendre de la faveur ni des graces de la cour. Il lui falloir donc se jetter dans une autre route, et il se jetta en effet dans celle qui lui fut montrée en arrivant a Versailles. On l’initia dans les mystères, non qu’on attendit beaucoup de ses talens et de son intelligence; mais il réussit auprès des novateurs, comme il avoir réussi auprès des savans, c’est-à-dire, en ne faisant ombrage à personne, en montrant beaucoup de complaisance, et en promettant un grande docilité.
Les autres hommes ne parviennent qu’en nourrissant dans leur coeur tous les feux de l’ambition; elle éclate au-dehors malgré eux; toutes leurs démarches, leurs discours, leurs écrits, portent l’empreinte de cette passion. M. Bailly est peut-être le seul exemple, dans tous les siecles, d’un homme qui soit parvenu, précisément par la raison qu’il n’avoit montré aucune ambition.
Les mêmes raisons qui avoient élevé M. Bailly, l’ont maintenu. Il ne pouvoit trouver en lui-même aucune ressource, ni pour appeler, ni pour fixer la fortune. Etranger à toutes les sciences du gouvernement desétats, il a seulement une certaine aptitude pour celles qui sont à la portée d’un homme de lettres, doué d’un esprit ordinaire. Sans énergie dans le caractère, il est lent à concevoir, lent à parler, lent à agir. Cette lenteur lui étoit avantageuse, et dans la tribune, et sur le fauteuil du président. Le tems qu’il mettoit à articuler une phrase, lui donnoit celui de prévoir et de composer la phrase suivante. Dans l’intervalle de l’une à l’autre, le coup-d’oeil qu’il jettoit sur ceux dont il étoit la créature, l’instruisoit de ce qu’il devoit dire ou taire. Sans compter que la multitude, qui ne juge que d’après les apparences, prit d’abord pour sagesse ce qui n’étoit qu’indolence.
L’extérieur de M. Bailly est l’image de son caractère. Toutes les parties de son visage, toutes les formes de son corps sont dessinées avec roideur et à longs traits. Sa chevelure longue et touffue surcharge plus qu’elle n’orne sa tête; son front se développe sans grace; ses yeux noirs sont sans feu, ses joues sans couleur, sa bouche sans expression; et cet ensemble présente une physionomie inanimée. Je ne doute point que si le célèbre physionomiste de ce siècle, si l’observateur Lavater eût vu M. Bailly à la tribune, et ne l’eût pas entendu parler, il ne se fût écrié: voilà l’image de la stupidité.
Peut-être Lavater ne se fût-il pas trompé; peut-être M. Bailly ne doit-il qu’à l’éducation, qu’à l’application constante à l’étude des belles-lettres, qu’à son commerce avec les savans, la portion d’esprit dont il jouit. Son jugement d’ailleurs est peu sain; ses vues sont étroites; ses desirs n’ont jamais été au-delà de la situation où il se trouvoit dans l’instant, et aujourd’hui il n’aime, dans sa place, que les émolumens qui y sont attachés, que le puérile avantage qu’elle lui procure de s’environner d’un certain faste. C’est un enfant qui, dans ces jeux, imite l’opulence et les airs des grands seigneurs; cette petite vanité est la seule passion dont l’ame de M. Bailly semble susceptible.
Tel fut l’homme que l’on donna pour successeur à M. d’Ailly; les novateurs le virent avec plaisir à ce poste; la jalousie d’aucun d’eux n’en étoit blessée, et tous se félicitaient de posséder un instrument qu’ils manieroient à leur gré, et feroient servir à l’ exécution de leurs desseins.
Le tiers-état, lorsque M. Bailly fut nommé son doyen, faisoit éclater une prétention qui annonçoit assez clairement jusqu’où vouloit aller cet ordre. Par un usage aussi ancien que la monarchie, M. le garde des sceaux recevoit ses députés, et lui transmettoit les volontés du roi. Le tiers-état qui voyoit que le clergé et la noblesse, par un privilège inhérent à leur existence, communiquoient directement avec le monarque, se sentit humilié de cette distinction, et voulut proscrire cet usage fondamental. Ayant projette d’envoyer une nouvelle dépuration aux pieds du trône, il prit cet arrêté.
«Les communes ne pouvant reconnoître d’intermédiaire entre le roi et son peuple, s’adressent dès ce moment à sa majesté, par l’organe de M. le doyen, pour la supplier d’indiquer aux représentans des communes le jour et l’heure où elle voudra bien recevoir leur députation».
Cet arrêté fut remis à M. Bailly, et il lui fut enjoint de sadresser au roi lui-même. Versailles et Paris attendirent avec impatience l’issue de cette mission. Si le roi recevoit la députation, il approuvoit les erreurs contenues dans cet arrêté où l’on confondoit les représentans des communes avec les communes; il étoit censé approuver la nouvelle dénomination que prenoit le tiers-état; enfin, il consentoit à ce qu’il ny eut plus d’intermédiaire entre sa personne et le troisième ordre, et ce consentement étoit une première brèche aux fondemens de la monarchie.
4.
Le jour où M. Bailly tenta de s’acquitter de sa commission, étoit le jour où le royaume perdit M. le dauphin. Il se présenta au capitaine des gardes qui l’ annonça au roi. Sa majesté répondit qu’il falloit employer les voies ordinaires, et s’adresser à M. le garde des sceaux. Le doyen se rendit donc chez le ministre; celui-ci fît parvenir au roi une lettre à laquelle sa majesté répondit par le billet suivant:
«Il m’est impossible, dans les circonstances où je me trouve de voir M. Bailly ce soir ou demain matin, ni de fixer un jour pour la députation. Montrez mon billet à M. Bailly pour sa décharge.»
Le roi, par ce billet, ne refusoit pas d’admettre, devant sa personne, la députation; c’étoit une condescendance; mais le tenus étoit venu où l’on n’obtenoit plus rien par des condescendances, et où il falloir tout céder. La lecture de ce billet excita, dans la chambre du tiers-etat, de violens murmures. La position douloureuse, cependant, où se trouvoit le roi, par a grande perte qu’il venoit de faire, méritoit bien quelques égards. On ne peut donc qualifier le mécontentement que témoignoient quelques députés du tiers, que d’insolence; cette insolence en présageoit bien d’autres.
La bonté du roi, et la nécessité où l’on étoit de ne point effaroucher des esprits ardens et intéresses a donner l’alarmé, déterminerent le roi à se rendre aux desirs que manifestoit la chambre du tiers. La reine avoit été également priée de recevoir une dépuration et comme son auguste époux, elle déféra a cette demande. Madame la princesse de Chimay sa dame d’honneur, fit parvenir à M. Bailly un billet conçu à-peu-près en ces termes;
«Madame de Chimay reçoit dans l’instant la réponse de la reine. Sa majesté lui donne ordre d’annoncer à M. Bailly qu’elle recevra avec bonté et sensibilité l’hommage et les respects de l’ordre du tiers-état; mais que la juste douleur où la reine est plongée ne lui permer pas d’en fixer le moment»
Quant au roi, M. le garde des sceaux fît savoir ses intentions à M. Bailly, par le billet suivant:
«M. le garde des sceaux prévient M. Bailly qu’il sort de chez le roi, où il étoit monté pour prendre ses ordres sur la députation. Quoique sa majesté soit dans la plus profonde affliction, et que jusqu’ici elle n’ait voulu voir personne, le roi recevra cependant demain la députation du tiers-état, entre onze heures et midi; son intention est que la députation soit au nombre de20».
La forme, le style de ces billets, la manière dont les intentions de leurs majestés parvenoient à la chambre, retenoient au moins quelque chose des usages anciens. Ils sont bien changés; le souvenir même en est perdu; les ministres écrivent aujourd’hui des lettres soumises, et les terminent par la formule: Je suis avec respect.
C’étoit donc là une première victoire. La députation fut en effet composée de20membres tirés au sort; au nombre de ceux qu’il favorisa, se trouverent MM. Tronchet, Chapelier, Rabaud de S.-Etienne, Target, Mounier, Redon, Thouret, Bouche, Volney, Ronqueville, Terrasse, Villeson, Garat, Chorier, Mirabeau, Legrand, Descottes, etc.
Ces députés, ayant à leur tête M. Bailly, furent6 introduits dans la salle du conseil, à raidi, et le doyen prononça au nom de tous, le discours suivant; ce sont les premières paroles que les députés du tiers-état de France ayent adressées directement au roi; elles sont précieuses à recueillir.
SIRE,
«Depuis long-tems les députés de vos fidelles com. munes auroient solemnellement présenté à votre majesté, les respectueux témoignages de leur reconnoisance pour la convocation des états-généraux, si leurs pouvoirs avoient été vérifiés; ils le seroient, si la noblesse n’avait élevé des obstacles. Dans la plus vive impatience, ils attendent l’instant de cette vérification pour vous offrir un hommage plus éclatant de leur amour pour votre personne sacrée, pour son auguste famille, et de leur dévouement aux intérêts du monarque, inséparables de ceux de la nation».
«La sollicitude qu’inspire à votre majesté l’inaction des états généraux, est une nouvelle preuve du désir, qui l’anime, de faire le bonheur de la France».
«Affligés de cette funeste inaction, les députés des communes ont tenté tous les moyens de déterminer ceux du clergé et de la noblesse, à se réunir à eux pour constituer l’assemblée nationale; mais la noblesse ayant manifesté de nouveau la résolution de maintenir la vérification de ses pouvoirs, faite séparément, les conférences conciliatoires, entamées sur cette importante question, se trouveroient terminées»
«Votre majesté a desiré qu’elles fussent reprises en présence de M. le garde-des-sceaux, et des commissaires que vous avez nommés. Les députés des communes, certains que sous un prince qui veut être le restaurateur de la France, la liberté de l’assemblée nationale ne peut être en danger, se sont empressés de déférer au desir qu’il leur a fait connoitre. Ils sont bien convaincus que le compte exact de ces conférences, mis sous ses yeux, ne lui laissera voir, dans les motifs qui nous dirigent, que les principes de la justice et de la raison».
«Sire, vos fidelles communes n’oublieront jamais ce qu’elles doivent à leur roi. Jamais elles noublieront cette alliance naturelle du trône et du peuple, contre les diverses aristocraties, dont le pouvoir ne sauroit s’établir que sur la ruine de l’autorité royale et de la félicité publique. Le peuple françois qui se fit gloire, dans tous les tems, de chérir ses rois, sera toujours prêt à verser son sang, et à prodiguer ses biens, pour soutenir les vrais principes de la monarchie. Dès le premier instant où les instructions que ses députés ont reçues, leur permettront de porter un vœu national, vous jugerez, sire, si les représentans de vos communes ne sont pas les plus empressés de vos sujets à maintenir les droits, l’honneur et la dignité du trône, à consolider les engagemens publics, et à rétablir le crédit de la nation. Vous reconnoîtrez aussi qu’ils ne seront pas moins justes envers leurs concitoyens de toutes les classes que dévoués à votre majesté».
«Vos fidelles communes sont profondément touchées de la circonstance où votre majesté a la bonté de recevoir leur députation, et elles prennent la libert de lui adresser l’expression de tous leurs regrets, e de leur respectueuse sensibilité».
Ce langage étoit au moins respectueux; mais quelle perfidie dans des promesses qui ont été si cruellement trompées! On s’apperçoit sans peine, en lisant ce discours, qu’il avoit été étudié, et qu’on s’y étoit surtout attaché à voiler les projets de révolution qu’on étoit impatient d’exécuter. Mais il eût été aisé de les entrevoir dans cette alliance naturelle du trône et du peuple, contre les diverses aristocraties dont on disoit que le pouvoir ne pouvoit s’établir que sur la ruine de l’autorité et de la félicité publique.
C’étoit là précisément le systême de M. NecKer; c’étoit là, du moins, tout ce qu’on lui avoit laissé appercevoir de la carrière qu’on alloit parcourir, et cette phrase jettée ainsi, en apparence, au hasard, sembleroit faire croire qu’on avoir quelque espoir de rendre le roi lui-même complice des factieux, en lui insinuant qu’il étoit de l’intérêt de son autorité de laisser écrâser toutes les aristocraties, c’est-à-dire, les deux premiers ordres et la magistrature; car cest là évidemment ce qu’on entendoit par aristocraties, afin qu’il n’y eût plus en France que le roi et le peuple. Louis XVI que le ciel a favorisé, entr’autres qualités, d’un grand sens, d’un jugement exquis et d’un esprit droit, n’a jamais donné dans ce piège, quoiqu’on ait tenté plus d’une fois de l’y attirer; mais il nen est pas moins vrai que cette phrase étoit captieuse; qu’elle déceloit les vues du moment, et que le venin qu elle contenoit auroit pu se glisser dans le coeur d’un prince moins sage que Louis XVI.
C’étoit au reste un mensonge grossier, et qu’il ne falloit pas porter aux pieds du trône, de prétendre que le pouvoir des diverses aristocraties, c’est-à-dire des deux premiers ordres, et des cours souveraines, ne pouvoit s’établir que sur la ruine de l’autorité et de la félicité publique. Jamais l’autorité et la félicité publique ne furent mieux assurées que dans les beaux jours de Louis XIV; et à quelle époque le clergé a-t-il joui de plus de priviléges, la noblesse de plus de gloire, et la magistrature de plus de tranquilité dans ses fonctions?
Le tiers-état, en se donnant, dans ce discours, la qualification qu’il avoit usurpée, de communes, esperoit peut-être que les expressions que le roi employeroit dans sa réponse, confirmeroient l’usurpation. Sa majesté sût se préserver de cette nouvelle surprise; elle répondit ainsi:
«Messieurs, je reçois avec satisfaction les témoi gnages de dévouement, et d’attachement à la monarchie, des représentans du tiers-état de mon royaume. Tous les ordres ont un égal droit à mes bontés, et vous devez compter sur ma protection et ma bienveillance. Je vous recommande, par dessus tout, de seconder promptement et avec un esprit de sagesse de paix, l’accomplissement du bien que je suis patient de faire à mes peuples, et qu’ils attendent avec confiance de mes sentimens pour eux».
Le tiers-état obtint donc que ses députés pussent parler directement au roi: ce fut là sa premiere victoire; mais la grande querelle sur la vérification des pouvoirs, en commun ou séparément, restoit toujours indécise. Falloit-il accepter ou refuser les voies de conciliation proposées, par M. Necker, au nom du roi? C’étoit l’importante question que les trois chambres avoient à résoudre.
Le clergé accepta le projet de conciliation purement et simplement; la noblesse avec des amendemens; elle prit l’arrêté suivant:
«L’ordre de la noblesse, aussi empressé de donner au roi des témoignages de son respect et de sa confiance dans ses vertus personnelles, que de prouver à la nation entière le désir d’une conciliation prompte et durable, et fidèle en même tems aux principes dont il n’a jamais cru pouvoir s’écarter, reçoit avec la plus vive reconnoissance les ouvertures que sa majesté lui a fait communiquer par ses ministres; et sans s’expliquer sur quelques principes du préambule, a chargé les commissaires de rappeler, à leur prochaine séance, que la noblesse avoit arrêté précédemment qu’elle vérifieroit dans son sein ses pouvoirs, et prononceroit sur les contestations qui surviendroient sur leur validité, lorsqu’elles n’intéresseroient que ses députés particuliers, et en donneroit une connoissance officielle aux autres ordres».
«Quant aux difficultés survenues ou à survenir sur des dépurations entières, pendant la présente tenue d’états généraux seulement, chaque ordre chargera ses commissaires de les discuter avec ceux des autres ordres, pour que, sur leur rapport, il puisse y être statué d’une manière uniforme dans les trois chambres séparées; et au cas que l’on ne pût y parvenir, le roi sera supplié d’être leur arbitre».
Cet arrêté pouvoit être fort sage; mais à quoi Servent les arrêtés, quand, avant de les faire, on n’a pas la certitude d’en pouvoir obtenir l’exécution?
Quant au tiers-état, la question y fut assez brusquement résolue, parce que la solution, comme il est presque toujours arrivé depuis, avoit été prévue avant qu’on se rendît dans la salle. Cependant comme ce jour-là, elle contenoit un peuple immense, quelques-uns des membres les plus sages proposèrent de faire retirer tous les étrangers, afin que leurs mouvemens et leurs passions ne pussent pas influer sur une délibération aussi grave.
Mais à peine cette proposition fut-elle énoncée, que tous les autres députés, ayant M. de Mirabeau à leur tête, s’écrierent: «la présence du public est l’appui de nos consciences»; ils demandèrent ensuite qu’il ne fût plus question d’un pareil avis. L’expérience n’a cessé de prouver, jusqu’à ce moment, que la présence du public admis aux séances et toujours choisi par la majorité, a bien plutôt été l’appui des factions que celui des consciences.
On mit donc la question aux voix en présence de cette bruyante cohue; elle fut ainsi posée: discutera-t-on le projet de conciliation avant ou après la clôture des conférences? On alla aux voix, et on étoit tenu de répondre, avant ou après. Quatre cent trente-deux membres se décidèrent pour le mot après, et vingt-deux seulement pour le mot avant. M. Malouet fut du nombre de ces derniers; il étoit déjà tombé dans une grande défaveur; il fut hué même avant d’ouvrir la bouche, et son opinion fut perdue.
M. de Mirabeau au contraire qui, non-seulement s’étoit déclaré pour l’avis qui flattoit le plus la multitude, mais qui avoit encore voté pour que le public fut irrévocablement admis aux séances, vit, dès ce jour, son crédit s’accroître auprès du peuple.
Sur la même question donc, les trois ordres avoient pris un arrêté différent; le premier adoptoit aveuglément le projet de conciliation; le second, par les restrictions dans lesquelles il se renfermoit, le rejettoit plutôt qu’il ne l’admettoit, et le troisième ne vouloit pas même dire s’il l’adoptoit ou s’il le repoussoit; ainsi ce traité de paix, bien loin de desarmer les trois partis, allumoit plus que jamais la guerre entr’eux. Quel jugement porter des lumières du ministre qui ne prévoyoit pas ce résultat?
Le public craignit que cette diversité d’opinions, et la continuation des conférences n’entraînassent encore des longueurs; et les délais commençoient à fatiguer les hommes les plus modérés. Ceux qui ménoient la multitude, en rendant le clergé et la noblesse responsables de ces délais, marchoient à leur but.
Deux événemens qui, dans un autre tems, n’eussent pas même été apperçus, fournirent encore aux mécontens un prétexte de rendre odieux les membres de l’administration. Les agens de la police enlevèrent, à Versailles, un peintre, sans aucune forme de procès. A Paris, on saisit, au milieu de la nuit, un écrivain qui avoit rédigé, pendant quelque tems, la Gazette d’Utrecht, et qui, au moment où on s’empara de sa personne et de ses papiers, étoit, dit-on, occupé à la traduction d’un ouvrage anglois peu favorable à notre gouvernement.
Il faut convenir que l’occasion n’étoit pas propice pour exercer ces sortes d’actes d’autorité suprême; car le clergé et la noblesse n’aimoient pas plus les lettres de cachet, que le tiers-état; et puisque c’étoit-là le reproche qu’on faisoit unanimement aux ministres, ceux-ci eussent dû ménager au moins, à cet égard, l’opinion générale.
En attendant que les débats entre les trois ordres fussent terminés, les factieux ne perdoient par leur teins; ils avoient déja pris assez d’informations pour connoître, dans les différentes chambres, ceux qu’il seroit impossible d’entraîner à la sédition, et c’étoit ceux-là qu’on s’attachoit à calomnier. La haine se fixoit surtout avec acharnement sur MM. Malouet et d’Epréniesnil, bien différens cependant d’opinion. On vous disoit sérieusement, dans les cercles de la capitale, qu’ils étoient fort avant dans l’intimité non-seulement de madame de Polignac, mais encore de la reine; et que lorsqu’ils n’étoient pas à la table de la gouvernante des enfans de France, ils étoient à coup sûr à celle de la souveraine.
Il n’est pas étonnant qu’on s’étudiât à décrier particulièrement MM. Malouet et d’Eprémesnil. On redoutoit la prépondérance que le mérite de ces deux hommes donneroit nécessairement au parti qu’ils épou-seroient.
De quels autres contes n’amusoit-on pas l’aveugle crédulité d’un peuple le plus facile de tous les peuples à être trompé? On alla jusqu’à répandre que les anglois armoient dans l’intention de venir soutenir les prétentions du tiers-état, et j’ai vu, dans cette bonne ville de Paris, des bourgeois s’encourager mutuellement à tout oser, dans l’espoir que leurs entreprises alloient être soutenues par toute la force des trois royaumes de la grande Bretagne.
Les trois chambres ayant donc chacune pris un parti différent à l’égard du projet de conciliation, se communiquèrent mutuellement leur arrêté; c’étoit une déférence de pure honnêteté; elle n’adoucissoit point les esprits, et n’avançoit en aucune manière la conclusion après laquelle tous les partis soupiroient avec une égale ardeur.
Le clergé répondit aux députés qui lui apportèrent l’arrêté du tiers-état, qu’il étoit satisfait de l’attention avec laquelle cet ordre l’instruisoit de routes ses démarches; la noblesse demanda copie de l’arrêté, et les noms des députés.
Ces deux réponses mécontentèrent le troisième ordre; il crut appercevoir, dans la premiere, le ton de la protection, et dans la seconde, celui de la hauteur.
Mais ce qui contribua infiniment à accroître la haine du tiers-état contre les ecclésiastiques, ce fut une ambassade de leur chambre, à laquelle le troisième ordre n’etoit nullement préparé. L’incertitude où l’on étoit des événemens qui se préparoient, nuisoit infiniment et au crédit, et à toutes les opérations qui ont pour bâse la confiance publique. La misère des peuples sembloit à son comble.
Le clergé crut que les ministres d’un Dieu de paix et de charité devoient, par eux-mêmes, et par leurs représentations auprès de leurs autres co-députes aux états-généraux, adoucir les malheurs particuliers. Comme, d’un côté, les maux qui sollicitoient un remède étoient extrêmes, comme, de l’autre, personne ne pouvoit dire quand finiroient les débats qui empêchoient de s’occuper en commun de la chose publique, les ecclésiastiques pensèrent qu’en attendant la décision de cette querelle, il étoit possible de venir au secours des malheureux.
Ils arrêterent donc que les membres du clergé, profondément touchés de la misère du peuple et de la cherté des grains, avoient pensé, pour remédier à ces malheurs publics, qu’il falloit nommer, dans les trois ordres, une commission composée de députés des différens gouvernemens, pour aviser au moyen de faire diminuer le prix du pain.
Soyons de bonne-foi: si l’intérêt du peuple, et surtout de la classe la plus misérable du peuple, eût été la seule passion de ses représentans, n’auroient-ils pas saisi avec avidité cette ouverture de faire un grand bien? La circonstance y étoit très-propre, car on ne pouvoit employer plus utilement son tems, en attendant l’issue des conférences; et à qui appartenoit-il mieux qu’aux ministres de la religion, de se faire les organes des malheureux?
Cet arrêté cependant, dont M. le cardinal de la Rochefoucault, fit connoître les dispositious au roi, produisit le plus mauvais effet dans la chambre du tiers-état. On l’y regarda, non comme l’accomplissement d’un devoir de religion, mais comme l’acte d’une profonde politique, comme une adroite astuce. Le clergé, y dit-on, veut mettre le peuple de son côté; il veut détourner les communes de leur résolution à se constituer. Si l’on adhère, continuoit-on, à l’arrêté des ecclésiastiques, il s’engagera, sur cette arrêté, une délibération par ordre. Les communes perdront donc tout le fruit de leur résistance, car les deux premiers ordres ne manqueront pas d’opposer cette délibération au tiers-état; dont la conduite se trouvera ainsi opposée à ses principes. Si d’un autre côté, il refuse d’écouter cette proposition, il s’expose à l’animadversion du peuple.
Ce fut M. Populus qui, dans sa chambre, donna cette venéneuse interprétation à la louable démarche du clergé. M. Populus, que la nature n’avoit doué d’aucun moyen de sortir de l’obscurité où sa naissance l’avoit placé, a acquis cependant quelque célébrité dans la législature dont j’écris l’histoire. Il doit cette célébrité à son intimité avec une femme perdue de moeurs, mademoiselle Théroigne, devenue chère aux factieux par ses intrigues, et sa docilité à seconder toutes leurs vues; un écrivain moderne qui a eu de grands succès par sa gaieté, a fait le portrait de cette héroïne de la démocratie, dans les vers suivans où il fait parler M. Populus.
Elle a du grand Cujas le séduisant langage;
On voit briller en elle, au printems de son âge,
Fleur de jurisprudence, éclat municipal,
Savoir de député, zèle national,
Esprit législateur, grâces diplomatique,
Haine d’aristocrate, et desseins politiques;
Elle est forte sur-tout en constitution:
Près d’elle Montesquieu n’eût été qu’un oison.
C’est de nos comités et l’âme et la lumière;
Son esprit nous séduit, sa raison nous éclaire:
Je n’ai pu résister à ce charme puissant,
Et mon amour entroit chaque jour plus avant,
Quand mille coeurs, jaloux du bonheur qu’il m’apprête,
Viennnent me disputer cette illustre conquête;
Et l’Asnon jeune encor, fier de ses attributs,
Se montre le rival de l’heureux Populus.
Quant aux talens d’homme public, M. Populus nen apporta aucun aux états-généraux. Comment en effet auroit-il appris, au barreau de Bourg en Bresse d’où il ne sortit jamais, à connoître les hommes, son siècle, son pays, l’Europe? Il n’a voit pas même en arrivant a Versailles, les connoissances de sa profession. Toutes les fois qu’il a eu occasion de parler, ils s’est montre très-ignorant dans les loix et dans l’histoire. De tous les partis qui se formèrent bientôt parmi les députés, M. Populus choisit celui dont les opinions étoient
plus exagérées et les plus déraisonnables. Il a été du nombre de ceux qui pensoient qu’il falloir démembrer la monarchie en plusieurs républiques indépendantes; qu’il falloit ôter à la monarchie son roi, et enfin rendre la législature actuelle perpétuelle &ses membres irrévocables. Rien n’eut été en effet pus commode pour ceux-ci, que de prendre pour tout le cours de leur vie, des titres, des emplois et de vivre, en un mot, aux dépens de tous
Tel est l’homme qui, le premier, aux états-géneraux, a sonné le tocsin sur le clergé ; on le trouva hardi, et par-là même on lui applaudit. Tous ceux qui, comme lui, vouloient fixer sur eux l’attention de la multitude, ambitionnèrent les mêmes applaudissemens Ce fut parmi eux une émulation à qui se montreroit plus hardi encore que M. Populus. On s’échauffa au point qu’on entendit une voix qui crioit: il faut dénoncer au roi la conduite du clergé, comme séditieuse; un autre député, qui, sans doute, n’étoit pas encore bien instruit, s’écria, dans l’excès de son fanatisme, qu’il falloit vendre un quart des biens ecclésiastiques.
Du sein de cette effervescence, et au lieu du pain que le clergé vouloir qu’on donnât aux malheureux, il sortit cet arrêté, car on ne faisoit pas encore alors de décrets.
«Pénétrés des mêmes devoirs que vous touchés jusqu’aux larmes, des malheurs publics, nous vous prions, nous vous conjurons de vous réunir à nous instant, dans la salle commune, pour délibérer et aviser au moyen de remédier à ces malheurs le plus efficacement possible».
Le peuple se félicita de cet arrêté, comme s’il avoir du ramener l’abondance. Ce fut M. Camus avocatu clergé, qu’on chargea de le porter à cet ordre. Il reçut pour réponse, qu’on s’occuperoit sérieusement de cette proposition, mais qu’il y avoir dans instant, trop peu de membres dans la chambre, pour la mettre à la délibération.
Le roi, de son côté, fit cette réponse au clergé:
«Les objets que me présente la délibération du attention Je crois n’avoir négligé aucun des moyens et mon propres à rendre moins funeste l’effet inévitable de ropres à rendre moins funeste l’effet inévitable de l’insuffisance des récoltes. Mais je verrai avec plaisir se former une commission des états-généraux qui puisse en prenant connoissance des moyens dont j’ai fait usage, s’associer à mes inquiétudes, et m’aider de ses
Cette commission n’a jamais eu lieu; le roi et le clergé et désiroient sincèrement; elle étoit necessaire, et c’étoit là, sans contredit, la première chose dont il eût fallu s’occuper, parce qu’on avoit tout raindre de l’état de détresse où se trouvoit le petit peuple; mais il étoit trop intéressant pour la plûpart des membres du tiers-état, trop favorable à leurs vues; de laisser la nombreuse classe des malheureux s’agiter au milieu des inquiétudes et des angoisses, pour songer a faire cesser cette déplorable situation.
Les choses restèrent dans cet état d’inertie, jusqu’à la clôture du procès-verbal des conférences, qui eût lieu le8. Les états-généraux étoient donc assemblés depuis cinq semaines, et faute d’avoir mieux conçu le réglement de leur convocation, ils n’étoient pas même constitués.
Le clergé, jusqu’à l’époque de cette clôture, ne se départit point du rôle de médiateur, le tiers-état de son systême d’inertie, mais la noblesse procéda avec activité; elle vérifia les pouvoirs de ses membres, se déclara constituée, et commença ses travaux pour la législation de l’Empire, et la réforme des abus.