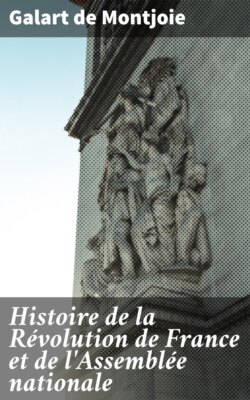Читать книгу Histoire de la Révolution de France et de l'Assemblée nationale - Galart de Montjoie - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE PREMIER.
ОглавлениеTable des matières
INTRODUCTION.
LE règne de Louis XIV, de ce prince dont les novateurs ont tant calomnié la magnanimité, la pompe les succès, les revers, fut l’époque du plus liant degré de grandeur où la monarchie françoise soit parvenue; mais c’est là aussi peut-être qu’il faut rechercher les premières causes de l’état déplorable où nous la voyons réduite.
Depuis la mort de ce monarque, la majesté de l’empire françois, s’est insensiblement éclipsée. Les funestes et hardies conceptions de l’étranger Law aggrandirent le mal qu’il vouloit guérir; et tandis que cet empyrique, étonné lui-même des mouvemens convulsifs que sa main imprimoit à tout l’état, bouleversoit et la fortune publique, et les fortunes particulières, l’air pestiféré qui s’exhaloit d’une cour dont le chef et le principal ministre se vautroient dans la fange de tous les vices, se répandoit sur la surface du royaume, et corrompoit toutes les mœurs. C’est là, c’est dans ce palais que Richelieu régnoit despotiquement sur son roi, et humilioit la noblesse; c’est là que le régent et Dubois oublioient dans la débauche, les dangers de la France; c’est de-là enfin que s’est écoule de nos jours, le poison qui a corrompu toute la masse du corps politique: nous y avons entendu prêcher le régicide; nous eu avons vu sortir les furies qui ont armé de torches et de poignards, des légions de brigands et d’assassins. Palais détestable, monument odieux qui pèse sur le sol de notre patrie; l’air qu’on y respire est contagieux, et l’homme de bien doit craindre d’en approcher.
Des disputes théologiques signalèrent les premières années du long règne de Louis XV. On s’aigrit, on s’échauffa; quelques actes d’autorité que le gouvernement crut nécessaires pour réprimer des querelles dont les progrès eussent pu troubler la société, et affliger la religion, ont servi, dans ces derniers jours, de prétextes, pour appeler despotisme ce qui n’étoit qu’un pouvoir tutélaire.
Louis XV étoit bon et confiant, et, quoi qu’on en ait pu dire, il eût des ministres habiles; mais l’instabilité dans les principes, des guerres longues et dispendieuses des opérations de finance malheureuses, alarmèrent les créanciers de l’état, et préparèrent tous les maux qui sont venus fondre sur nous.
Un autre fléau dût sa naissance au règne de Louis XV: aux écrits sur la religion se mêlèrent les écrits sur la philosophie. S’il suffisoit pour contenir les peuples, d’avoir de l’or et des soldats, les trônes seraient inébranlables, et ceux que la providence y a placés? pourroient impunément dédaigner les blasphêmes de l’impiété et de la licence; mais que peuvent l’or et les soldats contre l’opinion? ce sont les écrivains qui la forment, et c’est sur eux que le gouvernement doit étendre sa vigilance.
A l’époque dont nous parlons, le ridicule fut verse à pleines mains sur les vérités les plus saintes; les prêtres furent insultés, calomniés dans mille pamphlets. Un corps célèbre qui, dans ce nouveau genre de combat, montroit un courage sans cesse renaissant, fut détruit, et ce fut une digue de moins contre le torrent qui se débordoit. Alors se forma cette ligue cette conspiration contre l’auteur même de notre religion: les conjurés se réunissoient chez un étranger, que ses démêlés avec J.-J. Rousseau ont rendu célèbre; ils entretenoient une correspondance dans toute l’Europe, et au-delà même des mers; un souverain entra dans cette conjuration. Ses chefs sont morts mais ses disciples vivent; ils ont hérité de tout le fanatisme de leurs maîtres, et les principaux changemens dont nous sommes témoins, ne sont que l’exécution du sacrilége complot conçu par ces derniers.
A cette époque donc, les apôtres de la philosophie des Epicure, des Celse, des Porphire, firent circuler avec audace leur doctrine incendiaire; tout fut mis en problême; on prêcha le deisme, l’athéisme, le matérialisme. La religion, disoit l’un d’eux, est le digne sujet d’un poëme épique… Il n’y a rien d’absolument juste, injuste, comme il n’y a ni vices, ni vertus… C’est faire honneur à l’homme, que de le ranger dans la classe des animaux L’univers ne sera jamais heureux que quand il sera athée.… Il est égal à notre repos qu’il y ait un Dieu, ou qu’il n’y en ait pas…
Le trône ne fut pas plus respecté que l’autel; on essaya d’ôter tout frein aux sujets, comme aux rois; on apprit à ceux-ci que le peuple est un animal qui ne se laisse point conduire; on exhorta ceux-là à secouer même le joug de la loi naturelle; car, disoit encore le malheureux dont, en rougissant, nous venons de rappeller quelques blasphèmes: Si les animaux n’ont pas des remords, ou même s’ils sont privés du sentiment que donne la connoissance du bien et du mal, l’homme est dans le même cas; adieu donc la loi naturelle.
Ces principes avoient germe dans presque toutes les classes de la société, lorsque Louis XVI hérita de la couronne: les premiers actes de son autorité furent des bienfaits; et si le bien ne s’est pas opéré sous le gouvernement de ce prince, il faut d’autant plus s’en étonner, qu’il eut des ministres éclairés et vertueux, et que tous ont trouvé dans sa probité, dans son économie, et dans l’amour qu’il n’a cessé de porter à son peuple, toutes les sortes de facilités pour parvenir à une amélioration générale.
L’amour des innovations, l’esprit de système, une guerre d’outre-mer, une certaine inquiétude qui travailloit presque tous les esprits, qui rendoit indiffèrent au bien dont on jouissoit, et faisoit soupirer après un mieux qu’on croyoit entrevoir, la vétusté enfin de l’empire; car les corps politiques ont, comme les corps physiques, un tems de vigueur, de décadence et de mort: tels sont sans doute les premiers obstacles qui se sont opposés aux vues du plus généreux des souverains.
Un ministre, homme de bien, succéda dans l’administration des finances, à un ecclésiastique dont la conduite dans le ministère fut décriée avec un acharnement qui exagéra, aux yeux du peuple, la pénurie où l’on supposoit qu’étoit dès-lors le trésor royal. M. Turgot manifesta et avoit réellement des intentions droites: élevé à l’école de l’ami des hommes, il en avoit adopté la théorie économique; ses idées et ses opérations sur la liberté de l’exportation des grains, sur celles de toutes les sortes de commerce, produisirent une certaine agitation; il fit peu de bien et beaucoup de mécontens.
Le ministère de M. Turgot fut l’époque de la première insurrection qui ait souillé le règne de Louis XVI; et cet événement eut cela de remarquable que, quoiqu’il fût annonce plusieurs jours d’avance, que quoiqu’alors la police fut armée, pour la sûreté publique, de la plus, grande force, l’insurrection ne s’opéra pas moins. On fit dire au roi qu’il connoissoit les auteurs de l’émeute, et cependant on ne les nomma pas; ce fut une faute: on donna à croire que, dès ce moment, le trône avoit des ennemis secrets, assez redoutables pour qu’on n’osât pas les punir; et le trône s’avilit aux yeux de la multitude, lorsqu’elle peut penser que le prince qui y est assis, connoît le sentiment de la crainte. On se borna an supplice de deux malheureux pris au hasard dans la foule des mutins; ce fut encore une faute: le supplice, en inspirant de la pitié pour les victimes, n’inspira aucune horreur pour l’insurrection.
Je ne dois pas omettre une particularité indifférente en elle-même, mais qui ne l’est plus, quand elle se réunit aux autres causes qui ont produit une grande explosion; je veux parler de ce désastre qui changea en jour de deuil, le jour où le roi actuel, alors dauphin, unit sa destinée à celle de la fille de Marie-Thérèse. La place Louis XV, où le peuple s’étoit, sur le soir, porté en foule, pour y jouir du spectacle d’un feu d’artifice, fut, en un instant, couverte de cadavres; les rues adjacentes en furent engorgées: le lendemain matin, la mort se présenta aux yeux des parisiens, qui accoururent, sous les traits les plus hideux; chacun cherchoit une épouse, un père, un fils; la consternation étoit générale. Deux jours après, la foudre frappa et renversa l’échaufaudage qui avoit servi pour le feu d’artifice. Ces deux événemens n’ont sans doute rien que de naturel, niais ils ont afflige; ils ont grave dans l’esprit du peuple des idées tristes et sombres; ils ont jetté dans son ame des ressentimens sinistres sur des liens tissus sous de tels auspices, et les factieux ont su trouver dans ce préjugé populaire, de nouveaux prétextes pour éveiller et nourrir la haine de la multitude.
La manière dont les finances furent administrées après la retraite de M. Turgot, ne présenta rien qui pût alarmer les peuples; cependant, dès-lors se répandit et s’accrédita le bruit, que les contributions publiques ne pouvoient plus suffire aux dépenses de l’état, encore moins à l’acquittement de ses dettes; et c’étoit une opinion assez généralement répandue, que les ministres n’avoient plus d’autre étude qu’à reculer le moment d’une catastrophe qu’on disoit inévitable.
Ce fut aussi vers ce tems-là qu’on commença à faire circuler dans le public des pamphlets, des libelles, des couplets satyriques contre l’auguste compagne de notre roi, qui décéloient, ou de grands sujets de mécontentement, ou de bien sinistres intentions. Aux écrits se mêlèrent les calomnies qu’on débitoit de vive voix; les honnêtes gens n’ont jamais cru ni aux uns, ni aux autres. La vie publique de la reine a toujours été conforme à la dignité de sa naissance, et à la majesté du trône de son époux. Quant à sa vie privée, si elle offre des taches, il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver; et dans cet amas impur de feuilles anonymes, où la fille de Marie-Thérèse a été outragée avec une impudence dont il n’y avoit jamais eu d’exemple, on ne trouve aucun fait avéré, on ne lit que des contes qui n’ont pas même le mérite de la vraisemblance. Mais ce qui est hors de doute, c’est que la reine dans sa vie privée, s’est toujours montrée excellente épouse, mère tendre et vigilante, amie constante et généreuse. Le bonheur du peuple francois, la gloire de son époux, l’instruction de ses enfans, n’ont cessé d’être les premiers objets de sa sollicitude. Retirée à Saint-Cloud, à l’époque où ses augustes enfans furent inoculés, elle portoit l’attention jusqu’à rester renfermée dans ses appartemens, les jours où le peuple venoit visiter le parc, ne voulant, ni le priver de cette promenade, ni s’exposer à communiquer à aucun de ceux qui l’approcheroient, l’air contagieux qu’elle respiroit dans l’intérieur du château.
Son attachement pour son époux n’est pas moins certain; et de tous les faits qui l’attestent, je me borne à un seul, qui est moins connu. Dans les premiers jours où le tiers-état se constitua en assemblée nationale plusieurs membres de cet ordre ayant été admis à lui faire leur cour, et lui offrant l’hommage de leur zèle, de leur fidélité, de leurs services: Tout ce que je vous demande, leur répondit la reine, qui les avoit écouté avec beaucoup d’indifférence, c’est que le roi soit respecté.
Quant à l’éducation de ses enfans, personne n’ignore avec quel zèle, avec quelle patience elle y veille elle-même: tout le monde sait qu’elle est leur première comme leur principale institutrice; qu’elle exige qu’ils viennent chaque jour, et à des heures réglées, lui rendre compte de leurs leçons; que, malade même, elle les fait approcher de son lit, et ne s’exempte pas de cette pénible tâche.
Les calomnies, cependant, dont la reine, dès le commencement du règne actuel, a été l’objet, ont disposé le peuple aux soupçons, à la méfiance, à la haine; et tel est presque toujours le succès des impostures sans cesse répétées, parce que, comme dit un historien, on approfondit rarement les calomnies secrètes, par paresse, par distraction, par la peine qu’il y a d’avouer qu’on s’est laissé tromper, et qu’on s’est livré à une crédulité précipitée. C’est ainsi, ajoute le même auteur, que la vertu la plus pure et la fidélité la plus irréprochable, sont souvent accablées.
Je reviens au récit des événemens politiques, que je n’ai interrompu que pour indiquer une des causes qui ont préparé aux sacrilèges dont le trône a été souillé. M. Necker enfin parut: ses ressources furent les emprunts, et son moyen la confiance qu’il inspiroit: il suffit à tout, même aux dépenses exorbitantes de la guerre d’Amérique; mais il fut aisé de s’appercevoir qu’il échoueroit contre deux écueils; que trop avide de renommée, il l’étoit trop aussi de la faveur de la multitude. Et malheur, dit Pausanias, à l’imprudent qui met son seul espoir dans l’amitié du peuple; jamais il ne fera une heureuse fin. Le premier, il tira une partie du voile qui avoit toujours caché les opérations de ses prédécesseurs; mais cette révélation, en produisant une foule de dissertations critiques, ne dissipa aucun des soupçons que, depuis long-tems, on avoit conçu sur l’état des finances. Le premier aussi, il voulut établir les administrations provinciales; c’étoit une nouveauté dangereuse qui tendoit à changer la constitution françoise; et une constitution qui change, est une constitution qui s’altère. Le fruit de cette nouveauté fut d’alarmer les parlemens, qu’elle menaçoit, et de répandre trop généralement le goût des sciences admitistratives.
Des prétentions, peut-être légitimes, de la part de M. Necker, une antique et sage maxime du conseil, l’obligèrent de quitter une place que ces hommes, dont le froid égoïsme et dont l’avare cupidité spéculé sans cesse sur la fortune publique, n’eussent jamais voulu lui voir abandonner. Sa retraite fit pousser parmi eux des cris de désespoir, répandit une sorte d’inquiétude dans le reste de la société, et rendit le fardeau qu’il abandonnoit, presque insupportable à ceux qui s’en chargèrent après lui.
A MM. de Fleury et d’Ormesson succéda M. de Calonne. Doué d’un génie lumineux, d’une éloquence douce, d’un travail facile, d’un courage peu ordinaire, il osa tout; il embellit la capitale, ordonna les travaux de Cherbourg, entreprit sur presque tous les points de la France, des travaux utiles, fit sur les monnoies une opération sage, heureuse, nécessaire, et excessivement censurée; ce qui prouve toute l’injustice de la prévention, et il y en eut toujours beaucoup contre ce ministre. Affable, sensible, magnifique, il eut des amis ardens; mais ses ennemis l’emportèrent; et voulant, pouvant tout sauver, il perdit tout.
Nous étions sur les bords d’un abîme; nous allions y être engloutis: les notables furent appellés; ils virent le précipice; ils en sondèrent mal la profondeur; mais ce qu’ils en firent connoître à la nation, répandit un effroi général. Le monarque fut investi: un cri presque général s’éleva contre l’administration de M. de Calonne; on voulut le rendre responsable du déficit qu’il dévoiloit; on l’accusa d’avoir prodigué l’or aux courtisans, et de s’être conquis, avec le trésor de l’état, l’amitié de M. le comte d’Artois et la protection de la reine. La publication du livre rouge doit avoir détruit cette double imposture aux yeux de tout homme impartial. Quant à ceux qui, malgré cette preuve, persistent à croire le mensonge, qu’ils nous disent donc sur quelle autorité ils fondent leur croyance; qu’ils nous indiquent des traces de cette criminelle coalition entre trois personnes intéressées à la prospérité de l’état, et dont le but auroit été de dissiper la fortune publique. Cependant cette nouvelle calomnie, répandue et accréditée avec opiniâtreté, a contribué plus qu’une autre, non-seulement à la chute du ministre, mais encore à envenimer les cœurs contre le prince et contre la reine. M. le comte d’Artois a avoué publiquement qu’il étoit l’ami de M. de Calonne; et comme il n’a fait cet aveu qu’après la disgrace du ministre, tout ce qu’on peut raisonnablement en conclure, c’est qu’il honore les deux amis. Quant à la reine, il est démontré, que non-seulement elle n’eut aucune part à l’élévation de M. de Calonne, mais encore qu’elle n’eut jamais une idée avantageuse de ses talens en administration. J’invoque, a cet égard, le témoignage de toutes les personnes instruites; et, si l’on veut persuader à la postérité que le feu empereur recevoit, chaque mois, de la reine de France, des sommes puisées dans les fonds publics, il faut appuyer cette assertion sur d’autres autorités que sur des contes populaires.
Par une fatalité attachée à la destinée de cette princesse, on a toujours voulu la rendre responsable des maux du royaume; et pour l’immoler à la haine publique, on a eu recours à toutes les sortes de reproches; ceux qui les ont cru, n’ont jamais fait attention que les calomniateurs se contredisoient; car en même tems qu’ils supposoient à la reine une familiarité excessive, incompatible avec la dignité de sa naissance, et l’éminence de son rang, ils lui attribuoient une hauteur repoussante, un orgueil qui tenoit de la dureté, et qui humilioit les grands attachés à sa personne. En même tems encore qu’ils publioient qu’elle puisoit journellement, et avec la plus grande facilite, dans le trésor public, des sommes énormes qu’elle employoit à des fantaisies dispendieuses, ou à satisfaire aux desirs de l’empereur son frère, on vouloit qu’elle eut recours à un vil stratagême pour se procurer un collier bien au-dessous sans doute de la fortune de la première reine de l’Europe.
La publicité donnée à la scandaleuse aventure de ce collier, est une erreur du gouvernement; elle a fait germer de grands mécontentemens; elle a altéré des cœurs dont la vengeance pouvoit embarrasser dans des tems de troubles; et c’étoit un spectacle qu’il ne falloit point donner au peuple, que celui de traîner du pied des autels dans le fond d’une prison, et de soumettre aux humiliations d’une procédure judiciaire, un homme qui réunissoit de grandes dignités, et qui tenoit à une famille illustre, puissante et nombreuse.
Mais l’extrême justice du roi, son horreur invincible pour les procédés lâches et bas, ne lui permirent pas de faire toutes ces considérations, et il punit le crime là où il crut le trouver. Ce méprisable procès n’est plus aujourd’hui un problême; toute la honte en est retombée sur cette vile créature, qui ne sortit un instant de la fange que pour s’y replonger; mais ce reptile conserve tout son venin, et que de ressorts n’a-t-on pas fait jouer, et ne fait-on pas jouer encore dans ce moment, pour qu’il vienne de nouveau souiller le trône!
Avant le départ de M. de Calonne, il s’étoit élevé entre lui et M. Necker, un différend qui n’est point encore terminé. La recette des deniers publics étoit-elle supérieure ou inférieure à la dépense, lors de la retraite de M. Necker? Telle est la question dont il importoit aux François d’avoir la solution. C’étoit à l’assemblée nationale à la leur donner; c’étoit à elle à leur présenter le tableau fidèle, le tableau annuel et journalier du montant et de l’emploi des recettes. Cedevoit être là la première de ses opérations sur les finances. Ce travail eût calmé toutes les méfiances; il eût obtenu ce que les prières, les sollicitations, les efforts n’obtiendront plus, parce que s’il eût été offert dans les premiers jours de la révolution, chacun se fut empressé de contribuer à remédier à un mal qui alors n’étoit pas incurable; mais aujourd’hui nous avons la cruelle certitude qu’il l’est, que les ressources du plus riche empire de l’univers, ne suffisent plus à sa restauration, et la terrible révélation viendra trop tard.
M. de Calonne, en fuyant la cour et la France, eut la douleur de se voir donner pour successeur un de ses plus ardens ennemis; mais il a eu aussi depuis la consolation que ce successeur n’a pas fait mieux que lui, et personne n’a plus de droit à se dire auteur de la révolution de France, que M. de Brienne. Mal famé dans son ordre, prôné par les philosophes et quelques courtisans, il ne se contenta pas du poste qu’il trouvoit vacant, il voulut jouir d’une plus grande portion d’autorité5et plus il s’éleva, moins il parut grand. Il ne sut que suivre les erremens de M. de Calonne, et il marcha dans cette carrière avec toute la hauteur de Richelieu, mais aussi avec toute l’incapacité d’un homme qui n’a pas les premières notions de l’art de gouverner. Il compromit l’autorité de son roi, irrita le premier prince du sang, brisa les parlemens, froissa tous les corps, menaça toutes les fortunes, c’est-à-dire, que pour se procurer de l’or, il tarit toutes les sources qui pouvoient lui en donner.
Sous l’administration de M. de Brienne, le sang commença à couler en France; il voulut exécuter avec le fer des soldats, des plans qui n’étoient pas exécutables, parce que l’opinion, ou si l’on veut, la prévention générale les repoussoit, et lorsque précipité des marches du trône, par le vœu presque unanime, il se retira en Italie, couvert de dignités, et du mépris de ses concitoyens; on vit ce qu’on n’avoit vu qu’une fois depuis la naissance du christianisme; on eût le scandale d’un nouveau suicide dans le collège des apôtres.
Avant d’abandonner les rênes du gouvernement, le prélat épouvanté des convulsions qui agitoient la France, crut qu’elles menaçoient le royaume d’une entière dissolution; et, pour la première fois, écoutant, au lieu de la diriger, l’opinion publique, suivant le torrent, au lieu de le détourner, il ouvrit la boîte qui versa sur notre infortunée patrie, tous les maux qui la désolent; il lui donna les états-généraux et M. Necker.
Ce ministre, pendant sa retraite, s’étoit occupé de quelques écrits, dont l’un est nécessaire à tous ceux qui sont appelés à administrer les finances, et l’autre sur les opinions religieuses, ne mérita pas, quoique couronné par une académie, les succès qu’il eût. Ces écrits, en ramenant sur lui l’attention publique, avoient empêché ce peuple frivole, qui oublie l’homme de la veille pour l’idole du jour, de le perdre de vue. Sa rentrée dans le ministère fut un véritable triomphe, mais il la dut moins à la faveur des grands, à l’amitié et à l’estime de son prince, qu’à l’engouement irréfléchi d’une nation inconsidérée et extrême dans sa gratitude comme dans sa vengeance. Il fit de son mieux, il rappela les parlement, versa une partie de sa fortune dans le trésor royal, soutint par son crédit personnel, le crédit national, et détermina le roi à avancer la convocation des états-généraux; par-là il se rendit agréable, mais par-là aussi il donna à croire et à la France et à l’Europe, que jusqu’à cette époque, il n’étoit possible ni d’améliorer la perception des impôts, ni d’acquitter les engagemens de l’état ce qui étoit évidemment une erreur; car un ministre habile eut su, en louvoyant, conduire le navire public au port.
L’époque des états-généraux fut donc avancée et annoncée pour le27avril1789. A l’instant tous les François qui s’étoient réunis pour demander une assemblée de représentans, se divisèrent en différens partis. Les parlemens d’abord invoquèrent les lois du royaume; ils demandèrent la forme de1614; ils ne pouvoient, ni ne devoient en connoître d’autre; ces grands corps avoient jusqu’à ce moment fait effort contre l’autorité arbitraire, et ils lui avoient toujours été odieux: dans cette occasion, ils firent effort contre la licence, et ils devinrent odieux au peuple. Le clergé et la noblesse voterent comme les parlemens, et dès lors commença entre les deux premiers ordres et le peuple, entre l’élite et l’autre partie de la nation, entre les propriétaires et ceux qui ne tiennent à aucun pays, cette guerre qui dure encore aujourd’hui, et embrasera encore long-tems le royaume.
La fermentation etoit grande; les écrits se multiplioient et dans la capitale et dans les provinces; dans tous, les principes étoient outrés; on y exagéroit les droits du tiers-état; les auteurs parloient à la nation, non comme à une société qui avoit déjà quatorze siècles d’existence, mais comme à une aggrégation d’hommes tous égaux en prétentions en droits sur le sol qu’ils trouvoient vacant, et où ils arrivoient pour se donner une forme de gouvernement, qui ne supposoit aucune convention antérieure. Tel est le caractère du François; impétueux, il s’élance au-delà des bornes, et M. Necker au lieu de le contenir en-deçà, l’abandonna à toute sa fougue. Il jeta la cour dans l’indécision, et feignit lui-même de l’incapacité à résoudre la grande question qui s’agitoit alors. On demandoit si le tiers-état devoit avoir un nombre de représentans égal à celui des deux premiers ordres. Question évidemment subordonnée à cellle-ci: délibérera-t-on par ordre ou par tête? Dans le premier cas, qu’importoit au tiers-état une représentation inférieure, égale ou même supérieure à celle des deux premiers ordres? Dans le second cas c’étoit demander si l’on vouloit changer les formes antiques et constitutionnelles de la monarchie. Cette question en outre étoit captieuse, et, si j’ose le dire incendiaire, car elle indiquioit clairement à la nombreuse classe qu’il falloit soulager, mais non élever, que de quelque manière qu’elle fut résolue, elle gagneroit tout, si elle conquéroit la délibération par
Les notables furent de nouveau appelés pour résoudre cet étrange problême; et comme ils étoient, composés des deux premiers ordres ils pensèrent que les deux colonnes de l’état ne dévoient pas se renverser d’elles-mêmes, et que les fondateurs de la monarchie ne devoient pas en être les destructeurs. Ils refusèrent donc la double représentation au tiers-état. Le seul bureau présidé par Monsieur, frère aîné du roi, émit un vœu contraire. Hélas! cette condescendance n’a pas conquis à ce prince la faveur de la multitude; mais la postérité applaudira à la sagesse qui l’a rendu nul pour les factieux.
En obtenant la double représentation, le tiers-état obtint par le fait, et comme c’étoit sans doute le but de ceux qui demandoient cette destructive innovation, un nombre de voix supérieur à celui des deux premiers ordres, parce que le clergé se trouvoit lui-même composé de deux classes, dont la seconde étoit formée de membres pris dans le tiers-état.
Telle est la chaîne des événemens qui ont précédé l’époque à jamais mémorable de1789, telle est l’influence qu’ils ont eue sur la révolution. Parmi les causes qui l’ont amenée, il en est une qui agit depuis plus de deux siècles, qui n’a été remarquée par aucun écrivain moderne, et que je vais développer dans le chapitre suivant.