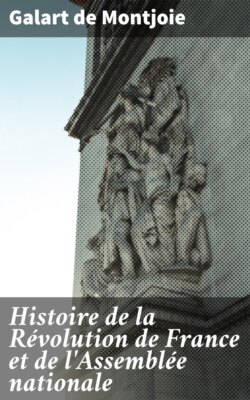Читать книгу Histoire de la Révolution de France et de l'Assemblée nationale - Galart de Montjoie - Страница 23
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE XX.
ОглавлениеTable des matières
Suite du récit des conférences qui eurent lieu chez M. le garde-des-sceaux; conclusion de cette première partie.
Commencement de Juin1789.
3. JE laisse un instant, pour les reprendre dans la seconde partie de cette histoire, les evenemens particuliers qui eurent lieu du31mai au3juin, et je me borne ici au seul récit de la suite des conférences qui se tinrent chez M. le garde-des-sceaux.
Les commissaires des trois ordres terminèrent, dès la seconde séance, toutes les questions de fait et de droit; mais il s’en fallut de beaucoup qu ils fussent, après cette longue discussion, disposés à se rapprocher Ceux de la noblesse déclarèrent que si le tiers-état, prenoit dans le procès-verbal le nom de communes, leur secrétaire ne le signeroit pas, conformément à la défense qu’ils en avoient reçue par eut chambre. Ceux des communes dirent alors que dans le cas où les commissaires des deux premiers ordres refuseroient de signer le procès-verbal, ils demandoient qu’il fut signé par un secrétaire qu’auroient agréé les trois ordres.
Le garde-des-sceaux ne dissimula pas qu’il lui étoit impossible de consacrer une expression dont aucun roi de France ne s’étoit encore servi. Un ministre du roi ne pouvoit pas tenir un autre langage. A cette observation, les commissaires du tiers-état repondirent qu’ils croyoient que ceux de Sa Majesté n’étoient à la conférence que comme conciliateurs. La sagesse de M. le garde-des-sceaux ne lui permit pas de relever cette sorte de reproche, il l’écouta en silence, et reprit avec modération son rôle de conciliateur. Il proposa de faire signer le procès-verbal par un secrétaire de la chancellerie. Cette proposition fut acceptée.
4. Cette conférence non plus que la suivante ne donna point la solution que la cour et les deux premières chambres cherchoient de bonne foi, mais que les communes auroient toujours rejetée, si elle ne leur avoit pas donné l’opinion par tête. Il falloit cependant se déterminer à un parti. Le teins se consumoit en pourparlers inutiles; les esprits s’aigrissoient toujours plus, et la patience du public se lassoit.
Mais quel problême à résoudre! Falloit-il tout abandonner au tiers-état? Falloit-il s’exposer aux suites qu’occasionneroit le refus de lui accorder l’opinion par tête? M. Necker qui s’effrayoit du péril, parce qu’il l’avoit enfin sous les yeux, comptant sur une influence qu’il n’avoit plus, et entraîné par cette présomption qui lui dissimula toujours les principales difficultés de la question à résoudre, se crut le seul homme en France capable de rendre aux trois ordres une paix qu’ils ne pouvoient plus avoir depuis qu’il avoit donné la double représentation au tiers-état. Il avoit promis au conseil, à la famille royale, au roi, de terminer cette guerre. A la fin donc de cette nouvelle et dernière conférence, il lut et fit répandre ensuite dans le public, le projet suivant de pacification:
Les anciens faits prouvent évidemment que le conseil est intervenu dans toutes les questions qui ont occasionné des débats relatifs à la validité des élections, et à la vérification des pouvoirs.»
» Il seroit donc de toute justice que Sa Majesté examinât, sous le rapport de ses propres droits, les difficultés qui s’élèvent dans ce moment, et lorsque chacun des ordres est activement occupé des prérogatives qui peuvent lui appartenir, il paroîtroit naturel que Sa Majesté fixât elle-même son attention sur celles dont la couronne a constamment joui. Mais Sa Majesté, fidèlement attachée aux principes de modération qui peuvent hâter l’accomplissement du bien public, permet à ses ministres de considérer d’abord sous ce point de vue, le plus grand nombre des affaires.
» Les ordres ne s’éloigneroient pas vraisemblablement de confier à des commissaires choisis dans les trois chambres, l’examen préliminaire des difficultés relatives à la validité des pouvoirs et des élections; mais en cas de divisions d’avis, la chambre du tiers demanderoit que la détermination décisive fut remise à l’assemblée des trois ordres réunis. L’ordre de la noblesse s’y refuse absolument, et veut que chaque chambre soit arbitre en dernier ressort.»
» Il est sur que les ordres ont un intérêt à prévenir qu’aucun des trois n’abuse de son pouvoir pour admettre ou rejetter avec partialité les députés qui viennent prendre séance dans les états-généraux; et cet intérêt commun existeroit, soit que les ordres eussent à délibérer réunis, soit qu’ils restassent constamment séparés, puisque dans cette dernière supposition les personnes qui seroient appelées à décider, par leurs opinions, d’un veto ou d’un empêchement quelconque, acquerroient le droit d’influer directement sur le sort général de la nation.
» En même tems, il est naturel et raisonnable que les deux premiers ordres fixent leur attention sur la supériorité de suffrages assurés à l’ordre du Tiers. Car s’il est vrai que tous les députés aux états-généraux, sans distinction, sont intéressés à l’impartialité des vérifications de pouvoirs, il est également certain que dans une circonstance ou les esprits sont divisés, chaque ordre a des motifs personnels pour desirer d’éloigner des autres chambres les députés dont les sentimens ne seroient pas favorables à ses opinions.
» Ces motifs personnels sont égaux, dira-t-on, entre les ordres; ainsi en les admettant à délibérer en commun sur la régularité des élections aucun n’a droit de se plaindre. Ce raisonnement ne seroit pas juste; car si les motifs de partialité sont les mêmes, les moyens d’agir conformément à ces motifs ne sont point égaux, puisque le tiers-état, par la grande supériorité de ses suffrages, auroit un avantage décisit, si le jugement final sur les pouvoirs contestés appartenoit à l’assemblée des trois ordres réunis.
On ne pourroit pas combattre cette opinion en rappelant que les deux premiers ordres ensemble sont en nombre égal au tiers-état; car ces deux premiers ordres réunis par leurs privilèges pécuniaires, ne le sont pas de même dans les considérations relatives à l’ examen des élections. Enfin, ces privilèges ne forment qu’une union passagère dans un moment où leur prochaine suppression paroît assurée.
On dira peut-être encore que la supériorité de suffrages du tiers-état une fois admise il doit lui être permis a en faire usage pour une affaire commune; mais la Supériorité des suffrages appliquée aux décisions sur la validité des pouvoirs et des élections des trois ordres n’est pas un simple usage de cette supériorité, c’est encore un moyen d’en accroître l’avantage; une telle faculté, un tel emploi de la supériorité ce suffrages seroient un supplément de concession, une force nouvelle, qui dérangeroient, dans une mesure quelconque, l’équilibre établi par le souverain, Jorsqu’il a fixé le nombre respectif des députés de chaque ordre.
Le pouvoir de juger en dernier ressort de la régularité des élections, ne pourroit donc être attribué avec équité, ni aux trois ordres réunis, ni à chacun d’eux en particulier. Ce pouvoir ne doit pas appartenir à chaque ordre en particulier, parce qu’ils ont tous intérêt à ce qu’un seul n’abuse pas de son influence; il ne peut pas non plus appartenir aux trois ordres réunis, puisque ce seroit l’attribuer essentiellement aux représentans du tiers-état, vu la supériorité de leurs suffrages, et le roi ne leur a pas accordé cette supériorité, pour leur donner le moyen d’en augmenter la puissance, en obtenant une influence prépondérante sur la formation de l’assemblée.
» C’est donc au roi que semble appartenir, en raison et en équité, le jugement final sur toutes les contestations relatives aux élections; ce principe est une suite, une dépendance du règlement souverain qui a de terminé pour cette fois le nombre respectif des députes aux états-généraux; ainsi les trois ordres qui se soumettent à la fixation établie par Sa Majesté, feroient une exception minutieuse, s’ils répugnoient à la prendre pour juge dans le très-petit nombre de contestations qui pourroient s’élever dans la vérification des pouvoirs. L’intérêt de Sa Majesté, le seul qui la dirige, c’est l’ amour de l’ union, et elle mériteioit encoie d’ etre votre arbitre, quand vous ne voudriez pas du monarque pour juge.»
Ce seroit le roi seul qui, en cette occasion, feroit une cession de ses prérogatives, puisque de simples particuliers appelloient autrefois au souverain de la décision d’un ordre, relative à la vérification des pouvoirs, et que Sa Majesté se réserveroit seulement de juger les questions sur lesquelles les ordres seroient divisés d’opinion.
«Il paroît donc que tous les motifs de justice, de raison, d’équité et de convenance réciproque, doivent déterminer les ordres à adopter ce moyen de conciliation. Voici donc d’après ces idées, la marche qu’on proposeroit.
«Les trois ordres, par un acte de confiance libre et volontaire, s’en rapporteroient les uns aux autres pour la vérification des pouvoirs, sur lesquels aucune difficulté ne s’éleveroit, et ils se communiqueroient leurs actes de vérification, pour en faire un examen rapide».
Ils conviendroient de plus, que les contestations, s’il en survenoit, seroient portées à l’examen d’une commission composée des trois ordres; que ces commissaires se réuniroienf à une opinion; que cette opinion seroit portée aux chambres respectives; que si elle étoit adoptée, tout seroit terminé; que si au contraire les décisions des ordres étoient en opposition sur cet objet; que si encore elles ne paroissoient pas susceptibles de conciliation, l’affaire seroit portée au roi, qui rendroit un jugement final.»
«Qu’on ajoute encore, que si l’on veut, que ces conventions sur la vérification des pouvoirs, n’auroient aucune liaison avec la grande question de la délibération par tête ou par ordre. Que l’on ajoute encore que la marche adoptée pour cette tenue d’états, seroit reprise dans le cours de la session, afin de considérer si un meilleur ordre de choses devroit être adopte pour l’avenir. Qu’on reunisse au fond de cette proposition les précautions qui paroîtroient convenables, mais qu’on adopte enfin ce moyen de conciliation ou tout autre, et que le roi ne reste pas seul, au milieu de sa nation, occupé sans relâche de l’établissement de la paix et de la concorde. Quels véritables citoyens pourvoient se refuser à seconder les intentions du meilleur des rois? Et qui voudroit charger sa conscience de tous les malheurs qui pourroient être la suite de la scission qui se prépare au premier pas que vous faites, Messieurs, dans une carrière où le bien de l’état vous appelle, où la nation est impatiente de vous voir aller en avant et où les plus grands dangers nous environnent? Ah! Messieurs, lors même que vous pourriez arriver à ce bien par la. division des coeurs et des opinions, il seroit trop acheté. Le roi donc vous invite a prendre en considération sa proposition, et il vous presse de tout son amour de l’accepter, et de lui donner ce contentement».
Tels furent les moyens de conciliai ion que proposa M. Necker; j’ai rapporté son discours en entier, pour laisser dans toute leur force et dans toute leur étendue les ressources qu’il croyoit devoir amener un heureux dénouement. Ici, comme dans toute occasion, il n’apperçut pas, ou ne voulut pas appercevoir la véritable difficulté dont il s’agissoit de se débarrasser. A son ordinaire, il parla longuement dans ce discours, et parla de tout, excepte de la seule question qui, réduite à ses termes réels et les plus simples, étoit celle-ci: Délibérera-t-on en toute occasion par ordre ou par tête? Si M. Necker eut voulu réduire le problême à ces expressions, il eût vu que les moyens de conciliation qu’il présentoit, étoient insnffisans, parce qu’en même-tems qu’ils n’offroient point au tiers-état un dédommagement à la conquête de l’opinon par tète, que cet ordre vouloit obtenir a quelque prix que ce fut; ils n’étoient nullement propres a rassurer les deux premiers ordres contre les entreprises de leur ennemi.
Ce fut par ce discours que se terminèrent les conférences qui n’ont plus été reprises. Le jour où M. Necker jetta ce gage de paix au milieu des combattans, fait un époque bien remarquable dans l’histoire que j’écris, car dès cet instant, tout changea en France, les opinions, les préjugés, les moeurs, les lois, les coutumes, tout prit une nouvelle forme; dès cet instant l’autorité royale ne fit plus que s’affoiblir, le clergé et la noblesse firent chaque jour un nouveau pas vers cette abîme qu’avoit creusé le résultat du conseil; dès cet instant, enfin, le tiers-état se saisit des premiers anneaux de cette chaîne incommensurable de pouvoirs, qui nous effraye bien plus qu’elle ne nous étonne.
Ce sera donc aussi par ce discours que je terminerai la premiere partie de l’histoire de la révolution. J’ai tâché d’indiquer les principales causes qui l’ont amenée; j’ai développé quelques uns des moyens qui l’ont déterminée; j’ai montré à découvert quelques-uns des personnages qui ont le plus influé sur les déplorables innovations que j’ai maintenant à décrire. On a vu par quel concours de circonstances, par quel enchaînement de faits en apparence extraordinaires, mais qui dévoient conduire a un but depuis long-temps prévu, s’est engendrée cette formidable puissance qui dès son berceau a menacé toutes les autres puissances. On va lavoir s’élancer de ce berceau, avec la taille et la force d’un géant. Je n’ai plus que des images désastreuses à tracer; ce n’est plus qu’au milieu des débris et des ruines, que je vais promener mes lecteurs.
Si ceux que nous avions députés aux Etats-généraux pour améliorer notre sort, jettent aujourd’hui les yeux sur l’immense carrière qu’ils ont laissé derrière eux, comment pourront-ils ne pas trembler sur le terrible compte qu’ils ont à rendre a leur conscience, à leurs commettans et à la postérité?
Ah! dans ces instans où ils goûterent les premièrs fruits de leur victoire, où ils levérent leurs bras pour renverser toutes nos institutions, que n’a-t-il pu sortir de son tombeau, ce philosophe qu’ils ont déifié! Que n’a-t-il pu s’élancer au milieu d’eux, et leur répéter ces vérités si belles parce qu’elles sont simples!
«Prenez garde que pour vouloir trop bien être, vous n’empiriez votre situation. En songeant a ce que vous voulez acquérir, n’oubliez pas ce que vous pouvez perdre. Corrigez, s’il se peut, les abus de votre constitution, mais ne méprisez pas celle qui vous a fait ce que vous êtes.... Je ne dis pas qu’il faille laisser les choses dans l’état ou elles sont, mais je dis qu’il n’y faut toucher qu’avec une extrême circonspection. En ce moment vous êtes plus frappés des abus que des avantages. Le temps viendra, je le crains, qu’on sentira mieux ces avantages, et malheureusement ce sera quand on es aura perdus.... Ah! je ne saurois trop le redire; pensez-y bien avant de toucher à vos lois, et sur tout à celles qui vous firent ce que vous êtes».
La suite au prochain cahier, qui paroîtra dans le courant de mai prochain.