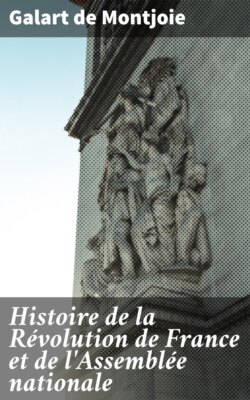Читать книгу Histoire de la Révolution de France et de l'Assemblée nationale - Galart de Montjoie - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE XIX.
ОглавлениеTable des matières
Duel regarde comme un présage heureux pour le tiers-état; opinion de la plupart des membres de cet ordre sur Monsieur, sur les ministres et les grands; murmures séditieux; agitation de la cour; mot de M. Necker; fables sur les princes et les parlemens; adroite motion de M. de Mirabeau; débats dans la chambre du clergé sur cette motion; espérance des communes trompée; comité tenu chez le roi; lettre du roi aux trois ordres; comment elle est reçue par les trois chambres; belle réponse de M. d’Eprémesnil; folle motion de M. de Volney; débats dans les communes sur la conférence demandée par le roi; arrêté qui termine ces débats; qualification que prend dans cet arrêté l’assemblée des députés du tiers-état; réflexions sur cette nouveauté et sur le système de ceux qui vouloient introduire en France le gouvernement anglais; première conférence tenue chez le garde-des-sceaux.
Mai1789,
PARIS étoit toujours divisé en deux partis, dont l’un dévoué à M. Necker, et l’autre à M. de Mirabeau; mais ce dernier continuoit à ne jouir d’aucune faveur, et M. de Mirabeau semblait réunir sur lui tous les soupçons qu’il vouloit jeter sur le ministre. Ce n’étoit pas au moment où l’on alloit recueillir les avantages de la double représentation, qu’on pouvoit se permettre des doutes injurieux sur la popularité de celui qui l’avoit accordée. Le tems approchoit où ce terrible bienfait alloit produire les fruits les plus amers pour le clergé et la noblesse. On triomphoit d’avance des humiliations qui se préparoient pour ces deux ordres, et un événement qui n’avoit aucun rapport aux affaires générales, fut regardé comme un présage de la victoire du tiers-état.
Trois jeunes étourdis, gardes de Monsieur, entrent dans un café de Versailles; ils y trouvent un député du tiers-état du Languedoc. Le costume du député les fait sourire; le maître du café s’en formalise, s’approche d’eux d’un air effaré, et leur dit: «vous ne savez donc pas que Monsieur est député du tiers-état?» L’air alarmé de cet homme donna encore plus de gaîeté aux trois gardes; ils lui dirent à leur tour: «Eh bien, que s’ensuit-il? Est-ne que vous ne savez pas vous que nous nous moquons et du tiers et du quart?» C’étoit un propos d’enfant, qui ne méritoit aucune attention; le député s’en tint offensé, et le releva. «Messieurs, cria-t-il, sachez que quoique du tiers, je vous vaux; que l’un de vous sorte avec moi, et je le lui prouverai». Les trois gardes acceptèrent le défi, et suivirent le député. L’un d’eux se presenta au combat, et fut tue. On convint mutuellement d’abandonner le champ de bataille, et de ne pas expier par plus de sang une étourderie.
Cette affaire éclatta; elle fit honneur au député; cet honneur rejaillit sur tout son ordre; on blâma généralement les gardes; Monsieur ne voulut pas qu’ils restassent dans leur corps, et leur fit témoigner son mécontentement de linjure qu’ils avoient faite au député.
On sut gré dans le tiers-état à Monsieur de cette conduite; on voyoit cependant avec peine qu’il fît une sorte de mystère de son opinion; on auroit voulu qu’il se déclarât franchement pour le troisième ordre; mais alors quel rôle aurait joué M. d’Orléans? Enfin a sagesse de Monsieur ne fut pas si mal interprêtée que la royale véracité de M. le comte d’Artois; mais on finit par se persuader qu’il n’épouseroit aucun parti, et on a eu l’injustice de ne pas se féliciter de cette neutralité.
Il est à remarquer que dans tous les écrits qui vouoient à la haine du tiers-état quiconque paroissoit hésiter appuyer les prétentious de cet ordre, Monsieur fut toujours respecté. M. de Mirabeau lui-même qui a toujours pensé qu’il falloit faire une révolution à la cour comme à la ville, gardoit dans son journal le plus profond silence sur ce prince.
Ce journal reparût enfin sous une nouvelle forme; M. de Mirabeau lui donna le titre de lettre à ses commettons; mais, en changeant le titre, il n’en fut ni plus juste, niplus impartial. Il paroissoit cependant s’adoucir sur le compte de M. Necker; il ne le représentoit plus que comme un homme foible que les communes devoient circonvenir, et qu il falloit malgré lui contraindre à continuer la route qu’il avoit ouverte.
La conduite de ce ministre dans les conjectures ou l’on se trouvoit, étoit vraiment étonnante; il se taisoit toujours sur les contestations élevees entre les trois ordres, et n’étoit occupé que d’emprunts; mais il étoit bien loin de compte, ses partisans voulurent à cet égard sonder le public; on répandit que le roi viendroit incessamment aux états-généraux faire lui-même la demande d’un emprunt provisoire. Cette nouvelle fut fort mal accueillie; les députés des communes disoient à leur tour dans tous les cercles, qu’ils ne vouloient écouter aucune demande d’argent avant d’avoir établi les bases de la constitution; que les sommes qu’ils accorderaient, seraient absorbées pour satisfaire les fantaisies de la cour, et qu’ils étoient venus, non pour les intérêts de la cour, mais pour ceux de23millions de François.
Les plus hardis ou les moins dissimulés tenoient des propos plus sérieux encore; ils se répandoient en reproches amers contre les ministres et les grands; ils se plaignoient avec chaleur de laffluence des troupes qui environnoient Versailles et la capitale; ils disoient que si les assemblées primaires de la capitale avoient été aussi peu nombreuses, c’est que les Parisiens avoient été effrayés, parce qu’ils savoient que tous les fusils des soldats étoient chargés à balles, que les canons de la Bastille étoient braqués, que ceux des Invalides étoient également chargés et prêts à marcher, que la bibliothèque du roi étoit remplie de munitions de guerre et d’hommes armés; ce n’est pas ainsi, ajoutoit-on, qu’on est libre. Ces mêmes hommes annonçoient sans detour qu’ils demanderaient le renvoi de toutes ces troupes; et ils ajoutoient, que les choses en étoient venues à un point qu’il falloit une révolution, et qu’elle se ferait infailliblement.
Ces menaçans discours n’étoient pas de bonne augure pour l’emprunt que méditoit M. Necker. La couduite que tenoient les chambres du clergé et de la nobles; e, servoient de prétexte pour exagérer les plaintes. On supposoit que ces deux ordres; étoient d’intelligence avec la cour, qu’ils étoient convenus de temporiser, pour donner le tems de préparer les mesures qui devoient, suivant ceux qui se permettoient ces plaintes, dissoudre les étas-généraux.
Nous ne sommes pas riches, disoient encore plusieurs députés; toutes ces lenteurs prolongent inutilement notre séjour à. Versailles, et dérangent nos affaires particulières. Veut-on donc conspirer et contre l’assemblée à laquelle nous sommes députés, et contre chacun de ses membres en particulier?
Ces perfides murmures, qui glissoient dans les coeurs le poison de la sédition, étoient bien propres à donner de l’inquiétude à la cour. Le roi et la reine ne s’y montraient pas sensibles, parce qu’ils ne connurent jamais le, soupçon; ils virent même luire un rayon de bonheur. L’abcès dont M. le dauphin étoit incommodé, perça; l’auguste enfant fut soulagé, et on eût un moment l’espoir de le conserver. Tous ceux qui connoissent la tendresse de la reine pour ses enfans, concevront aisément avec quelle avidité elle s’ennyvra d’un espoir qui devoit être de si courte durée.
Mais si le roi et la reine, toujours-confians aux pompeuses et séduisantes promesses de M. Necker, s’abandonnoient aveuglement et avec sécurité à un guide peu clair-voyant; il n’en étoit pas de même du reste de la cour. Elle partageoit l’agitation universelle; on y changeoit miLle fois de projets en un jour, et tous ces projets n’avoient pour but qu’un changement dans le ministère. Il fut fort question de donner le département de la guerre à M. le maréchal de Broglie, celui de la marine à M. le maréchal de Castries, celui de Paris à M. Valdec-de-Lessart, et les sceaux à M. Vidault de la Tour. L’estime que M. le comte d’Artois avoit pour M. de Barentin, ne permet pas de croire que ce prince eût beaucoup de part à Ce projet-qui finit par échouer tout-à fait. Le département des affaires étrangères restoit dans cet te révolution ministérielle à M. de Montmorin; ce seroit une raison de plus pour croire que. les triumvirs influoient très-peu sur cette révolution; car M de Montmorin se rapprochoit beaucoup de M. Necker; on ne l’ignoroit pas dans le public. Les Communes voyoient avec plaisir cette intelligence; le roi lui-même paroissoit témoigner plus de confiance et d’attachement à M. de Montmorin.
Dans tous ces mouvemens qui se faisoient à la cour, ou respectoit l’existence ministérielle de M. Necker, mais on étoit curieux de connoître ses intentions ultérieures; et comme il parloit sans cesse et avec complaisance, d’un travail qu’il se proposoit de soumettre aux états-généraux, des grands lui demandèrent un jour, quel étoit ce travail, «Messienrs, répondit le ministre avec cette mistérieuse emphase qu’il eût toujours, lorsqu’il parloit de ses conceptions, c’est mon secret; je le ferai connoître à la nation». Réponse puérile qui prouve que M. Necker savoit bien mal lire dans l’avenir, puisqu’il n’y voyoit pas qu’un des effets nécessaires de l’organisation qu’il avoit donnée aux états-généraux, seroit de lui ôter toute influence, et sur cette assemblée et sur la nation. Est-on homme d’état, quand on a la vue aussi courte?
Comme cependant on avoit intérêt à prouver que son existencee ministérielle étoit menacée, et que c’étoit là principalement l’objet de toutes les démarches que faisoient les princes, on imagina pour le persuader au public crédule, la plus ridicule des fables: on répandit que ces princes avoient intercepté les brochures que le libraire Blaizot faisoit passer au roi, et qu’ils leur en avoient substitué d’autres, composées par leurs affidés, et qui n’étoient que des satyres de l’administration du directeur des finances. Le monarque, ajoutoit-on, conjecturant par cette nouvelle lecture, que l’opinion étoit changée, ne diminuoit rien de ses sentimens poinson ministre; mais il s’en prenoit de ce changement aux Parisiens eux-mêmes, et ne comprenoit rien à la facilité avec laquelle ils passoient d’un systême à un autre systême.... «Toutes les têtes, faisoit-on dire au roi, sont donc devenues des girouettes».
La vérité cependant s’éclaircit, et les princes furent confondus. C’est avec de pereilles fables qu’on a accéléré la révolution, et qu’on a rendu tant d’ames atroces.
Des princes, on en venoit aux parlemens; on auroit bien voulu que le petit peuple attribuât à ces compagnies la cherté du pain; mais cette imposture n’a j’amais pris faveur. «Tous ces corps, crioit-on dans les antres du palais-royal, préféreroient la guerre civile à la tenue des états–généraux». Hélas? ce n’étoient pas ces corps qui la desiroient et l’appelloient, c’étoient ceux-là même qui leur supposoient, sans y croire, cette horrible intention; l’événement l’a prouvé, et tous les sacrifices que les compagnies souveraines ont fait jusqu’au moment où elles ont cessé d’exister, attestent d’une manière bien honorable, que leur unique vœu étoit pour le matien de la paix.
On faisoit aussi bien des contes sur M. le duc d’Orléans, mais tous ces contes étoient à son avantage. On disoit entr’autres qu’il avoit fait au roi le plus grand éloge des communes; qu’il lui avoit conseillé de les prendre pour son conseil, parce que c’étoit là seulement qu’il trouveroit la vérité et toutes les lumières réunies; qu’au lieu de songer à faire une demande d’argent, qui déplairoit infailliblement à la nation, il falloit avant tout travailler de conçert avec les communes, au redressement des griefs du tiers-état.
Je n’ai pas besoin de dire que M. le duc d’Orléans n’a jamais eu une telle conversation avec le roi; mais cette fable et mille autres de ce genre ne circuloient pas moins, et ne produisoient pas moins l’effet qu’on s’en promettoit; car de cet amas de flagorneries d’une part, et de calomnies de l’autre, il résulta pour une très-grande partie du peuple, une croyance qui a produit les plus grands maux: il finit par se persuader qu’il n’avoit de véritable ami, de véritable protecteur auprès du roi, que MM. d’Orléans et Necker. Parmi toutes les autres personnes de la cour, les unes lui parurent suspectes, les autres lui devinrent infiniment odieuses, et quelles tragiques suites n’a pas eu cette injuste haine?
Egaré par tant de mensonges, le peuple de Paris regardoit le refus de la noblesse, de vérifier les pouvoirs en commun, comme une rébellion, comme une conjuration contre l’état; mais pénétré du sentiment de ses forces, sachant que l’abus en seroit impuni, il ne redoutoit point cette résistance, et l’on chantoit d’avance la mort de la noblesse. Plusieurs jours avant sa réunion avec le tiers-état, on répétoit avec complaisance, dans les cafés et dans les cercles de la bourgeoisie, ces coupless sur l’air de Calpigi.
Vive le tiers-état de France!
Il aura la prépondérance
Sur le prince, sur le prélat.
Ahi! povera nobilta!
Je vois s’agiter sa bannière
J’entends par-tout son cri de guerre:
Vive l’ordre du tiers-état!
Ahi! povera nobilta!
Le plébéïen puits de science,
En lumières, expérience,
Surpasse et prêtre et magistrat.
Ahi! povera nobilta!
Je vois parler dans nos tribunes,
Six cens orateurs des communes,
Comme Fox ou Gracque au sénat.
Ahi! povera nobilta!
Je me borne à ces deux couplets; dans les autres on prédisoit aux maréchaux de France qu’ils seroient simples soldats, et aux ducs et pairs qu’ils brigueroient une mairie. Cette chanson prophétique étoit appellée le vœu de la nation. Ceux qui l’avoient composée étoient, comme on voit, parfaitement instruits de ce qui alloit arriver, et déjà il se disoit assez franchement, que les mesures étoient prises pour qu’il n’y eût plus désormais en France qu’un seul ordre, celui des citoyens.
Les préjugés dont on nourrissoit le peuple de la capitale ce propageoient avec rapidité dans les provinces, au moyen des mensongères relations qu’on leur fesoit parvenir de Versailles et de Paris. Ces menées eurent un tel succès que presque tous les députés des communes recurent, de la part de leurs commettans, l’avis qu’il falloit, quelque résolution que prissent le clergé et la noblesse, et quand même le roi viendroit à changer d’intention, que les membres des communes se regardassent comme les seuls représentans de la nation, qu’ils n’accordassent aucun impôt, si on ne déféroit pas à leur voeu, qu’ils endurassent enfin plutôt les plus grandes extrémités, que de rien relâcher de leurs prétentions.
La nouvelle qui arriva que le haut clergé et la noblesse de Bretagne ne vouloient pas envoyer de députés aux états-généraux, et qu’ils protestoient formellement, tant contre la forme de convocation, que contre la délibération par tête, fut un nouveau motif de calomnier la chambre de la noblesse.
La plupart des membres des communes partageoient l’ivresse du peuple, et étoient fermement résolus à ne rien céder aux deux autres ordres, et à ne point abandonner leur poste, quand même le clergé et la noblesse se retireroient.
27. Telle étoit la disposition des esprits de presque tous les députés du tiers, lorsqu’en entrant dans leur salle, le27, on trouva sur le bureau le dernier arrêté de la noblesse. M. Camus fut d’avis d’envoyer des députés au clergé, pour le prier de continuer le rôle de conciliateur entre les communes et la noblesse. D’autres vouloient qu’on ne s’occupât plus du second ordre; qu’on contraignît le clergé de sortir de son inaction, et qu’on l’invitât à venir se réunir au troisième ordre. M. Populus, trouvant tous ces avis ridicules, présenta un moyen le plus absurde de tous ceux qu’il pouvoit présenter. Il demanda qu’on continuât les conférences, comme si l’on pouvoit continuer des conférences qui étoient bien réellement finies, et que l’arrêté de la noblesse ne permettoit plus de renouer. Enfin M. de Mirabeau proposa à son tour un avis que l’on trouva si sage et si adroit, que la très-grande majorité l’adopta avec empressement. Cet avis fut d’envoyer une députation au clergé, pour l’inviter, au nom du Dieu de paix et de l’intérêt national, a se réunir aux communes dans la salle de l’ assemblée générale, afin de chercher ensemble le moyen d’établir la paix et la concorde.
Je nexamine pas si le Dieu de paix exigeoit que les députés du clergé abandonnassent l’intérêt de leur ordre et de leurs commettans, violassent une loi constitutionnelle de l’état, et que ceux qui avoient le mandement de l’opinion par ordre, manquassent à leur serment; mais très-certainement c’étoit profaner le nom du Dieu de paix et de justice que de l’employer pour faire tomber ses ministres dans un abîme sans fond, et la suite de cette histoire fera voir malheureusement que cette hypocrite invitation n’étoit qu’un piége tendu aux ecclésiastiques.
Lavis donc de M. de Mirabeau adopté, on envoya des députés au clergé, qui lui firent part de leur perfide mission. Le président répondit que la chambre alloit s’occuper avec zèle d’une matière d’un si grand intérêt, et qui demandoit de mûres délibérations.
La proposition fut en effet sur-le-champ débattue; plusieurs cures furent d’avis qu’il falloit se réunir; mais cet avis trouva de fortes oppositions; les débats prolongeoient la séance, et rien ne se décidoit. On arrêta enfin d’envoyer le lendemain aux communes, des députés qui seroient chargés de leur déclarer que les membres du clergé avoient pris en grande considération la proposition de MM. du tiers-état, et étoient très-empressés de leur faire une réponse; qu’ils s’en étoient occupés continuement; mais que la séance ayant été prolongée au-delà de trois heures, ils s’étoient séparés, et avoient remis la séance au lendmain pour continuer à s’en occuper.
Il n’y avoit rien dans cet arrêté, qui ne fut conforme à l’exacte vérité, mais ce n’étoit pas-là ce qu’attendoient ceux des membres des communes, qui avoient des intelligences parmi les curés; ils avoient cru que plusieurs de ceux-ci, à la vue des députés du tiers-état, lever fient le siège, et se rendroient dans la salle des communes. Comme d’un autre côté, on étoit certain que M. le duc d’Orléans, à la tête de plusieurs nobles, suivrait, quand il en seroit tems, l’exemple de ces curés, on croyoit l’affaire terminée, parce que la cour elle même aurait eu de la peine à ne pas regarder comme les états-généraux, une assemblée composée des membres des trois ordres.
Ceux donc qui avoient brassé toute cette intrigue, furent fort consternés en ne voyant pas arriver un seul curé. Les communes levèrent la séance, sans prendre aucune délibération; elles ne pouvoient en effet en prendre aucune sur cette affaire, avant de connoître la résolution ultérieure du clergé; mais les députés du tiers qu’affectoit davantage le non-succès de l’invitation, et qui se voyoient ainsi déjoués, s’en vengèrent en faisant répandre par leurs émissaires, mille grossières invectives contre les prélats, dont les sages représentations avoient modéré l’ardeur de quelques curés. Voici ce qu’écrivit à ce sujet un député du tiers, à un de ses amis de Paris au sortir de la séance,
«Nous avions aujourd’hui la victoire, sans la souplesse du haut clergé. Presque tous les curés devoient se réunir a nous. La partie forte eût nécessairement entraîné la partie foible. Voilà donc le premier et le troisième ordre réunis. Les nobles qui sont à nous venaient grossir le cortège, Que pouvoit faire le reste de la noblesse? Ne falloit-il pas qu’elle marchât aussi? L’opinion par tête étoit conquise, et tout étoit fini; mais les prélats et l’abbé Maury ont retardé notre triomphe; ils ont levé la séance sans rien décider, et aucun curé n’est encore des nôtres.»
On se promettoit d’être plus heureux le lendemain, et on attendoit avec la plus grande impatience quel seroit le résultat de la nouvelle délibération du clergé; mais dans l’intervalle d’une séance à l’autre, la cour comprit enfin que c’étoit pour le roi une obligation dinterposer, sinon son autorité, du moins sa médiation dans une querelle dont on ne pouvoit plus se dissimuler l’importance. M. Necker lui-même sentit dès ce jour des inquiétudes, et plus il avoit montré d’assurance quand il ne voyoit pas le danger, plus il en fut effrayé quand il l’eut sous les yeux. C’est ainsi que chez les hommes imprévoyans, le découragement succède à la confiance. Dès ce moment donc M. Necker devint rêveur, soucieux, irrésolu; sa santé fut visiblement altérée.
La tournure que prenoit la contestation ne permettoit plus de balancer; il falloit sur-le-champ prendre un parti qui prévint dans la chambre du clergé, un déchirement, une scission dont personne ne pouvoit calculer les effets. On tint donc à la hâte, chez le roi, où se trouvoit la reine, un comité composé de MM. le comte d’Artois, Necker, de Montmorin, de Puységur, de la Luzerne, de Villedeuil, de Nivernois, de Saint-Priest. On y rédigea une lettre pour chacun des trois ordres, et on convint qu’elle seroit envoyée le lendemain matin par le roi à l’ouverture des séances.
On voit que ni mesdames de France, ni les princes de Condé et de Conti, ni aucun des députés des deux premiers ordres, ne se trouvèrent à ce comité. J’en fais la remarque, parce qu’on prétendit dans le public, que la lettre qui en étoit émanée, étoit l’ouvrage des tantes du roi, de M. l’archevêque de Paris et de M. d’Eprémesnil.
28. Les trois ordres s’étant assemblés à l’ordinaire, M. le marquis de Brezé se rendit d’abord dans la chambre du clergé, qui avoit repris sa délibération de la veille, et lui remit la lettre du roi. De là, M. de Brezé se rendit à la chambre de la noblesse, et remit la lettre à une personne attachée à cette chambre; elle refusa de la recevoir des mains de cette personne, parce qu’étant constituée en ordre, la lettre du roi devoit lui être adressée, suivant le cérémonial d’usage. Le grand maître des cérémonies, qui n’avoit pas prévu cette difficulté, alla prendre les ordres du roi, et revint remettre la lettre au président même de la chambre.
Enfin, M. de Brezé se présenta à la chambre des communes, et fit remettre au doyen ta lettre du roi, ouverte; elle eut été close, et présentée dans l’assemblée même, si les communes eussent été constituées. En voici la teneur:
«J’ai été informé que les difficultés qui s’étoient élevées, relativement à la vérification des pouvoirs des membres de l’assemblée des états-généraux, subsistoient encore, malgré les soins des commissaires choisis par les trois ordres, pour chercher les moyens de conciliation sur cet objet,
» Je n’ai pu voir sans peine, et même sans inquiétude, l’assemblée nationale, que j’ai convoquée pour s’occuper avec moi de la régénération de mon royaume, livrée à une inaction, qui, si elle se prolongeoit, feroit. évanouir les espérances que j’ai conçues pour le bonheur de mon peuple, et pour la prospérité de l’état.
» Dans ces circonstance, je desire que les commissaires conciliateurs, déjà choisis par les trois ordres, reprennent leurs conférences demain à six heures du soir; et pour cette occasion, en présence de mon garde-des-sceaux, et des commissaires que je réunirai à lui, afin d’être informé particulièrement des ouvertures de conciliation qui seront faites, et de pouvoir contribuer directement à une harmonie si desirable et si instante.
» Je charge celui qui, dans cet instant, remplit les fonctions de président du tiers-état, de faire connoître mes intentions à sa chambre.»
Signé, LOUIS.
A Versailles, 28mai. 1789.
Les mêmes intentions du roi étoient exprimées dans dans la lettre adressée au clergé, et dans celle remise à la noblesse. Ces deux ordres obéirent au desir du roi, et acceptèrent les conférences. Pouvoit-il en être autrement? Un grand procès s’élevoit entre le troisième et les deux premiers ordres. A qui appartenoit-il de le juger? Bien loin donc que la lettre du roi put donner de la jalousie à aucun des trois ordres, ils dévoient, au contraire, être touchés de la modération du souverain qui, ayant incontestablement le droit de terminer le différent, préféroit de tenter encore une fois les moyens de conciliation.
La noblesse, après avoir souscrit aux desirs du roi, mit à la délibération l’opinion par ordre ou par tète; et à la majorité de deux cents deux voix, elle prit l’arrêté suivant:
«La chambre de la noblesse, considérant que dans le moment actuel il est de son devoir de se ra lier à la constitution et de donner l’exemple de la termete, comme elle a donné la preuve de son désintéressement, déclare que la délibération par ordre, et la faculté d’empêcher que les ordres ne soient confondus, sont constitutifs de la monarchie, et qu’elle persévère constamment dans ces principes conservatifs du trône et de la liberté.»
On murmura beaucoup contre cet arrêté; on l’attribua à M. d’Eprémesnil, et la haine contre ce magistrat ne fit que s’en accroître. L’eut-il en effet composé lui seul, il ne pouvoit être blâmé de son respect pour les lois constitutionnelles de l’état, et de sa religion au serment qu’il avoit fait à ses commettans; mais cet arrêté n’étoit pas son ouvrage, il étoit celui de la chambre entière; et ce qui prouve que la minorité étoit encore bien foible dans cette chambre, c’est que seize nobles seulement protestèrent contre cette délibération. Il est triste, sans doute, de voir des gentilshommes se livrer ainsi à la discrétion de leurs ennemis; mais ce royaume qu’ils avoient conquis, dont ils étoient les protecteurs; mais ce trône, dont ils étoient les appuis; mais leur ordre, dont ils avoient juré de défendre les légitimes droits, devoient-ils les abandonner à la fureur des partis?
On s’étonnoit que M. d’Eprémesnil qui, dans sa compagnie, avoit si bien combattu pour le peuple, ne voulût pas, dans la chambre de la noblesse, arborer l’étendart du tiers-état. Il expliqua lui-même cette énigme. Un prince le rencontrant un jour à l’œil-de-bœuf, lui dit: convenez que les voyages forment bien un homme.–Ils ne m’ont pas formé moi, répondit M. d’Eprémesnil; les mêmes principes qui me faisoient défendre, il y a un an, la liberté contre le despotisme, me font aujourd’hui défendre l’autorité contre la licence.
Lorsque les communes eurent entendu la lecture ce la lettre du roi, un membre prévoyant que la délibération seroit animée, et craignant avec raison qu’elle ne fût troublée par cette foule d’étrangers toujours confondus avec les députés, demanda que ces étrangers se retirassent. Il suffit, dit M. Regnault, avocat d’Angouleme, de les reléguer dans les travées. Ces deux propositions firent proférer à M. de Volney les plus grandes folies.
«Des étrangers, s’écria-t-il, en est-il parmi nous? l’honneur que vous avez reçu d’eux lorsqu’ils vous ont nommés députés, vous fait-il oublier qu’ils sont vos frères et vos concitoyens? N’ont-ils pas le plus grand intérêt à avoir les yeux fixés sur vous? Oubliez-vous que vous n’êtes que leurs représentans, leurs fondes de pouvoirs; qu’ils sont vos maîtres? et prétendez-vous vous soustraire à leurs regards, lorsque vous leur devez un compte de toutes vos démarches, de toutes vos pensées, ? Leur présence intimide-t-elle votre vertu? Non, je ne puis estimer quiconque cherche a se dérober dans les ténèbres; le grand jour est fait pour éclairer la vérité, et je me fais gloire de penser comme ce philosophe qui disoit qu’il voudroit que sa maison fût de verre. Eh! dans quel moment avons-nous plus besoin de leur présence? Nous sommes dans les conjonctures les plus difficiles, et sur le point peut-être de manquer à nos pouvoirs. Non, que nos concitoyens nous environnent de toute part, qu’ils nous pressent, que leur présence nous inspire et nous anime; elle n’ajoutera rien au courage de l’homme qui aime sa patrie et qui la veut servir; mais elle fera rougir le perfide ou le lâche que le séjour de la cour, ou la pusillanimité auroit déjà pu corrompre.
Rien ne prouve mieux que toutes ces folies, à quel excès de délire peut entraîner la présence d’une multitude qu’on a intérêt de flatter. Elle applaudit avec transport la fougueuse motion de M. de Volney; mais ses co-députés lui surent fort mauvais gré de ce qu’il vouloit mettre en principe, que les représentés étoient les maîtres des représentans; c’étoit une hérésie contre la future souveraineté de l’assemblée. M, le doyen cependant pria le public de ne plus troubler le silence des délibérations, par des signes d’approbation ou d’improbation. Il fut aussi arrêté qu’on éléveroit des barrières au tour de la salle, que tous les étrangers seroient poussés au-delà de ces barrières, et que les députés ne partageroient plus enfin leurs sièges avec leurs commettans, leurs maîtres.
Ces graves bagatelles conduisirent la séance jusqu’à trois heures après-midi, et on ne put pas dire un seul mot de la lettre du roi. On se rassembla sur les cinq heures, on se perdit en discussions sur la manière d’aller aux voix; on composa des listes, de tous ceux qui demandoient la parole; on ne savoit plus ensuite si on devoit prendre ces listes par le commencement, le milieu ou la fin. On se détermina pour la fin, et sur les onze heures du soir on eût pour résultat de tous ces débats, que cinquante-sept voix rejettoient les conférences, et que toutes les autres les acceptoient avec des modifications. Rien donc ne fut décidé. C’est l’inconvénient des assemblées tumultueuses et trop nombreuses, de perdre un tems infini en débats inutiles, et de ne pouvoir jamais régler la marche des. délibérations sur les besoins du moment. On auroit eu tort de se faire de cet inconvénient un prétexte pour reprocher aux communes leur lenteur; mais il étoit plus injuste encore d’écrire à Paris et dans les provinces, que les retards venoient des chambres du clergé et de la noblesse, puisqu’elles ne pouvoient mettre plus de promptitude dans leur réponse à la lettre du roi.
29. Il étoit à peine jour le lendemain, qu’on se précipita dans la salle des communes. L’importante délibération reprise, un bouillant jeune homme appelé M. Bureau, M. Camus plus bouillant encore, les dénués de la Bretagne, ceux de l’Artois, crièrent qu’il ne falloit point de conférence. Je ne veux dissimuler aucune des raisons sur lesquelles ils fondèrent cette hoètile opinion. Ils dirent donc que les conférences étaient. inutiles, parce que la noblesse ne seroit pas plus convaincue aux secondes qu’aux 1remières; qu’elle étoit liée par un arrête qui annonçoit son opiniâtreté dans ses principes; que le clergé ne prenoit le rôle de conciliateur que pour acquérir des partisans dans l’un et l’autre ordre; que la religion du roi avoit été surprise; qu’il falloit l’éclairer; que les prélats faisoient monter les curés dans leurs voitures; qu’ils les appelloient a leurs tables, leur offroient des bénéfices, les séduisoient de toute manière; et qu’ils étoient ainsi parvenus à gagner la pluralité.
Ce n’étoient là que des injures: on y ajoutoit des considérations qui n’avoient aucun rapport avec la question; on prétendoit que le roi finiroit par pacifier les ordres avec un arrêt de son conseil, et on représentoit que quand même cet arrêt seroit favorable au tiers, que quand même le clergé et la noblesse s’y soumettroient, il n’en seroit pas moins funeste, parce qu’il mettroit les états dans la dépendance du roi, parce qu’il dégraderait la majesté de l’assemblée nationale, et violer oit sa liberté.
Des terreurs paniques et des invectives, tels furent les moyens qu’on employa pour porter les communes à rejeter les conférences; et cette manière de combattre les vérités les plus utiles, a été depuis employée bien souvent. Refuser des conférences demandées par le roi, c’étoit mettre en principes qu’il n’avoit pas droit de les demander. Mais, quelque idée qu’on se fit dés-lors de la prérogative royale, on ne pouvoit disconvenir que le roi ne fut au moins le chef de la nation; s’il l’étoit de la nation, il l’étoit à plus forte raison des représentans de la nation. Sous ce point de vue, pouvoit-on même mettre en doute qu’il n’eût pas le droit de leur demander la conférence? Le tiers-état lui-même avoit été le premier à en solliciter une. Quelle indécence n’étoit-ce pas de la refuser, lorsque le roi la demandoit? Enfin n’étoit-il pas d’une saine politique, de l’intérêt du tiers-état, d’épuiser toutes les voies de douceur et de conciliation, avant d’en venir à un éclat qui devoit. tout ébranler? Le tiers-état en montrant cette modération, ne fesoit-il pas une nouvelle conquête sur l’opinion qui lui étoit déjà si favorable? Pouvoit-il craindre l’influence du roi sur les conférences, quand il s’abs. tenoit d’y assister?
On n’avança pas plus dans cette séance que dans la précédente; elle ne finit qu’a trois heures et demie, et rien ne fut encore décidé: on revint sur les six heures, et les débats recommencèrent avec chaleur. Chaque fois qu’on vouloit aller aux voix, les. orateurs se présentoient en foule, et tous vouloient parler à la fois. MM. de Mirabeau, Rabaud et Chapelier entr’autres se disputèrent long-tems la parole. Les deux premiers parvinrent a se faire entendre. La motion de l’un et de l’autre ne différoit qu’en un seul point. Ils votoient pour qu’on acceptât les conférences; mais M. de Mirabeau vouloit qu’en les acceptant les communes déclarassent qu’elles n’attendoient pour, se constituer comme la véritable assemblée nationale, que le moment où la religion du roi seroit instruite par les conférences qu’il avoit lui-même desirées. M. Rabaud demandoit qu’elles déclarassent qu’elles ne consentoient à reprendre les conférences, que parce qu’elles ne voyoient dans les commissaires du roi que de simples témoins, et dans les expressions de sa lettre, que la volonté de Sa Majesté de ne faire intervenir aucun ordre.
Enfin on mit aux voix cette question: reprendra-ton les conférences purement et simplement, telles quelles sont proposées dans la lettre du roi? Cinq amendemens furent proposés sur cette question.
Io. Les reprendre à la condition qu’a la fin de chacune le procès-verbal sera rédigé et signé par tous les commissaires.
2o. Les reprendre après une députation au roi.
3o. Les reprendre en ajoutant aux pouvoirs des commissaires celui de discuter la délibération par tête.
4o. Les reprendre en présence du roi.
5o. Les reprendre en présence du roi et des trois ordres dans la salle commune des états-généraux.
Il y eut quatre cent cinquante voix pour reprendre les conférences, quatre cent adoptèrent le premier amendement, et trois cent cinquante le second. Les trois autres amendemens furent rejettes.
L’importance de la délibération avoit tellement fixé l’attention des spectateurs que la séance fut plus paisible que les précédentes. Comme elle ne finit qu’à onze heures du soir, la réunion des commissaires ne pût pas avoir lieu ce jour là, ainsi que l’avoit desiré le roi.
La chambre du clergé ayant accepté les conférences, n’avoit plus rien à faire; elle suspendit ses délibérations jusqu’à ce que ces conférences eussent été reprises. La noblesse arrêta de communiquer au cierge sa décision de ne délibérer jamais que par ordre.
30. Dès que le tiers-état eut termine sa séance, son doyen écrivit au garde-des-sceaux pour le prier de demander au roi de fixer l’heure à laquelle sa majesté voudrait recevoir la députation, et le nombre de personnes dont elle desiroit que cette députation fût composée. Le garde-des-sceaux répondit quee roi étant au moment de partir ne pouvoit pas recevoir la députation de la chambre des communes, et que lorsqu’il seroit de retour il fixeroit le jour et l’heure où il voudroit la recevoir. Le ministre ajoutoit que le tiers-état n’ayant point terminé sa délibération le jour même où les conférences devoient avoir lieu, elles étoient remises au lendemain.
Le doyen ayant lu cette lettre; «les conférences, dirent quelques membres, seront donc reprises avant la députation.–Point du tout, dirent d’autres membres, aux termes du second amendement, la députation doit précéder les conférences.–Eh, non, s’écrièrent plusieurs voix, l’amendement porte avec, et non après». Tous les députés fouillèrent au même instant dans leurs poches pour chercher la copie qu’ils avoient gardée de l’arrêté de la veille. Dans presque toutes ces copies on trouva le mot avec en ligne, mais effacé et au-dessus après entre deux lignes, mais en entier. C’étoit une preuve que le mot avec se trouvoit dans l’amendement même et qu’on lui avoit ensuite substitué après.
On consuma dans cette dispute de mots deux grandes heures, et on y attacha une importance aussi puérile que la dispute même. Que l’amendement portât avec ou après, en restoit-il moins certain qu’on avoit arrêté de reprendre les conférences et ne devoient-elles pas être tout aussi bonnes avant, avec ou après la députation?
Quand on eut dit sur ces deux misérables mots tout ce qu’il étoit possible de dire, un membre proposa ne reprendre les conférences le soir même à six heures, mais d’ordonner aux commissaires de ne les terminer qu’après que sa majesté auroit reçu la députation de ses communes. La principale raison pour laquelle le tiers-état tenoit si fort à cette députation, cest qu’alors on aimoit à se nourrir de soupçons, et que plusieurs personnes avoient un grand intérêt à insinuer au peuple que le roi ne vouloit point recevoir de députatiou de la part des communes. Il en étoit de cette insinuation comme de tant d’autres: elle étoit sans vraisemblance comme sans vérité.
Les esprits cependant las de la dispute qu’avoient occasionnée les mots avec et après se reposèrent sur l’avis. que venoit d’ouvrir ce député, et l’adoptèrent. On rédigea alors en bonne forme l’arrêté de la veille et on l’ envoya au clergé. Cet arrêté fut ainsi concu.
«Les Communes de France ont arrêté que pour se rendre aux intentions paternelles du roi, les commissaires reprendront leurs conférences avec les commissaires du clergé et de la noblesse, en présence de M. le garde-des-sceaux et des commissaires nommés par le roi à l’heure qu’il plaira à sa majesté d’indiquer, et que le procès-verbal sera rédigé à chaque séance, et signé de tous ceux qui y auront assisté».
Cet arrêté est remarquable par le titre que donne le tiers-état de Communes de France. Depuis quelques jours le troisième ordre avoit abjuré le nom de tiers, et M. de Mirabeau plaisantoit beaucoup, dans sa lettre à ses commettans, le journaliste de l’ans de se servir encore de ce mot contre lequel il s’étoit fait une véritable conspiration. Ce n’étoit pas que M. de Mirabeau ni ceux qui pensoient comme lui fussent jaloux de cette nouvelle qualification de communes. Ils n’avoient d’autre but que d’abolir, que de faire oublier le mot tiers, pour lui en substituer un qui désignât moins clairement que le corps de la nation étoit composé de trois ordres.
Mais ce mot de communes de France n’étoit pas moins une usurpation, une nouveauté tout aussi inconstitutionnelle que celui d’assemblée nationale, Pour légitimer cette usurpation, du moins pour qu’elle n’effrayât pas les deux premiers ordres, il auroit fallu leur déclarer qu’on n’entendoit par communes de France, que cette portion des villes, bourgs, communautés, composée seulement de ceux des citoyens qu’on appelloit encore au commencement de1789roturiers. Dans ce sens-là seulement le mot communes de France étoit synonimes au mot tiers. Ce n’étoit pas là ce qu’entendoient ceux qui alloient constituer l’assemblée des députés du tiers-état en assemblée nationale. Ils entendoient par représentans des communes de France, les députés en général, et sans distinction d’ordres, des villes bourgs et communautés du royaume.
Ceux qui étoient venus aux états-généraux avec l’impolitique et impraticable idée de métamorphoser tout-à-coup les François en Angloïs, saisirent avec avidité la nouvelle dénomination de communes de France, parce qu’elle servoit leurs desseins. C’étoit une chimère de vouloir transporter sur notre sol les plantes indigènes d’une isle, qui meurent dès qu’elles sont sur le continent. C’étoit s’écarter de la route que se sont tracée tous les grands législateurs de l’antiquité, qui en créant un peuple, se sont bien donné de garde de l’assimiler à un autre peuple. Nous ne verrions pas aujourd’hui, après une révolution de tant de siècles, le peuple Juif survivre à tant de nations dont il ne nous reste plus que le nom, si Moïse lui eut dorme les loix civiles et religieuses du paganisme. C’est enfin une vérité bien lumineusement démontrée par l’histoire de tous les siécles, que les nations les plus robustes, et qui ont une plus longue existence, sont celles qui se tiennent fermement, attachées a murs coutumes. La Chine n’a jamais été subjuguée, et elle a toujours subjugué ses vainqueurs.
Pour dire donc, avec la franchise que je dois à mes lecteurs, ce que je pense, je ne regarde pas moins comme des conspirateurs contre leur pays, ceux qui ont voulu substituer le gouvernement anglois au gouvernement françois, que ceux qui nous ont écrasé sous les débris de l’ancien régime. Que desirions-nous de nos mandataires lorsque nous les avons envoyé aux états-généraux? Nous ne leur demandions pas qu’ils nous ôtassent nos loix, nos moeurs, nos coutumes. Nous les avions chargé de réformer les abus, et encore ceux-là seulement qu’il étoit possible de réformer, car nous savions que la perfection n’est que dans le ciel.
Je répéterai d’ailleurs ce que j’ai dit dans quelques endroits du journal de l’’Ami du Roi, que quelque peine que l’on se donne, quelqu’effort que l’on fasse, il n’en reste pas moins vrai que toute société politique commence et finit par le gouvernement d’un seul. Il est aussi insensé de lutter contre cette règle immuable du destin, que d’opposer une digue au cours impétueux d’un torrent. Tout ce que peut donc faite la sagesse humaine, c’est de respecter ce qui semble être un ordre de la providence, c’est d’asseoir l’edifice public sur la base vers laquelle il est entraîné, tôt ou tard, par la pente des siécles.
Je dirai encore que quelqu’idée que l’on se fasse de la bonté d’un gouvernement, le spectacle de l’état actuel du globe prouve que de toutes les associations politiques qui en couvrent la surface, les plus anciennes comme les plus florissantes, sont les monarchies.
L’on ne peut pas douter qu’au moment où l’assemblée du tiers-état se qualifioit de communes de France, il ne se fut déjà formé un parti qui avoit en vue de enter sur notre régime le régime anglois; car cest bien ici que nous pouvons dire: habemus fatentem reum. Voici la confession de M. Malouet lui-même. En voulant justifier la répugnance des nobles pour la confusion des trois ordres, il s’exprime ainsi: «Ils ont à s’appuyer sur des autorités imposantes, en s’attachant au système d’un gouvernement mixte, tel que celui de l’Angleterre; c’est celui que l’expérience nous montre comme le plus favorable a la prospérité et à la liberté d’un grand peuple; c’est celui vers lequel je me sens personnellement entraîné.»
M. Malouet avoit donc aussi, en arrivant à Versailles, son système de révolution, et ses autorités imposantes étoient l’expérience et son goût personnel. Je doute que la première de ces autorités, valût l’exemple de toutes les puissantes monarchies du continent de l’Europe et de l’Asie. Quant a la seconde, ce n’étoit pas son goût personnel que M. Malouet devoit apporter aux etats-generaux, cetoû le vœu de ses commettans, et le respect le plus religieux pour les formes constitutionnelles du pays dont il étoit un des députés.
On voit que mon estime pour ce grand homme ne m’aveugle pas. Il vit, ainsi que son parti, non-seulement avec indifférence, mais avec une joie secrète, l’assemblée du tiers-état prendre le nom de communes de France. Et cependant, suivant ses propres principes, il auroit dû combattre cette prétention; car l’assemblée des représentans du tiers-état, organisée comme elle l’étoit, ne ressembloit, en aucune manière, à la chambre des communes de la Grande-Bretagne, qui ne prend pas exclusivement ses membres dans le troisième ordre. Comment d’ailleurs des hommes, dont les pouvoirs n’étoient pas encore vérifiés, qui n’étoient pas réellement envoyés par les communes de France, qui étoient députés aux états-généraux par leur ordre, pouvoient-ils se croire et se dire ce qu’ils n’étoient pas? Le seul titre qui convint à leur assemblée, c’étoit celui d’assemblée des représentans du tiers-état de France.
Je n’aurois pas insisté sur cette erreur, je ne me serois pas arrêté à fixer un fantôme qui n’a eu que quelques jours d’existence, s’il n’entroit pas dans le plan que je me suis tracé, de donner l’histoire des opinions, comme celle des hommes et des événemens.
Les communes ayant enfin arrêté qu’on reprendroit les conférences, elles revinrent à cette députation qui étoit pour elles un objet tout aussi intéressant. Il falloit un discours et un orateur. «L’orateur est tout trouvé, dit M. Tronchet, c’est à M. le doyen qu’appartient l’honneur de haranguer le roi. Voyez les parlemens, c’est toujours le premier président qui porte la parole.» M. Tronchet ne connoissoit pas encore bien l’esprit de l’assemblée où il parloit. On hua sa comparaison. Les députés du tiers-état devoient leur convocation aux compagnies souveraines, et déjà la plupart d’entr’eux préparoient les batteries qui alloient renverser ces colosses. Saturne, dit la fable, dévoroit ses enfans. Cette histoire fera voir que les nouveaux Dieux ont dévore ceux qui les avoient engendrés.
«Comment voulez-vous, dit à son tour très-judicieusement M. Jouy des Roches, lieutenant-général du présidial du Mans, que M. le doyen soit nommé orateur? Ne voyez-vous pas qu’il est trop petit, et qu’un petit homme qui en harangue un grand, offre un spectacle ridicule. 31On rit de l’observation, et on nen tint aucun compte. On lut ensuite le discours que des commissaires venoient de rédiger, et chacun s’engagea, sur son honneur, à n’en donner aucune copie.
Les ecclésiastiques et les nobles attendoient dans l’inaction la reprise des conférences. Elles commen. cèrent cèrent le soir chez le garde-des-sceaux; tous les ministres s’y trouvèrent, ainsi que MM. de la Michodière, d’Ormesson, de Vidaud, de la Galaisière, conseillers d’état, et M. de Lessart, maître des requêtes.
Le garde-des-sceaux ouvrit la séance, exposa l’état de la question, témoigna le desir qu’avoit le roi de voir les différens ordres se porter à des ouvertures de conciliation, et demanda ensuite si on vouloit procéder sur-le-champ à l’examen de ces ouvertures, ou si on vouloit encore discuter les principes.
Un des membres de la noblesse prit alors la parole, et prouva, par une suite de faits historiques que sa chambre n’avoit pu se conduire autrement qu’elle avoit fait.
Les commissaires du tiers-état, lorsque le gentilhomme eut fini sa discussion, dirent que leur mandat se bornoit à conférer sur la question de la vérification des pouvoirs, et qu’ils avoient ordre d’écrire journellement les conférences et de les signer. Sur ce dernier article, les commissaires du clergé et de la noblesse représentèrent qu’ils n’avoient aucun pouvoir de leurs chambres. On débattit cette difficulté, et on convint qu’il seroit dressé un rapport signé des communes, et d’un secrétaire agréé par les commissaires des trois ordres.
Ce premier objet ainsi terminé, on entra en matière: chacun des faits historiques que venoit d’alléguer le membre de la noblesse, fut discuté contradictoirement; ce fut une véritable plaidoyerie, dans laquelle les commissaires du tiers-état affectèrent de ne parler que des seuls faits qui étoient relattis a la question sur la vérification des pouvoirs. Cette affectation à éluder tout ce qui avoit trait à la délibération par tête on par ordre, donna de l’inquiétude aux commissaires du clergé et de la noblesse, qui ne pouvoient ignorer que la véritable intention du tiers-état, étoit d’en venir à la délibérer par tête en toute occasion; mais les commissaires du clergé et de la noblesse eurent beau représenter que les deux questions de la vérification des pouvoirs et de l’opinion en commun ou séparément étoient intimement liées; ils eurent beau dire que le refus du tiers-état à traiter cette seconde question, sembloit être un aveu de son impuissance à répondre aux preuves qui la décidoient en faveur des deux premiers ordres; ils ne purent vaincre le silence des commissaires du troisième. Il fallut donc s’en tenir rigoureusement à la discussion des faits relatifs à la vérification des pouvoirs. Cette discussion dura trois heures et demie, et l’on ne put passer en revue qu’une partie des faits qu’on avoit à examiner. On lut donc obligé de renvoyer la suite de la conférence à un autre instant; on l’ajourna au3juin.
Dans l’intervalle de cette première séance à la suivante, ceux à qui il tardoit de voir enfin arriver te moment de la réunion, ou plutôt de la confusion des trois ordres, redoublèrent leurs efforts pour rendre la cause du clergé et de la noblesse défavorable; on répandit d’infidelles relations des conférences; on placarda sur la porte de la chambre où le premier ordre tenoit ses séances, cette maxime, qui par le sens qu’on lui donnoit, étoit une injure pour le clergé: la vérité est voisine du mensonge. On renouvella les alarmes sur le prétendu complot contre le tiers-état; elles se trouvent exprimées énergiquement dans ce peu de mots que renfermoit un billet qui partit de Versailles pour Paris et pour les provinces: «Le roi craint la cabale; M. Necker la craint aussi; la cabale craint le tiers-état; le tiers-état ne craint rien, sa contenance est toujours ferme.»
Cette cabale, dont on continuoit à effrayer le peuple, c’étoit cette association qu’on supposoit s’être formée entre les princes, presque tous les ministres, les principaux courtisans, les prélats, et la plupart des membres de la chambre de la noblesse. On va voir, par la suite du récit des conférences, si cette association étoit en effet bien redoutable, et si les craintes qu’elle inspiroit étoient fondées.