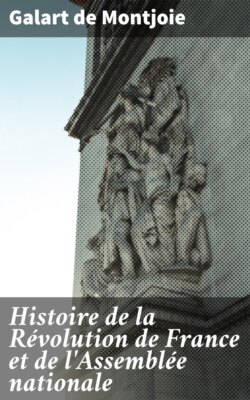Читать книгу Histoire de la Révolution de France et de l'Assemblée nationale - Galart de Montjoie - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE XIV.
ОглавлениеTable des matières
Emeute dans le fauxbourg Saint-Antoine; allarme des habitons de Paris; incendie des meubles de MM. Henriot et Réveillon; combat sanglant contre les séditieux; anecdotes sur cet événement; différentes conjectures auxquelles il donne lieu; origine, prétexte et véritable cause de l’émeute; histoire de M. l’abbé Roi; fables qui se débitent contre le gouvernement; Lettre de M. Necker; bruits sur M. le duc d’Orléans; affliction du roi en apprennant l’émeute; insurrection à Orléans; haine contre les princes; séances des électeurs, avances du clergé; portrait de M. l’abbé de Montesquiou; mot sur M. de Gouy d’Arcy; embarras des électeurs.
Avril1789.
27et28. L’ÉVÉNEMENT que j’ai à raconter est un des plus extraordinaires de la révolution; il a beaucoup de rapport avec celui du14juillet suivant. Le premier comme le second a été précédé d’abord de tentatives pour effrayer le peuple sur une prochaine disette de grains, ensuite de bruits insidieusement répandus que des princes et des grands conspiroient contre les états-généraux; que les députés devoient être renvoyés; que M. Necker alloit être forcé de quitter le ministère, enfin qu’une armée s’approchoit de Paris. Aux deux époques, d’une part la haine pour quelques personnes de la cour, et de l’autre l’enthousiasme pour MM. d’Orléans et Necker, redoublent. Je remarque encore que dans les deux circonstances l’explosion est produite par des légions de brigands.
Si l’on a lu avec attention ce que j’ai dit des désordres de la Provence, on retrouvera ici dans la marche des séditieux, une conformité frappante. Ceux qui se promettoient de mettre à exécution le plan de la révolution que nous voyons s’opérer, n’avoient qu’une vue, qu’un but, c’étoit de contraindre toute la bourgeoisie du royaume à prendre les armes. Il étoit clair que si on parvenoit à y décider celle de Paris, son exemple entraîneroit celle de toutes les autres cités.
Pour produire un aussi prodigieux effet, il falloit couvrir la France de brigands, il falloit en exagérer le nombre et les excès, il falloit en montrer aux portes de la capitale, en inonder ses rues. Pour se procurer ces armées de scélérats, il falloit répandre de l’argent, tenter la fidélité des soldats, recruter jusques dans les prisons, soulever tout le petit peuple, en ne lui distribuant l’aliment de première nécessite, qu’avec des précautions allarmantes.
Il etoit naturel que la cour, effrayée d’un côté par l’apparition de tant de brigands, et de l’autre par les insurrections populaires, se détermineroit à déployer la force publique. On s’y attendoit; mais alors on devoit semer avec plus d’affectation le bruit d’une conspiration, pour arracher à la nation le bienfait des états-généraux, et réduire à un dur esclavage le tiers-état qui annonçoit des prétentions si cruelles et si humiliantes pour les deux premiers ordres.
Les soldats appelés au secours des villes, ou feroient leur devoir, ou molliroient. Dans le premier cas, la conspiration étoit certaine, et les bourgeois au lieu de cette liberté dont ils se flattoient, n’avoierit plus que des désastres a attendre. Dans le second cas, les soldats eux-mêmes grossissoient le nombre des insurgens. Ils auroient feint de contenir les brigands; ils auroient témoigné la crainte d’être écrasés par leur nombre, et auroient favorise aux bourgeois la prise des armes.
Ceux-ci donc se seroient vus ou pressés tout-à-la-fois par des brigands féroces et par des soldats impitoyables, ou encouragés par ces derniers eux-mêmes à se réunir à eux pour repousser l’ennemi commun. Dans l’une ou l’autre position, que pouvoient faire les bourgeois? Il falloit bien qu’ils défendissent leur vie, leurs propriétés, leur famille, et qu’ils devinssent à leur tour soldats.
Il est certain que si on avoit pu déterminer les habitans de Paris à s’armer à l’époque même de l’ouverture des états-généraux, le vaisseau public, comme a dit ensuite M. de Mirabeau, se seroit élancé avec plus de rapidité. Que risquoit-on du moins d’essayer de les forcer à cette démarche? On publie donc que les princes, le clergé, la noblesse, le parlement ont conjuré contre la liberté, et veulent l’étouffer clans son berceau; on crie au peuple "des fauxbourgs qu’il va être dévoré par la famine; on tourmente les bourgeois par l’appréhension d’une armée qui rendra la cour maîtresse des députés, et tout-à-coup sur les trois heures après midi, des bandes de vagabonds se répandent dans les rues.
Tous ces gens-là mal vêtus n’étoient armés que de bâtons. Ils traînoient avec eux un manequin dont l’écriteau indiquoit que M. Réveillon, chef d’une manufacture de papier peint dans le fauxbourg Saint-Antoine, étoit l’homme à qui ils en vouloient. Le nombre, les menaces, les hurlemens de ces misérables, répandirent l’effroi. Les boutiques se fermoient avec rapidité à leur passage. Arrivés à la place royale, ils lurent un arrêt du tiers-état, qui condamnoit M. Réveillon à être pendu en effigie. Lorsqu’on leur demandoit le motif de leur mécontentement, ils vous répondoient; vivrier-vous bien avec quinze sous par jour? Nous croyez-vous fort heureux en ne payant le pain que trois sous et demi la livre? On comprenoit par ces interpellations, que ceux qui les faisoient, supposoient que M. Réveillon avoit tenu des propos qui tendoient à rendre leur condition plus misérable.
Après avoir long-tems promené le manequin, ils s’arrêtèrent à la place de Grêve, et l’y pendirent. Là iis.se dispersèrent, et se jettèrent ensuite dans différens cabarets, où ils passèrent la nuit dans de bruyantes orgies.
M. Réveillon, qui étoit un des électeurs du tiers-état de Paris, se trouvoit pendant tout ce mouvement à l’archevêché avec ses collègues. Instruit qu’il étoit l’objet ou le prétexte de cette fermentation, il offrit d’aller au-devant des séditieux, et de faire généreusement le sacrifice de sa vie à la tranquillité publique; mais se rendant aux conseils de ses amis, il courut chez le lieutenant de police, et ensuite chez le colonel des Gardes-Françoises, pour en obtenir un secours qui protégeât sa manufacture. On lui accorda un détachement de quelques hommes, pour garder les avenues et l’intérieur de sa maison.
En quittant la place de Grêve, les séditieux parlèrent de projets sur un enlèvement de grains, qui alarmèrent les habitans, et ajoutèrent au désordre. On se précipitoit chez les boulangers, et on y achètoit avec profusion le pain dont on craignoit de manquer; de sorte que le lendemain plusieurs familles en manquèrent en effet, les boulangers n’ayant pu fournir à un débit qui, par les provisions qu’avoient faites les premiers venus, surpassoit de beaucoup celui qu’ils étoient dans l’habitude de faire.
L’insurrection du27n’étoit rien; celle du28fut terrible. Dès la pointe du jour, des milliers de bandits se montrèrent de nouveau dans les rues; il leur étoit arrivé un renfort considérable pendant la nuit. Les commis avoient vu entrer par les barrières un nombre effrayant d’hommes mal vêtus, et d’une figure sinistre. A la vue de cette horde de brigands, les boutiques se ferment de nouveau. Ils parcourent les différentes manufactures, y distribuent de l’argent, et de gré ou de force en emmènent les ouvriers. Tous ensuite, en poussant des hurlemens effroyables, courent au fauxbourg Saint-Antoine vers la demeure de M. Réveillon. Le détachement qui la gardoit, les contint pendant cinq heures; mais ils parvinrent à le forcer. Ils se jettèrent d’abord dans la maison de M. Henriot, chef d’une manufacture de salpêtre, voisin et ami de M. Réveillon; ils en firent voler Les meubles par les fenêtres, et y mirent ensuite le feu. M. Henriot et toute sa famille eurent le tems de s’évader.
De la maison de M. Henriot, ces forcénés se poussèrent dans celle de M. Réveillon, et s’y comportèrent avec encore plus d’emportement. M. Réveillon et son épouse venoient de la quitter, lorsqu ils y entrèrent. Ils remplirent en un clein d’oeil tous les appartemens, et s’acharnoient sur les plus prétieux; ils les brisoient, les fouloient aux pieds. Les éclats pleuvoient et s’ammonceloient dans la cour; la flamme les dévora.
Dès qu’on fut instruit qu’ils avoient forcé le détachement qu’on avoit cru suffisant pour les dissiper, on fit marcher contre eux toute la garde de Paris, le guet à pied et à cheval, le régiment de Royal-Cravate, les Gardes-Françoises et Gardes–Suisses. Toute cette troupe, traînant après elle quelques piéces de canon, marcha en bon ordre, et comme on marche à un combat qui doit être sanglant, tambour battant, mêche allumée. Dès qu’elle fut en présence des mutins, des officiers leur déclarèrent qu’on avoit ordre de repousser la force, et les sommèrent de se retirer. On leur réitéra trois fois cette sommation; ils refusèrent d’obéir, et n’en continuèrent pas moins le dégât qu’ils avoient commencé. On fit mine alors de tirer sur eux; mais, sans s’effrayer de ces menaces, ils firent pleuvoir une grêle de pierres, d’ardoises, de tuiles sur les soldats. Royal-Cravate fut le plus maltraité par ce premier accès de furie, il eût même un de ses officiers blessés; mais il ne se laissa point entraîner au desir si naturel d’une juste repressaille; il resta immobile.
Les Gardes-Françoises reçurent au même instant ordre de pénétrer dans la maison par toutes les issues, et de ne faire aucun quartier à ceux qui ne voudroient point abandonner la place. Ce régiment se rangea en bataille dans la cour, et pour effrayer cette multitude de bêtes féroces, les mit en joue, et perdit quelques coups en l’air. Ces ménagemens furent inutiles; la grêle d’ardoises et de tuiles redoubla; des meubles, des poutres, des quartiers de pierres, tomboient sur les soldats; quelques-uns en furent écrasés, et perdirent la vie; plusieurs furent blessés. Les Gardes-Françoises, voyant que toute mesure de prudence etoit inutile avec de pareils ennemis, et autant pour leur propre défense, que pour obéir aux ordres qu’ils avoient reçus, firent un feu roulant sur quatre faces.
Cette décharge fut terrible; les malheureux rouloient des toits, les murs dégoutoient de sang, le pavé étoit couvert de membres palpitans; les cris de la douleur se mêloient aux hurlemens de la rage.
Après cette première décharge, les soldats pénétrèrent dans l’intérieur de la maison, en parcoururent les appartemons, trouvèrent par-tout une résistance incroyable, et ne purent mettre hors de combat tous ces malheureux qui, se défendirent jusqu’au dernier moment en désespérés, qu’en les blessant et les jetant en dehors à coups de bayonnettes.
Dans les caves un spectacle horrible se présenta aux soldats; ils virent la terre jonchée de ces misérables. Les uns qui s’étoient gorgés de vin et de liqueurs, étoient immobiles: d’autres qui, trompés par leur avidité, s’étoient abreuvés d’acides nîtreux et de drogues empoisonnées, destinées à la teinture, se mouroient dans les convulsions, et présentaient les formes les plus hideuses.
La nuit mit fin au carnage, et un canon pointé sur le fauxbourg Saint-Antoine, protégea ce quartier. Cette affaire fut très-sanglante; les rebelles eurent plus de deux cents hommes tués, et environ300blessés. Du côté des soldats il y eût environ80blessés; dix ou douze perdirent la vie,
Lorsqu’un des rebelles avoit reçu un coup dangereux, il étoit enlevé par ceux de ses camarades qui pouvoient en approcher. On le mettoit sur un brancard, et sur la route on crioit aux passans: voilà un défenseur de la patrie; citoyens donnez de quoi l’enterrer.
J’ai interrogé plusieurs de ces misérables qu’on portait ainsi, soit dans les hôpitaux, soit dans les prisons, et il ne m’est resté aucun doute qu’ils n’eussent tous été payés, et que la taxe n’eût été de12l. J’en ai entendu un qui se mouroit dans des douleurs horribles, s’écrier: mon dieu! mon dieu! faut-il être traité ainsi pour12misérables francs!
Un d’entr’eux ne s’arrêta pas à ces inutiles regrets, et ce trait mérite d’etre cité.: renversé sur le pavé par une balle qui l’atteignit au bas ventre, et se sentant mourir, il s’écria: allons tout est f..... il chanta ensuite le dernier vers du vaudeville de Figaro: les plus forts ont fait la loi, et sa chanson finie, il expira.
L’inscription que l’on lut le lendemain matin sur la porte même de M. Réveillon, mérite également d’être citée; on y lisoit en gros caractères: toujours la messe de minuit, mais plus de Réveillon. Ces deux traits sont dans l’ancien caractère de la nation.
Dans la matinée de cette affreuse journée, M. le duc d’Orléans, qui se rendoit à Vincennes pour s’y trouver à une course à laquelle il étoit intéressé, fit arrêter sa voiture en passant devant le théâtre du combat. Il mit pied à terre, caressa plusieurs de ces gens, leur frappa sur l’épaule, les exhorta à la tranquillité, à retourner chez eux, à oublier tout ressentiment, s’ils croyoient en avoir contre M. Réveillon, et finit par leur dire: allons mes enfans, de la paix; nous touchons au bonheur. Tous ces brigands l’applaudirent beaucoup; mais ifs ne tinrent aucun compte de ses conseils.
Dans la soirée, et avant que le combat s’engageât, Madame la duchesse d’Orléans qui revenoit de Vincennes, voulut traverser la foule. Royal-Cravate qui avoit reçu ordre de ne laisser passer aucun équipage, voulut s’opposer au passage de la princesse. Les séditieux la reconnurent; ils firent effort avec leurs bâtons contre les soldats, allèrent droit à elle, escortèrent et portèrent presque la voiture jusqu’au de-Là de la foule.
Non-seulement les rebelles étoient soudoyés, mais on avoit même cherché à les fournir des seules armes qu’il fut possible de leur procurer. On arrêta du moins, quelques heures avant que l’action commençât, deux charrettes et un bateau chargés de cailloux et de bâtons, et on sut que ces deux convois leur étoient destinés.
On m’a assuré, mais comme les personnes qui m’ont raconté le fait, ne me permettent pas de les nommer, je tiens leur témoignage pour suspect, et je ne donne pas l’anecdote comme certaine, on m’a assure, dis-je, qu’en avoit reconnu parmi ceux des brigands qui remplissoient la rue, M. le comte de Mirabeau vêtu confine eux. Le fait, fut-il vrai, il ne prouveroit pas ce qu’on veut peut-être lui faire prouver. M. de Mirabeau auroit bien pu en effet ne se trouver là, ainsi que beaucoup d’autres, que comme simple observateur, et s’il eût pris un tel déguisement, on ne seroit pas en droit de conclure qu’il l’eut pris pour d’autre motif que pour observer de plus près, et tirer plus d’éclaircissemens des acteurs d’une scène qui méritoit bien en effet d’être vue de près. Ce n’est pas que ce ne fussent deux tableaux très-dignes de la révolution, et de la vie de M. de Mirabeau, de voir ce gentilhomme, le28avril1789. en accoutrement de gueux, un bâton noueux a la main, confondu parmi des bandits qui pilloient, incendioient, et qu’on fusilioit, et de le retrouver le6 octobre suivant, un sabre à la main, dans les rangs du régiment de Flandres.
Que de conjectures ne se permit-on pas sur cette désastreuse aventure! Que de fables ne chercha-t-on pas à accréditer! Il n’est cependant pas impossible à un homme impartial, d’appercevoir la vérité au sein des nuages dont tant de mensonges l’ ont obscurcie.
Dans l’assemblée primaire du district de MM. Réveillon et Henriot, il se trouva beaucoup de petit peuple. Ces deux bourgeois, ainsi que les principaux notables, ne se confondirent pas dans la foule; ils occupèrent une place qui les sépara de la multitude. Cette sorte de distinction qui n’étoit ni préméditée, ni l’effet d’aucune prétention, humilia le reste de l’assemblée, et la fit murmurer. Lorsqu’on en fut à la rédaction du cahier, chacun voulut proposer son article, chacun voulut faire sa motion. Lartisan le plus grossier, le plus mal vêtu voulut aussi faire la sienne et il la faisoit de manière à donner à connoître qu’il savoit très-bien que le droit d’être écouté lui appartenoit comme à tout autre. Ces harangues qui prolongeoient la séance étoient écoutées, par les principaux notables, avec cet air de supériorité que donnent les lumières, l’éducation, une certaine fortune, et qu’on a même sans s’en appercevoir, lorsqu’on entend des choses que l’on croit grossières et vuides de sens.
Les orateurs s’appercevoient fort bien de l’effet que produisoient leurs discours, ils prenoient pour mépris le peu d’intérêt qu’ils inspiroient. Lorsqu il fallit clore le cahier, les articles arrivoient en foule. On renvoyoit ceux des motionnaires du petit peuple; ils insistoient, demandoient impérieusement que leur volonté fût aussi manifestée; ils censuroient les articles des notables, et ne concevoient pas pourquoi ils avoient la préférence sur les leurs. Les notables, de leur côté, fatigués de toutes ces longueurs, ne purent s’empêcher d’en témoigner de l’humeur. Il échappa même à quelques-uns d’entr’eux qui croyoient n’être pas entendus des parties intéressés, de substituer, en parlant du petit peuple, l’expression ces gens-là, à celle ces messieurs.
Tous ces riens réunis inspirèrent beaucoup de mécontentement à la classe des ouvriers; elle est très-nombreuse dans les fauxbourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau; il s’est établi dans son sein une telle communication, que ce qui affecte quelques-uns de ses membres est bientôt su de tous les autres, et dans cette occasion, la querelle devient commune. Tous les ouvriers se crurent humiliés par la conduite qu’avoient tenue les notables du district de M. Réveillon; mais ils s’en tinrent à des murmures qui n’effrayèrent pas beaucoup les agens de la police, puisque ceux mêmes que ces murmures menaçoient, ne témoignoient aucune crainte. Mais les factieux connurent ces dispositions; ils en profitèrent habilement; et voulant effrayer tous les propriétaires de la capitale, ils dirigèrent leur première attaque contre un grand propriétaire.
Les autres reproches faits à M. Réveillon, à la naissance du tumulte, ont été victorieusement repoussés par lui-même, dans une pathétique apologie qu’il publia après l’orage. Voici comment il s’en explique.
«Plus de300ouvriers sont journellement dans mes atteliers. En prix de main d’oeuvre, je paye tous les ans200,000liv. au moins. Chaque ouvrier chez moi est sûr de son avancement en proportion de son intelligence et de son zèle: aussi la plupart vieillissent ils dans mes atteliers; ils savent que je m’empresse de les secourir dans leurs infirmités, et de les aider dans leurs besoins».
«Pendant une partie des froids de l’hiver dernier, les travaux des atteliers supérieurs furent suspendus. Je gardai tous les ouvriers sans exception; je leur payai leurs journées le même prix qu’auparavant: j’usai des précautions les plus minutieuses pour qu’aucun d’eux ne souffrît des rigueurs de la saison»
«Devois-je m’attendre que trois mois après, le peuple me traiteroit comme un homme féroce et insensible aux misères du pauvre? Que l’ami, que le père des ouvriers seroit traité comme leur plus barbare ennemi, et que le propriétaire de cette manufacture où tant d’ouvriers trouvent leur subsistance, seroit subitement en butte à la haine et à la fureur de4000ouvriers?....»
«Une perte immense, une maison dont je faisois mes délices, mon crédit ébranlé, ma manufacture détruite peut-être, faute de capitaux nécessaires pour la soutenir; mais sur-tout, (et c’est ce qui m’accable) mon nom qui a été voué à l’infamie, mon nom qui est abhoré parmi la classe du peuple la plus chère à mon cœur; voilà les suites horribles de la calomnie répandue contre moi».
«Et cependant quels sont mes torts?... On m’accuse d’avoir taxé les ouvriers et journaliers 15sols par jour. Jamais la calomnie n’a été plus injuste, et jamais elle n’a paru plus cruelle. Un mot, ce me semble, suffiroit pour me justifier. De tous les ouvriers qui travaillent dans mes atteliers, la plu part gagnent30, 35et40 sols Par jour, plusieurs en ont50. Comment donc aurois-je fixé à15sols le salaire des ouvriers?»
Le récit de M. Réveillon prouve très-bien que sil a été la victime de cette insurrection, c’est que ceux qui l’avoient occasionnée, indifférens sur le choix des des propriétés à dévaster, avoient trouve une occasion naturelle de lui donner la préférence. Mais M. Réveillon ne s’en tint pas là, il voulut encore tirer le voile sur cette machination; et en cherchant à éclaircir ce mystère, qui n’en est plus un aujourd’hui, il tomba dans une absurdité aussi peu vraie que vraisemblable.
Il imprima que des ennemis cruels l’avoient ose peindre au peuple comme un homme barbare, qui évaluoit, au prix le plus vil, les sueurs des malheureux. De tous ces ennemis cruels, il ne désigna qu’un seul homme avec lequel il avoit une contestation judiciaire. Cet ennemi unique étoit un ecclésiastique appellé Roy, membre de quelques académies, censeur royal, secrétaire d’un prince, et connu assez avantageusement parmi les gens de lettres par quelques écrits, mais sur-tout par son histoire des cardinaux.
M. Réveillon raconta que M. l’abbé Roy s’étoit adressé à lui, pour avoir la quantité de papier nécessaire à l’impression de cette histoire des cardinaux; qu’il s’y étoit introduit à la faveur d’une lettre de recommandation que lui avoit donnée M. le duc de Charost. M . Réveillon ajoutoit qu’à la vue de cette lettre, il n’avoit pas hésité à remettre à crédit, et sur de simples billets, à M. l’abbé Roy, tout le papier que celui-ci lui demanda.
Le débiteur, dit toujours M. Réveillon, n’ayant pas rempli ses engagemens, j’en écrivis à M. le duc de Charost qui fit passer ma lettre à l’abbé Roy. Celui-ci coupa la lettre au-dessous de la dernière ligne, et remplit ensuite l’espace qui restoit entre cette dernière ligne et la signature, d’une obligation, en sa faveur, de6000liv.
Toute cette histoire n’a pas beaucoup de rapport avec les désordres du27et du28; mais M. Réveillon en concluoit, ou du moins donnoit à entendre, qu’ayant dénoncé aux tribunaux le délit de son débiteur, celui-ci pour se venger, avoit soudoyé les six mille brigands qui avoient pillé et incendié les deux maisons du fauxbourg Saint-Antoine.
Or, voilà certainement l’histoire la plus incroyable que l’on puisse conter à des hommes sensés. Je ne prononce point sur le mérite de l’accusation de faux, qui n’est point encore jugée, et qui ne parut pas assez bien prouvée au Châtelet, pour frapper l’accusé d’un décret de prise-de-corps. Je conviendrai même que, soit que l’accusation fût fondée, soit qu’elle ne le fut pas, celui contre qui elle étoit dirigée, ne devoit pas beaucoup aimer son accusateur.
Mais où M. J’abbé Roy, perdu de dettes, de l’aveu de M. Réveillon, obligé d’acheter à crédit quelques rames de papier, réduit, par la détresse, à se souiller d’une infâme escroquerie, auroit-il trouvé une somme assez considérable pour soudoyer six mille brigands taxés chacun à12livres? Trois mille louis dissipés pour satisfaire un désir de vengeance supposent, à celui qui se donne cette fantaisie, une fortune immense, et celle de M. l’abbé Roy étoit au-dessous de rien.
Faut-il d’ailleurs six mille brigands pour se défaire d’un ennemi qui n’a aucune armée à opposer? Je ne connois pas même de vue M. l’abbé Roy, mais s’il avoit conçu un aussi infernal projet, il seroit certainement le plus scélérat des hommes, et alors je trouverois presque plaisant, qu’étant doué d’une ame aussi noire, et ayant à sa disposition trois mille louis pour satisfaire sa passion, il se fût borné, pour toute vengeance, à déranger, pour quelques jours, la fortune de son ennemi.
Il faudroit donc se réduire à dire, comme l’a fait un écrivain anonyme qui nous à donne l’histoire de cette première insurrection, que M. l’abbe Roy etoit, non l’auteur, non le chef de la sédition, mais un instrument entre les mains puissantes qui le faisoient mouvoir. Cette explication n’est guerre satisfaisante, car d’abord elle ne montre pas les mains puissantes qui faisoient mouvoir, et ce sont elles que nous voudrions voir.
Si en outre M. l’abbé Roy a été un instrument, il a donc été dépositaire de la somme employée pour L’exécution du complot, et je m’étonne que dans l’état de détresse où il étoit, et qu’avec le caractère de déloyauté qu’on lui donne, il ait préféré de courir Les fauxbourgs, les atteliers, de battre la campagne aux environs de Paris, pour répandre cette somme, au risque de ne pas réussir, plutôt que de la garder pour lui-même.
Je suppose qu’il ait bien fidélement tenu parole aux puissances qui le faisoient mouvoir; ces puissances n’en ont pas moins dû, vu les dangers qu’il couroit, lui faire sa part, et acheter bien chèrement son zèle et sa discrétion. Or, les personnes qui ont suivi de près cette affaire, savent que M. l’abbé Roy étoit tout aussi infortuné après qu’avant l’aventure.
Ces méprisables folies s’accréditèrent tellement contre lui, qu’un cri presque universel demanda sa détention. Il fut arrêté et conduit dans les prisons du Châtelet. On arrêta en même tems une personne qui lui étoit extrêmement chère; celle-ci fut mise dans une autre prison; y mourant de faim, M. l’abbé Roy lui fit passer sa montre qui étoit le seul bien qui lui restât. Ce foible secours épuise, cette personne mourut de misère sur un grabat. Voilà un fait dont je suis certain, pour l’avoir vérifié sur les lieux; réuni à mille autres, il m’a convaincu non-seulement que M. l’abbé’Roy n’avoit point été un instrument entre des mains puissantes, mais même qu’il n’avoit joué aucun rôle dans toute cette manœuvre; s’il en eût joué un, de quelque nature qu’il fût, il lui auroit été payé.
Il subit au Châtelet plusieurs interrogatoires, et il les subit au fort de la tempête, c’est-à-dire dans un moment où la prévention étoit extrême contre lui, et où les prisons regorgeoient des malheureux qu’on avoit fait prisonniers sur le champ de bataille. Aucun ne le chargea, et tous assurèrent ne pas même le connoitre de nom. Ses propres interrogatoires furent simples, et ne fournirent aucune sorte de lumières sur ce qu’on avoit tant d’intérêt à découvrir; si bien que ses juges se, virent obligés de lui rendre la liberté.
La rumeur continuant toujours contre lui, on réveilla la première affaire. M. Réveillon poursuivit au parlement, avec chaleur, l’accusation de faux. M. l’abbé Roy se présenta avec sécurité au pied du tribunal. Il attendit paisiblement au café de Malthe, qui est à côté de la conciergerie, la décision. On Tint lui dire qu’il étoit décrété de prise-de-corps; il hésita quelques instans, mais enfin il se décida à mettre sa liberté en sûreté, et depuis il a été nul pour la révolution.
C’est-là l’homme que M. Réveillon indiqua au public, pour le fauteur d’une sédition à laquelle il n’eut certainement aucune part. En eût-il été ou le chef ou l’instrument, il n’y avoit pas plus de présomption à croire qu’il eût été employé par les triumvirs, comme on le vouloit, que par le parti contraire.
tout ce qu’on dit a cet égard sur le gouvernement est une pure fable. On prétendoit, et on a écrit dans l’ouvrage que j’ai cité plus haut, qu’on avoit vu dans la mêlée plusieurs personnes décorées, payant, excitant, soulevant les ouvriers, et recrutant cette malheureuse troupe qu’on envoyoit de gaieté de coeur à la boucherie.
Ce sont la des comptes qui n’ont pas même le mérite d’être présentés avec adresse. Quelques recherches que j’aie faites, quelques renseignemens que j’aie pris sur les acteurs de cette lamentable scène, je ne trouve parmi eux qu’un seul homme qui fût véritablement décoré, et cette décoration consistoit en un ruban des chevaliers de Saint-Jean-de-Latran. L’homme qui le portoit ne payoit pas, ne recrutoit pas, mais il paroissoit prendre beaucoup d’intérêt aux brigands. On l’arrêta; il se trouva qu’il étoit un aventurier qui changeoit de croix, comme de nom et de pays. Le ruban qu’il avoit à la boutonnière, le fit prendre pour un chevalier de Saint-Louis. Il avoit été banni une première fois de Paris, sous le nom de chevalier de Bonneville. Il y paroissoit cette fois-ci sous le nom de chevalier de Saint-Romain.
Les juges ne trouvèrent point assez de preuves pour l’envoyer au supplice; ils condamnèrent à la corde deux hommes et une femme; celle-ci se déclara enceinte, et échappa ainsi à la mort. Les deux premiers furent exécutés, et cette exécution fut un véritable spectacle. Toute la garde de Paris, le régiment des gardes-françoises, celui des gardes-suisses, un régiment de dragons et un de cavalerie escortèrent les patiens, depuis le Châtelet jusqu’au fauxbourg Saint-Antoine où les potences étoient dressées. Leur supplice ne causa aucun tumulte.
Si l’on ne vit aucune personne décorée sur le champ de bataille, pendant la terrible action du28, on y vit en revanche plusieurs femmes parmi lesquelles je ne doute pas qu’il n’y en eut beaucoup qui n’en eussent que l’habit. Elles étoient armées de lourds bâtons; elles se saisissoient avec avidité du premier bonnet de grenadier qu’elles pouvoient se procurer, le mettoient sur leur tête, et étoient cent fois plus acharnées au combat, que les hommes qu’elles animoient du geste et de la voix. On en vit quelques-unes qui, au lieu de bâton, avoient un sabre nud à la main.
On reprocha au gouvernement, et ce reproche parut spécieux et sans réplique, de n’avoir pas empêché l’incendie qui, s’il n’eût pas eu lieu, auroit épargné la scène de sang qui le suivit. On disoit que la police ayant été avertie vingt-quatre heures d’avance par M. Réveillon, avoit eu tout le tems de prendre les précautions nécessaires pour prévenir le désordre. On la blâmoit de n’avoir pas accordé à M. Réveillon un secours d’hommes plus considérable que celui qu’il avoit obtenu.
Il est bien vrai que le détachement commandé pour protéger sa maison ne fut pas suffisant, puisqu’il fut forcé; mais il falloit bien que M. Réveillon criât lui-même qu’il n’avoit pas besoin d’une plus forte troupe pour mettre sa personne et ses propriétés en sûreté. En effet, il rentra tranquillement chez lui le27au soir, y passa toute la nuit, et n’en sortit le lendemain, avec sa famille, que lorsqu’il vit le détachement forcé, et la première avant-garde des brigands.
Il y a mieux, et ayant eu lui-même vingt-quatre heures pour transporter en lieu sûr, au moins ses meubles les plus précieux et les plus portatifs; il nous apprend lui-même dans son mémoire, que les brigands lui prirent tout, même ses registres, son porte-feuille, ses billets de caisse, 500louis en or, et jusqu’à une médaille sur laquelle il fait cette exclamation: Ah! je le dis du fond de mon cœur, j’eusse peu regreté cette somme, si ma médaille m’était restée.
L’extrême attachement de M. Réveillon pour cette médaille, venoit de ce qn’elle lui avoit été accordée comme une récompense honorable de ses essais pour la fabrication de papiers vélains à l’imitation des Anglois. Elle étoit le prix institué par M. Necker, pour l’encouragement des arts utiles. Un tel objet étoit bien aisé à mettre même à la poche. Pour que M. Réveillon ne s’en soit pas saisi, il faut que sa sécurité, jusqu’au dernier moment, ait été pleine et entière. Elle ne pouvoit avoir d’autre motif que le secours d’hommes qui lui avoit été donne. Si on supposoit à cette confiance un autre motif, elle ne seroit plus concevable.
Pourquoi donc la police auroit-elle prévu un événement que M. Réveillon, éclairé par son intérêt personnel, ne prévoyoit pas?
Mais, disoit-on, le gouvernement cherche un prétexte pour nous environner de troupes, et c’est pour nous prouver la nécessité d’en remplir la capitale, qu’il a voulu le feu et l’incendie de la maison de M. Réveillon.
Quel besoin avoit alors le gouvernement, de chercher des prétextes pour faire exécuter ce qu’il auroit plû au roi d’ordonner? Le tems n’étoit pas encore venu, où le pouvoir exécutif, comme l’a dit depuis judicieusement un de nos législateurs, avoit intérêt de faire le mort. Le roi, à cette époque, pouvoit faire entrer dans Paris une armée de cent mille hommes, sans qu’il fût nécessaire de recourir à la pitoyable ressource de faire brûler quelques meubles à l’extrémité d’un fauxbourg.
Un seul moyen auroit pu empêcher ce malheur: il avoit toujours été d’usage dans les émeutes populaires.; ceux qui avoient le plus d’ascendant sur l’esprit de la multitude, se présentoient à elle, et presque toujours ils parvenoient à arrêter ses emportemens. C’étoit même une des fonctions essentielles des hommes en place.
M. le duc d’Orléans et M. Necker possédoient, à l’époque où ce malheur arriva, toute la confiance du peuple. Qu’eussent pu leur refuser des gens dont ils étoient idolâtrés? Que risquoient-ils du moins de faire, dans une occasion aussi importante, un essai de leur crédit? M. d’Orléans se montra bien à ces furieux, mais il n’obtint rien; et M. Necker, non-seulement ne vint pas les haranguer, il sembla encore abandonner aveuglément les mesures à prendre dans cette circonstance, à des gens qu’il savoit bien avoir perdu toute la confiance du peuple. On eût dit qu’il ignoroit absolument ce qui se passoit, et ce ne fut que plus d’un mois après qu’on sut la part qu’il y prenoit, par la lettre suivante qu’il adressa à M. Réveillon.
«J’ai pris beaucoup de part, Monsieur, à vos malheurs, et j’ai lu avec émotion, comme tout le public, le récit simple, touchant et mesuré que vous en avez fait. Je dois des louanges aussi à la discrétion avec laquelle vous avez eu recours à la justice et à la bonté du roi. Bien d’autres sûrement, avec bien moins de droits, auroient demandé davantage. Cependant placé, comme je le suis, pour défendre les intérêts du trésor royal, et persuadé de l’exacte vérité de vos sentimens, j’ai accepté votre discrétion, et je me suis borné à la faire valoir auprès de sa majesté. Voici donc, selon votre propre désir, ce que le roi vient de vous accorder.
Io. Le rétablissement de votre médaille que vous avez si bien méritée.
2o. La conservation du titre de manufacture royale en faveur de votre établissement s’il est dirigé dorénavant par des personnes de votre choix.
3o. La même grâce en faveur de la manufacture de Courtalin dont la propriété vous est due.
4o. La remise des dix mille livres dont vous êtes caution.
5o. Une indemnité de trente mille livres.
Enfin sa majesté a bien voulu permettre selon la teneur de l’arrêt du conseil du28décembre1777, que vous puissiez profiter de la faveur promise par le roi aux citoyens qui auroient obtenu la médaille d’industrie, et qu’à l’époque où elle vous sera rendue, je puisse prendre les ordres de sa majesté pour vous présenter à elle, puisque vous n’avez pas joui de cet honneur.
Je desire que ces différentes dispositions, et surtout l’assurance des bontés du roi, vous rendent au calme d’une vie que vous avez honorée par vos talens, et l’honnêteté de votre conduite.
Je suis ect.,
Signé, NECKER.
Parmi les personnes qui furent accusées d’avoir excité cette sédition, il est à remarquer que M. la duo d’Orléans lui-même ne fut pas épargné: on se disoit d’abord mystérieusement, et ensuite tout haut, que c’étoit par ses menées et avec son or, que cette armée de brigands avoit tout-à-coup paru. Cette opinion fit même un tel progrès, que le prince en fut si non allarmé, du moins affecté. Il s’y montra encore plus sensible qu’aux accusations légales intentées depuis contre lui, et pour un crime encore plus atroce. Il fit beaucoup de bruit, il annonça publiquement qu’il réclameroit la justice du roi contre les véritables auteurs de l’émeute; qu’il les déclareroit, les dénoncerait aux états-généraux pour qu’ils y fussent jugés; qu’il solliciterait pour eux la plus rigoureuse justice, et enfin qu’il imprimerait et rendrait publique sa dénonciation. Ces assurances ne se sont jamais réalisées; il en a été d’elles comme de cette autre apologie annoncée solemnellement dans la tribune de la nation, et qui n’a jamais paru.
Quoique M. Necker n’eût paru prendre aucune part à ces désordres, ses partisans publièrent dans Paris qu’il en étoit vivement affligé, et on vouloit que les autres ministres en eussent une joie secrette. Ce n’étoit du moins pas M. de Villedeuil retenu au lit et assez dangereusement malade. La tournure qu’il voyoit prendre aux affaires paroissoit l’inquiéter plus qu’un autre. Il nourissoit au fond de son ame une véritable douleur du mécontentement que le roi lui avoit témoigné à l’occasion de la détention du libraire chargé de fournir à sa majesté les écrits nouveaux. M. de Villedeuil avoit été saigné quatre fois depuis le jour où il avoit eu le malheur de déplaire au monarque.
Mais personne en France ne ressentit plus de chagrin des scènes qui avoient ensanglanté le fauxbourg Saint Antoine que Louis XVI. Elles étoient le présage des calamités qui alloient fondre sur son royaume, et depuis ce jour ce prince si digne d’être heureux n’a plus goûté de bonheur. Depuis ce jour, les récits les plus affligeans sont venus déchirer sa belle âme.
Cette cruelle résolution de contraindre les bourgeois à prendre les armes, n’a cessé en effet de faire succéder un malheur à un antre malheur, et a couvert la France de deuil et de forfaits.
En même tems que des légions de scélérats violoient avec brutalité à Paris les propriétés de deux négocians, des atrocités à-peu-prés semblables désoloient la ville d’Orléans. Le petit peuple tourmenté longtems par la cherté du pain, et la frayeur d’en manquer tout-à-fait, perdit enfin toute mesure. Il se jetta tout-à-coup avec fureur sur plusieurs magasins qu’il força. Il enfonça entr’autres celui de M. Rime riche négociant. Il renfermoit huit cents sacs de farine qui furent pillés. La maison fut démolie, et une somme de quarante mille livres d’argent monnoyé qu’on y trouva fut volée. M. Rime lui-même fut obligé de sortir de la ville. Les scélérats qui se livrèrent à ces attentats, pour n’être point surpris par les troupes du roi, avoient eu la précaution de mettre en embuscade à chaque porte de la ville trois cents hommes. L’intendant s’étant transporté au milieu des brigands, pour essayer de les détourner de toutes ces violences, faillit perdre la vie par un stratagême assez singulier. Pendant qu’il harangnoit à la porte d’un boulanger, le peuple qui remplissoit la rue, un misérable lui faisoit descendre sur la tête, par la fenêtre d’un troisième étage, une corde qui se terminoit par un noeud coulant destiné à l’exhausser et à lui faire perdre la vie. Le magistrat heureusement s’apperçut de la fatale invention, à l’instant où la corde l’atteignit, et où l’on s’apprêtoit à lui en ceindre le col. Le péril lui donna de la vîtesse, et il échappa par une fuite précipitée à ses bourreaux.
Il est bien clair que si le gouvernement eût salarié ces assassins, il auroit dirigé leur fureur contre ceux qui lui suscitoient des embarras, et eût pris des mesures pour qu’ils épargnassent ses agens. Mais tel étoit l’aveuglement: le peuple ne reconnoissoit plus pour amis que MM. d’Orléans et Necker. La haine contre les princes triumvirs rejaillit jusques sur ceux qui leur appartenoient, et leurs gens n’osèrent plus se montrer dans les rues avec la livrée de leurs augustes maîtres.
27. Les électeurs cependant du tiers-état continuoient à l’archevêché leur travail. Ils reçurent au commencement de leur seconde séance une députation du clergé, composée de MM. les abbes de Montesquiou, de Bonneval, de la Gard, Sabattier, Des-places; les curés de St. Eustache, de St. Nicolas-des-Champs, et le général des Bénédictins.
Cette députation laissa sur le bureau un arrêté dont voici la teneur:
«L’ordre du clergé de l’assemblée de Paris a délibéré et arrêté unanimement de concourir proportionnellement à ses revenus à l’acquittement des charges publiques, librement consenties par les trois ordres dans les états-généraux; la chambre ecclésiastique ne se permettant pas de douter que la nation ne reconnoisse comme dettes de l’état les dettes du clergé, parce qu’elles ont toutes été contractées pour son service».
M. l’abbé de Montesquiou, après avoir déposé cet arrêté, adressa à l’assemblée un discours dans lequel il l’assura des sentimens de fraternité du cierge. Il dit que son ordre regardoit l’abandon des privilèges pécuniaires, non comme un sacrifice, mais comme un acte de justice; que s’il avoit long-tems défendu ses immunités, c’est qu’elles étoient jadis celles de la nation entière, et qu’il avoit toujours conservé l’espérance que la nation les recouvreroit un jour.
M. l’abbé de Montesquiou n’avoit guères été connu jusqu’à ce jour que dans son ordre. Il étonna le tiers-état par la noblesse et la simplicité de son éloquence. Il est en effet un des plus grands et des plus aimables orateurs de ce siècle; il réunit tous les avantages, un des plus beaux noms de France, une réputation pure, un extérieur agréable, de l’urbanité dans les manières, un esprit toujours sage, toujours vrai, l’art de répandre des graces sur les vérités les plus austères; ses discours sont lumineux, clairs; il enchaîne ses idées avec méthode et les développe sans effort; ses vues ont de la profondeur, il les présente avec énergie, et cependant son élocution est toujours douce et onctueuse. Ses principes sont solides, ses pensées brillantes; ses premières phrases attirent l’attention, et personne ne sait mieux que lui la fixer. Par une singularité qui lui est peut-être particulière, son éloquence, n’a pas fait une seule conquête, toujours contredit sans être refuté, toujours vaincu en défendant la plus juste comme la plus belle cause, bien loin de perdre dans l’opinion, il a, par ses propres défaites, gagné l’estime universelle, et personne ne jouit d’une plus grande considération.
M. Camus qui ce jour-là faisoit les fonctions de président reçut ce premier hommage du premier ordre de la nation, d’un ordre dont il étoit l’avocat, qui l’avoit couvert de bienfaits, et qu’il devoit bientôt combattre avec une scandaleuse immoralité. Il répondit que le tiers-état étoit très-reconnoissant, et ajoutoit aux sentimens de fraternité ceux du respect filial qui est dû aux chefs de l’ordre ecclésiastique.
L’assemblée entière prit de plus un arrêté concu en ces termes:
«L’assemblée du tiers-état a vu avec une extrême sensibilité dans l’arrêté de l’ordre du clergé, l’expression des sentimens de justice qui animent cette portion distinguée du clergé de France. Les vœux de fraternité et d’égalité prononcés par son orateur, ont causé à l’ordre du tiers-état une émotion vive, dont il conservera le souvenir dans l’heureuse circonstance qui l’appelle à concourir à la régénération de l’empire francois».
Nous verrons dans la suite, de quelle nature étoit cette émotion vive, s’il n’eût pas mieux valu que le tiers-état en eût perdu tout souvenir. On s’étonne en lisant cet arrêté, du style de sa rédaction, et on ne croiroit jamais qu’il a été pris dans une assemblée qui renfermoit tant d’hommes de lettres.
Dans cette même séance, on nomma les commissaires pour la rédaction des cahiers; ces commissaires furent: MM. Guillotin, Marmontel, le Couteulx de la Noraie, Camus, Coster, Martineau, Gorneau, Tassin, Vignon, la Cretelle, Collet, Duclos Dufresnoy, Thonin, Poignet, Beviere, Panckouke, Hutteau, Bailly, Germain, Deseze, Réveillon, Etienne, Thouvenel, de la Frenaie, Gaillard, Delondre, Suard, Boscari, Target, Trudon, Cadet, Gibert, Perégaux, Regnier, Threilhard et Séjourné.
Cette nomination faite, on vit paroître M. le marquis de Gouy d’Arcy; si on étoit un grand homme, en se donnant beaucoup de mouvement, en faisant beaucoup de bruit, M. de Gouy d’Arcy seroit le premier homme de ce siècle. Je ne veux pas me hâter de donner son portrait à mes lecteurs; je le laisserai auparavant se produire et s’agiter sur différens théâtres. Il venoit apprendre à Messieurs les électeurs qu’il étoit député de la colonie de Saint-Domingue et que cette colonie sollicitoit l’admission aux états-généraux, et la liberté de former des assemblées particulières pour nommer des représentans. Il dit de plus que les députés de la colonnie étoient déjà arrivés en France, et quils demandoient à être admis aux états généraux, ou du moins qu’on y reçût et qu’on y appuyât leur reclamation.
Il n’y avoit au monde, que M. de Gouy d’Arcy, qui put croire que trois cens membres environ du tiers-état de France pussent prononcer sur un objet pour lequel ils n’avoient aucune sorte de mission, puisque toute leur fonction se réduisoit à nommer des députés aux états-généraux. Mais ce gentilhomme vouloit se faire connoître, et les électeurs étoient peut-être flattés de voir un noble, une colonie entière réclamer leur protection. Ils accueillirent donc la députation; M. de Gouy d’Arcy parla aussi long-tems qu’il voulut parler, et on sait qu’il parle longuement: il déposa ensuite sur le bureau ses dépêches, et se retira.
Les momens étoient trop précieux pour qu’on s’arrêtât à les ouvrir; les états-généraux devoient commencer le4mai, et on auroit bien voulu que les députés de Paris pussent se trouver à la cérémonie de l’ouverture. Un membre proposa de les nommer sur le champ. La proposition parut digne d’être gravement discutée; il étoit tard, parce qu’on avoit perdu beaucoup de tems à écouter M. d’Arcy. Cette considération fit remettre la discussion au lendemain.
29. Le lendemain donc, on mit en délibération, si l’on nommeroit les députés avant de s’occuper de la rédaction des cahiers. Le cas parut très-embarrassant; si l’on s’occuppoit des cahiers, avant de nommer les députés, ceux-ci manqueroient non-seulement a l’ouverture, mais à plusieurs des séances des états. Dans ces séances, on nommeroit des présidens et des secrétaires; les représentans de la capitale n’auroient donc aucune part à ces élections. L’objet d’une des premières, délibérations des états, seroit de décider si les trois ordres se réuniroient pour opiner par tête, ou si l’on voteroit par ordre. N’y avoit-il pas un grand inconvénient à ce que la première ville du royaume fut la seule à ne pas influer sur une délibération la plus importante de toutes?
D’un autre côté, précipiter la nomination des députés, c’etoit se priver d’un tems précieux pour étudier, connoître les membres de l’assemblée, et pour se décider sur le choix. Les cahiers et le travail des commissaires devoient nécessairement procurer des lumières à cet égard. La confection des cahiers ne devoit-elle pas d’ailleurs précéder la nomination des députés? Ces cahiers contiendroient essentiellement les pouvoirs donnés aux députés, et les obligations qui leur seroient imposées. Les députés pouvoient-ils aller aux états-généraux, sans être munis de ces pouvoirs? Pouvoient-ils accepter leur commission, sans connoitre les obligations qu’ils avoient à remplir? Suivant la nature de ces obligations, il y auroit peut-être telle personne qui ne pouvant s’y engager, seroit dans le cas de refuser la députation.
On voit par ces débats, que je rends bien fidèlement, qu’il étoit également dangereux de s’arrêter à l’un ou à l’autre parti: et M. Necker se sauvera-t-il du reproche d’avoir laissé un si court espace de tems entre la rédaction des cahiers, la nomination des députés, et l’ouverture des états-généraux? Plus on vouloit, plus on avoit besoin qu’ils fussent sagegement composés, et moins on devoit mettre de précipitation dans la formation des élémens qui dévoient les constituer. Il étoit intéressant sans doute que toutes les parties de l’empire y fussent sagement représentées; mais de toutes les villes, il n’en étoit aucune dont il fut plus important de bien organiser la députation, que celle de Paris, parce qu’outre que cette députation seroit très-nombreuse, elle devoit encore influer particulièrement sur les délibérations, puisqu’elles représentoient la capitale du royaume; et cependant cette ville d’une population immense, étoit la seule dont les habitans n’avoient eu que quelques jours pour se réunir à la hâte, et nommer avant de se connoître, leurs représentans. C’étoit en vérité se jouer du sort de la France, de mettre tant de hâte dans une affaire qui alloit décider de son salut ou de sa ruine.
Les électeurs se trouvoient donc enfoncés dans un labyrinthe dont il étoit difficile de sortir avec succès. Quelques membres crurent trouver une issue en composant un cahier divisé en deux parties: la première constitutionnelle, auroit pour objet la liberté, la propriété des citoyens, l’ordre immuable à mettre dans les finances, et auroit contenu en outre les pouvoirs essentiels des députés.
La seconde partie auroit été de détails et de localités; on l’auroit rédigée à loisir, et envoyée ensuite aux députés, comme instruction. Mais les détails mêmes des instructions, et les localités pouvoient contenir des obstacles à l’acceptation des députés. D’ailleurs, c’étoit laisser sans réponse la plus importante question: un pouvoir donné et des obligations imposées à un mandataire, ne doivent-ils pas lui être connus dans leur entier, afin que son acceptation soit complette et vraiment obligatoire? Il ny avoit pas de réponse à cette question; il falloit donc avoir des cahiers entiers, définitifs; il falloit que la lecture en fût faite à l’assemblée générale.
«Les fonctions augustes et importantes, dit un électeur s’élevant déja au ton constitutionnel, dont l’assemblée est chargée, la confiance de tous les citoyens dont elle est revêtue, ne lui permettent dans sa marche aucune précipitation, quelque légitime que puisse en être la cause. Les principes de justice, et les formes légales doivent être, dans tous les teins, rigoureusement observés; mais sur-tout dans le moment où nous sommes appellés à poser les bases de la constitution, les premières lois de la société où nos neveux doivent vivre; acte solemnel qui est la première de toutes les formes légales, et qui n’admet rien que de légal dans ses préparations».
Ce langage n’étoit pas équivoque; il devoit naturellement un peu étonner la cour. Il entraîna l’assemblée; elle aima mieux ne prendre aucune part aux premières délibérations des états-généraux, à des délibérations dont le résultat pouvoit changer la situation du royaume et de la capitale, que de ne pas rédiger à loisir un cahier académique, dont aucune disposition n’a été suivie.
Il fut donc décidé qu’on procéderoit avant tout à la rédaction des cahiers.
Le soir, les commissaires chargés de cette rédaction, se réunirent, et pour tout travail, lurent les cahiers et les pouvoirs donnés par chaque district à ses électeurs.
30. Le lendemain matin, dès les huit heures, les mêmes commissaires se rassemblèrent dans la bibliothéque des avocats, et se constituèrent en dix comités ou bureaux, sous les titres de constitution, finances, agriculture et commerce; religion, clergé, moeurs, éducation, hôpitaux, législation, municipalité. Ils travaillèrent ce jour-là jusqu’à dix heures du soir.
Je m’arrête ici un instant: une nouvelle carrière s’ouvre à mes regards; tous les objets qui s’y présentent intéressent; mais que d’images sanglantes mes lecteurs y rencontreront, en la parcourant avec moi!