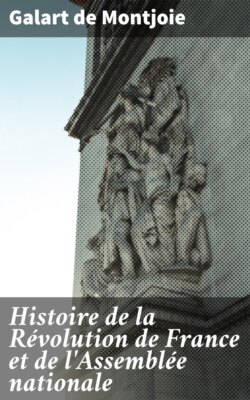Читать книгу Histoire de la Révolution de France et de l'Assemblée nationale - Galart de Montjoie - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE XV.
ОглавлениеTable des matières
Tentatives des séditieux aux environs de Paris; désordres dans les provinces; conjectures des Parisiens sur l’effroyable multiplication de brigands; nouveaux troubles à Marseille; généreuse et sage conduite du parlement de Provence; amnistie; premières motions incendiaires au Palais-Royal; anecdote singulière sur un faussaire; séances des électeurs des1er et2mai; présentation des trois ordres au roi; murmures sur le costume des trois ordres; anecdote sur un député breton à qui ce costume donnoit de l’humeur; séance des électeurs du3mai; procession qui précède l’ouverture des états-généraux; détails et anecdotes sur cette cérémonie; séance des électeurs du4mai; première séance des états-généraux; détails et anecdotes sur cette séance; discours du roi; ivresse qu’il produit; justice rendue à la reine; injustice envers M. le garde des sceaux.
Mai1789.
IL n’est plus de beaux jours ni pour la France, ni pour son roi. Les premiers efforts pour porter la bourgeoisie du royaume à une insurrection, déchirèrent le sein de notre patrie, et la couvrirent de plaies qui saigneront long-tems. Paris étoit bien gardé; les troupes avoient montré dans la sanglante expédition du fauxbourg Saint-Antoine, qu’elles savoient protéger l’ordre et la tranquillité. Les brigands laissèrent donc quelques jours la capitale tranquille, mais ils se montrèrent dans les environs, et tous les rapports que l’on faisoit de leur nombre et de leurs menaces, ne laissoient pas de tenir les Parisiens dans une inquiétude continuelle.
On vit quelques jours après l’incendie de la maison de M . Réveillon, un attroupement de cinq à six cents vagabonds auprès de Villejuif. Ils se répandirent dans toute la campagne, menacèrent par deux fois de briser les portes du château de Bicêtre. Des troupes s’approchèrent de cette prison, et ne trouvèrent plus d’ennemis à combattre. Ils s’étoient répandus dans les différens villages de la banlieue, dont ils effrayoient les habitans par des projets de dévastation et de pillage; ils s’approchèrent de Saint-Cloud, et l’on disoit qu’ils avoient dessein de faire une irruption à Versailles.
Des cavaliers étoient sans cesse à leur trousse, et lorsqu’ils arrivoient sur les lieux où ils croyoient en trouver des bandes, leur attente étoit trompée, les brigands avoient disparu.
Ce manége harceloit les troupes, et tenoit les habitans de la capitale et des villes voisines, dans l’attente d’une inondation de ces malheureux.
Dans les provinces, ils ne s’en tenoient pas à des courses menaçantes; la Normandie en étoit désolée: mais aucune province n’eut plus à en souffrir dans ces premiers jours de la révolution, que le Languedoc. Ils infestèrent les environs de Montpellier et de Nimes; ils tâchoient de s’associer les paysans, ils soulevoient les villages, mettoient les châteaux à contribution, et, dans plus d’un endroit, ils ne se contentèrent pas de piller, ils commirent même des meurtres. M. le comte de Périgord fut obligé de leur donner la chasse à la tête de deux régimens.
Les bourgeois de Caen ne répondirent pas aux vues de ceux qui avoient lâché toutes ces bêtes féroces; ils ne prirent pas les armes; ils se contentèrent de planter aux portes de leur ville, sept potences qui restèrent toujours dressées, et qui en effet les préservèrent d’une irruption. Les brigands qui battoient la campagne des enviions, n’osèrent approcher de la ville, mais ils firent d’horribles dégâts dans les villages et dans les hameaux.
Il est bien singulier qu’au même tems, et presque au même jour, de pareilles atrocités se répétassent sur tous les points de la France. Du midi au nord, des hordes de ces malheureux la menaçoient, et rappelloient les anciennes irruptions des Normands. Le Béarn en fut successivement couvert; la ville de Meaux faillit en être saccagée.
Il n’étoit pas une province, pas un canton d’où il n’arrivat journellement à Paris les relations les plus affligeantes: on ne parloit dans les cercles de la capitale, que de pillages, d’incendies, d’assassinats commis dans quelque coin du royaume. On ne savoit que penser d’un tel fléau; on ne comprenoit rien à cette innombrable quantité de malfaiteurs, qui, sans chefs apparens, serabloient être d’intelligence pour se livrer par-tout aux mêmes excès, et précisément à l’instant où les états-généraux alloient s’ouvrir. On ne pensoit pas que la France put produire autant de monstres; on vouloit qu’ils fussent la plupart étrangers; que notre sol eut été couvert de l’écume de toutes les nations; que les Italiens eussent poussé sur les côtes de Provence et de Languedoc, et les Anglois sur celles de Normandie et de Bretagne, tous leurs brigands. Nos voisins et sur-tout les Anglois, disoient les Parisiens, jaloux du bonheur que nous allons conquérir, Veulent y apporter des obstacles insurmontables. Ils se flattent d’accroître les embarras inséparables des premiers jours d’une révolution, et peut-être veulent-ils profiter de notre foiblesse momentanée, pour démembrer et conquérir les diverses parties du royaume.
Il n’y avoit rien de réel dans ces conjectures; les Parisiens ne devoient être délivrés des brigands que lorsqu’ils auroient pris les armes, et la famine qui les menaçoit ne devoit cesser que lorsqu’ils auroient emmené le roi dans leurs murs. C’étoit là le but où l’on vouloit les conduire, et ils y sont arrivés sans soupçonner qu’on les y entraînoit.
Les Marseillois furent les premiers qui l’atteignirent; on a vu que lorsque M. de Mirabeau quitta la Provence, plusieurs jeunes bourgeois de Marseille avoient pris les armes, et depuis ce moment la province avoit été tranquille. Ce n’étoit point assez pour l’exécution des desseins qu’on avoit en vue, et il falloit que la prise d’armes fût générale à Marseille. On la remplit, comme toutes les autres villes du royaume, de brigands. On y en comptoit à la fin d’avril six à sept mille, qu’on disoit étrangers, Espagnols, Gênois, Napolitains. Ils murmuroient beaucoup de la cherté du pain, et disoient hautement que si on ne le diminuoit pas, il faudroit bien qu’ils se missent à voler; on crut, ou du moins on feignit de croire, qu’ils avoieut l’intention de piller quelques magasins, et notamment celui du Lazaret où, comme l’on sait, sont déposées toutes les marchandises qui viennent du levant, jusqu’à ce qu’elles aient subi l’épreuve de la quarantaine. Le transport de ces marchandises dans l’intérieur de la ville auroit pu y mettre la peste, et comme si ce n’eut pas été assez de l’appréhension de ce fléau, on y joignoit celle du feu; car on prétendoit avoir la preuve que l’intention de tous ces vagabonds étoit d’incendier les quatre coins de la ville.
Menacés donc tout-à-la-fois du pillage, du feu, de la peste, les Marseillois ne virent pas d’autre moyen pour se préserver de ces calamités, que de repousser loin de leur ville les malheureux qui leur faisoient craindre ce triple fléau; il n’y avoit pas d’autre moyen d’en purger Marseille, que de les obliger à la fuite par la force des armes. Tous les bourgeois devinrent donc soldats, et donnèrent en effet la chasse à ces incommodes étrangers; mais la ville ne fut pas pour cela plus tranquille. Jamais au contraire elle n’avoit été plus agitée qu’elle le fut après la retraite de ces vagabonds.
Le peuple avoit pris, comme par-tout ailleurs, de la haine contre les agens de l’autorité; il en proscrivit les têtes, et voulut que le glaive de la justice les fît tomber. Le parlement qui ne vit point de coupable parmi ceux qu’on lui désignoit, ne voulut faire pendre personne; mais des factieux de Marseille ayant, pour condescendre aux desirs de la multitude, condamné par un jugement illégal ces mêmes agens à la mort, le parlement crut alors devoir reprimer ces atrocités. Il condamna trois des juges à être pendus eux-mêmes. Les potences furent dressées. La vue des gibets mit en fureur le peuple; mais ce peuple n’étoit pas le peuple marseillois, il n’étoit composé que de cette canaille italienne et espagnole dont la ville avoit été purgée, et s’étoit de nouveau remplie.
Dans de telles conjonctures, le parlement et l’intendant qui étoit en même tems premier président de cette compagnie, crurent qu’il étoit instant de réveiller la vigilance de la cour, et de fixer toute sa sollicitude sur les suites que pouvoient avoir ces nouveaux troubles. Ils lui firent donc passer une relation de ces désordres; elle étoit véritablement allarmante; les magistrats n’y dissimuloient pas que non seulement on ne respectoit plus à Marseille aucune autorité légitime, mais qu’on seroit tenté de croire que cette ville avoit réellement l’intention de se séparer de l’empire françois, et de s’ériger en république.
Ce n’étoit là qu’une terreur panique; car quelque avantageusement située que soit Marseille, quelle que soit l’opinion qu’elle ait de ses ressources, son intérêt et la constitution politique lui font un besoin de la protection du royaume dont elle fait partie.
On fut effrayé à la cour de ces désordres. Le roi envoya sur les lieux une proclamation sévère qui fut affichée dans toutes les rues. Sa Majesté y disoit qu’instruite par son parlement et par l’intendant de la province, qu’une multitude de brigands rnenaçoit les propriétés, et se portoit aux plus grands excès, son intention et ses ordres étoient qu’on sévît contre eux avec rigueur, et que sans les formalités ordinaires de justice, on punît sur-le-champ du dernier supplice ceux qui seroient surpris en flagrant délit.
Cette proclamation causa la plus grande rumeur: les Marseillois crioient qu’ils avoient été calomniés auprès du roi par le parlement et par l’intendant, que ce corps, ce magistrat, tous les agens de l’autorité, tous les possédans-fiefs, étoient des ennemis dont il falloit débarrasser la province, que tant qu’ils y resteroient, Marseille ne seroit point libre, et n’auroit point une constitution.
De ces plaintes, on en vint bientôt aux voies de fait, et cette fois-ci la prise d’armes fut générale. Environ20,000jeunes bourgeois présentèrent tout-à-coup le spectacle d’une armée formidable. Ils s’emparèrent des canons des bâtimens qui se trouvoient dans le port; ils en pointèrent à toutes les portes de la ville, et firent garder chaque pièce par un nombreux détachement. Ils prenoient cette précaution pour se mettre en garde contre toute surprise de la part des troupes du roi qui pourroient arriver du dehors,
La garnison du fort Saint-Nicolas n’osoit bouger; elle voyoit sous ses murs cette florissante jeunesse faire toutes les évolutions militaires, l’exercice du canon, du fusil, marcher en ordre de bataille, feindre de petits combats.
La chambre du commerce et le corps-de-ville, ne sachant comment se termineroit cette effervescence, prirent un arrêté qu’ils envoyèrent à la cour par deux députés. Ils y supplioient. le roi de croire que les Marseillois avoient été calomniés, qu’ils étoient et seroient toujours ses plus fidèles sujets; mais qu’ils ne pardonneroient jamais à ceux qui leur avoient fait perdre les bonnes graces de sa majesté, et qu’ils se jettoient à ses pieds pour lui demander de retirer sa proclamation, et de casser le parlement; enfin ils disoient dans cette requête, qu’il y avoit tout à craindre, si le roi ne se rendoit pas à leurs désirs, parce que les jeunes bourgeois feroient tous leurs efforts pour s’opposer à ce que les régimens qu’on pourroit envoyer contr’eux, entrassent dans la ville, cette bouillante jeunesse préférant la mort à l’esclavage.
Cette demande de la cassation du parlement et du renvoi de M. Galloy de la Tour, son premier président, contraste un peu avec ce que le journaliste de Paris racontoit à la même époque des troubles de Marseille. Il écrivoit que le peuple de cette ville portoit jusqu’à l’idolâtrie sa reconnoissance pour le parlement, mais plus particulièrement pour M. Galloy de la Tour, au point qu’on lui avoit donné les fêtes les plus flatteuses, et qu’on avoit fait frapper en son honneur des médailles.
Dans l’ancien, comme dans le nouveau régime. il y a toujours eu un grand choix à faire parmi les journaux: et ceux qui voudront écrire l’histoire du dix-huitième siécle, ne doivent recueillir qu’avec beaucoup de circonspection, leurs matériaux dans les feuilles périodiques. Il est vrai cependant que la haine qu’on portoit en Provence au parlement et à l’ intendant, n’étoit pas universelle; mais ceux qui rendoient justice à leurs principes et à leur conduite, et qui eussent frappé des médailles pour éterniser la reconnoissance qui leur étoit due, composoient-le plus petit nombre.
Je ne veux flagorner personne, mais je dois mettre la postérité à même de rendre justice. La vérité veut donc que je dise que l’on ne dut la cessation de ces troubles, qui certainement étoient bien sérieux, qu’au parlement lui-même. Ceux qui les avoient excités ne durent également la vie qu’aux magistrats qu’ils calomnioient avec tant d’opiniâtreté.
Je sais bien que dans le tems on accrédita beaucoup l’opinion contraire; on prétendit que l’arrêté des négocians et des officiers municipaux, avoit jetté la cour dans l’indignation contre les magistrats dont cet arrêté contredisoit la relation. On dit que le roi témoigna, en termes énergiques, son mécontentement aux commissaires du parlement. Mais un fait qui ne peut pas être révoqué en doute, c’est que ce fut à la prière et aux instances de cette compagnie, que sa majesté accorda l’amnistie qui rétablit la paix à Marseille.
J’ai imprimé dans mon journal No. CLV, du mardi 2novembre1790, page631, une lettre qui indique les noms de quelques-uns de ceux à qui cette amnistie fit grâce de la vie. Cette lettre atteste que le pardon ne fut accordé qu’à l’intercession du parlement. La feuille où elle se trouve imprimée a été envoyée aux personnes mêmes qui y sont nommés, et qui depuis la révolution sont très-considérées parmi ceux qu’on appelle patriotes. Aucune d’elles n’a réclamé ni sur ce qui leur est personnel, ni sur ce qui concerne le parlement. Je regarde donc leur silence comme une nouvelle preuve de la générosité avec laquelle cette compagnie se conduisit dans d’aussi fâcheuses circonstances.
L’effet qu’elle produisit, en désarmant la juste sévérité du roi, fut d’autant plus heureux pour la province, que les troupes envoyées ensuite par sa majesté, et destinées à raffermir le bon ordre, trouvèrent les esprits beaucoup moins aigris, et il n’y eut, comme on l’avoit craint, aucun choc entre elles et les bourgeois; mais ceux-ci n’en restèrent pas moins sur la défensive, et depuis ils n’ont plus quitté les armes.
Les Parisiens, qui ne comprenoient rien à tout ce qu’on leur racontoit de la position actuelle de Marseille, vouloient abidument que cette ville fût dans la ferme résolution de s’ériger en république. Mais les menées qui se faisoient en Provence avoient lieu en même teins dans tout le royaume et dans la capitale. Les Marseillois, comme les Parisiens, étoient égarés et entraînés, et ceux-ci de voient un jour arriver an même point que les premiers. Toutes les sortes de moyens étoient mis en oeuvre pour hâter leur marche. Le marquis de Saint-Huruge leur crioit dans les cafés du palais-royal, que leur perte étoit assurée, qu’il tenoit le premier anneau de la chaîne qui alloit les réduire en esclavage, qu’il connoissoit la cause du désastre qui avoit fait couler le sang dans le fauxbourg Saint-Antoine; qu’il avoit acquis des preuves plus claires que le jour, que M. l’abbé Roy avoit été soudoyé par les triumvirs pour exciter l’émeute; il ajoutoit que ces preuves étoient si évidentes, qu’il alloit dénoncer cet ecclésiastique aux tribunaux.
Cette dénonciation eut lieu en effet, et, comme on pense bien, n’a jamais été suivie.
Les orateurs du palais-royal ne s’en tenoient pas à manifester ces alarmantes conjectures; ils ne cessoient de répéter que la cour avoit pris de telles mesures, qu’en moins de vingt-quatre heures, Paris pouvoit voir dans ses murs une armée de vingt-cinq mille hommes. Cette allégation n’étoit pas sans fondement. La garde de Paris étoit même déja augmentée des régimens Royal-Cravatte, et Bourgogne, cavalerie. On avoit de plus caserné400suisses dans le couvent des Capucins de la rue Saint-Honoré. La cour, après les excès qui venoient d’être commis, et instruite des discours séditieux dont les lieux publics retentissoient à toute heure du jour, devoit à la tranquillité même des habitans de la capitale, les précautions qu’elle prenoit pour assurer leurs propriétés, et ces précautions étoient d’autant plus nécessaires, que les manoeuvres qui se continuoient sur les grains faisoient craindre une insurrection générale.
Il se passa vers les premiers jours de mai, un événement que je dois raconter, parce qu’il a avec cette manoeuvre des grains, des rapports qui méritent d’être approfondis. Un homme nommé Lequeue, qu’on dit valet des petites écuries du roi, qui du moins avoit la livrée de sa majesté, se présenta à la caisse d’escompte avec un bon pour toucher50mille écus. Le bon étoit signé de M. Necker et de son secrétaire; on ne fit aucune difficulté de le payer.
Lorsque ce bon fut ensuite mis sous les yeux de M. Mecker, ce ministre l’examina, dit que la signature, quoique parfaitement bien imitée, n’étoit point la sienne, et que celle de son secrétaire étoit également contrefaite; il ajouta qu’il n’avoit aucun besoin de recourir à la caisse d’escompte; parce que le trésor royal avoit des fonds suffisans.
Jusques-là l’aventure n’offre rien de bien singulier; la hardiesse d’un filou qui contrefait la signature d’un ministre, pour voler une somme, n’est pas sans exemple; et pour prouver que les noms apposés au bas du bon présenté à la caisse d’escompte, étoient en effet l’ouvrage d’un faussaire, il suffit sans doute du témoignage de M. Necker.
Mais au moment où cette aventure éclate, il serépend dans tout Paris, que des fermiers, des marchands de grains, des meuniers, des boulangers, des marchands même de boeufs, ont reçu ordre de discontinuer les approvisionnemens pour Paris, depuis le 20avril, jusqu’au15mai, et que cet ordre est signé de M. Necker. Ce ministre convient lui-même du fait; il dit que plusieurs de ces lettres circulaires lui sont revenues, et qu’il a reconnu que la signature étoit fausse. Aussitôt tous les soupçons tombent sur le faussaire qui a présenté le bon de30 mille écus à la caisse d’escompte, et il n’est personne qui ne publie que c’est lui qui a supposé tous ces ordres.,
Ce fait, et sur-tout cet espace de tems du20 avril au15mai, suggérent bien des réflexions. D’abord, il prouve inconstestablement qu’il y avoit un complot pour affamer la capitale, au moment même où s’ouvriroient les états-généraux. Qui avoit conçu cet homicide projet? En donnera-t-on l’invention au gouvernement? Mais le gouvernement avoit-il intérêt d’accroître la fermentation déjà si grande? N’avoit-il pas déjà assez d’embarras? Se faisoit-il donc un jeu de s’exposer à toutes les suites qu’auroit nécessairement l’exécution d’un tel complot? Qu’eût-il gagné à soulever tous les habitans de la capitale? Il faisoit venir, il est vrai, des soldats; mais ces soldats ne donnoient pas du pain. Et que peut une armée contre le désespoir engendré par la famine.
N’est-il pas aussi un peu étrange que M. Necker connoissant les fourberies qui se pratiquoient sous son nom, en ait montré si peu d’inquiétude? Quelie indifférence sur ce qui pouvoit produire les plus grands désordres! Il se tait sur toutes ces lettres circulaires, et n’en parle qu’à l’instant où un homme se présente à propos pour être dénoncé au public comme l’auteur de tous ces faux. Les sollicitudes de M. Necker ne vont pas plus loin: il ne fait aucune recherche sur ces écrits, sur ceux qui les reçoivent, sur la manière dont ils leur parvenoient; il n’éveille point le zèle des tribunaux. Le seu coupable désigné échappe lui-même à la vigilance d’une administration qui avoit tant de moyens, pour s’assurer des criminels d’état; et depuis ce jour, il n’en est plus question.
Il faut convenir que ce sont là des singularités qu’un historien plus présompteux que moi, entreprendroit peut-être d’expliquer.
Voilà au surplus la première circonstance où je trouve le nom de M. Necker mêlé aux ténébreuses opérations qu’on n’a cessé de faire sur les grains jusqu’au6octobre suivant. Je remarquerai avec soin toutes les autres occasions semblables qui se présenteront dans la suite.
Premier. On étoit trop préoccupé à Paris, pour s’arrêter à des conjectures sur un tel événement. Tout ce qui n’avoit pas un rapport immédiat avec les états-généraux, n’affectoit qu’un instant. Les commissaires nommés par les électeurs pour la rédaction des cahiers, employèrent à ce travail toute la journée du premier mai, depuis huit heures du matin jusqu’à dix heures du soir, et toute celle du deux, depuis huit heures du matin jusqu’à minuit.
2. On sut aussi le2, que tous les députés qui s’étoient réunis à Versailles, furent présentés au roi. La cérémonie eut lieu pour le clergé à onze heures du matin, pour la noblesse à une heure après midi, et pour le tiers-état à quatre heures.
Il s’éleva une légère difficulté sur la préséance entre les ducs et pairs, et les gentilshommes des provinces. Les premiers vouloieut être présentés à la tète de la noblesse; le roi décida qu’il n’y auroit aucune distinction, et que la présentation se feroit par ordre de bailliage.
Le tiers-état avoit été rassemblé dans le sallon d’Hercule; il traversa tous les appartemens, une partie de la galerie, et fut introduit par la porte des glaces dans le grand cabinet du roi. Sa Majesté, pendant tout le tems de la présentation, resta debout; elle avoit a coté d’elle les princes du sang et le garde des sceaux.
Il ny avoit dans cette cérémonie rien d’humiliant pour le troisième ordre; on en murmura cependant beaucoup; on auroit voulu que la présentation fut aite simplement par bailliages et sans distinction dordres. Le nom même de tiers-état commencoit à déplaire à ceux qui en étoient membres, et tout ce qui tendoit à le placer sur une autre ligne que les deux premiers ordres, étoit vu avec dépit. M. le marquis de Breze, grand maître des cérémonies, avant voulu, comme le lui ordonnoit le devoir de sa charge, indiquer le costume que dévoient avoir les membres ces trois ordres, se servit pour cela de la voie du journal ce Paris. Jamais écrit n’avoit produit une plus grande fermentation que la feuille où se trouva cette description qui rappelloit les antiques usages de la monarchie, et qui devenoit précieuse sous ce seul rapport.
Toutes les folies qui se débitoient à ce sujet, paroîtront un jour incroyables. Le roi, disoit-on, manque à sa parole; il avoit promis des états-généraux, et c’est une cour plénière que vont former les députés. Il n’y aura point de liberté dans leur assemblée, si on admet une telle distinction. Tous ces costumes sont des livrées d’esclaves; ce sont des enseignes de partis. Il ne s’agit point ici de modes, mais du sort de l’empire. Il est indigne du gouvernement de s’occuper de la couleur et un manteau, de la forme d’une cravate, d’une mousseline, d’un point de venise. De quel droit un maître des cérémonies vient-il dicter des loix aux législateurs de la nation, et veut-il les obliger à obéir à l’étiquette de la frivolité?
Ces extravagances furent répétées dans tous les pamphlets du jour et échauffèrent toutes les têtes, au point qu’on en vint à regarder M. le marquis de Brezé comme un dangereux ennemi de la nation.
Un député breton, plus affecté que les autres de porter un habit noir, une cravate, un petit manteau, un chapeau rabattu, courut chez M. Necker, qui accueilloit toujours bien les députés du tiers-état.– Monsieur, lui dit ce député, est-ce que je serai forcé de suivre cette humiliante étiquette?–Monsieur, lui répondit le ministre, je ne crois pas qu’on puisse forcer ni vous, ni personne.–A la bonne heure, répliqua le député, et quoiqu’il arrive, je déclare que je n’obéirai point à l’étiquette; je paroîtrai aux états-généraux avec l’habit que je porte aujourd’hui; c’est mon habit de cérémonie, mon habit des dimanches.» Cet habit étoit verd, et garni de ces boutons ronds que portent les hussards. M. Necker acheva de tranquilliser ce député, en l’assurant que l’habit ne feroit rien du tout aux états-généraux, et que les lumières, l’honneur et le patriotisme y feroient tout.
La dépense nécessaire pour l’achat du costume pouvoit contribuer aussi au mécontentement de quelques membres du tiers-état, et en général ils se plaignoient beaucoup des frais que leur occasionneroit le séjour de Versailles. Si le roi eut voulu condescendre au désir du plus grand nombre, les états se seroient tenus à Paris. Ce voeu, qui étoit fort du goût des habitans de la capitale, prit même une telle fureur, qu’on crut pendant quelques jours qu’il seroit présenté au roi. S’il se fut réalisé, la révolution eût été peut-être accélérée, par la facilité qu’auroient eu ceux qui l’ont opérée, de mouvoir la multitude. Pendant tout le tems où les états-généraux ont tenu leurs séances à Versailles, les mouvemens n’ont été communiqués a la capitale, que lentement, et toujours avec une certaine difficulté. Ce sont ces lenteurs et ces difficultes qui ont principalement déterminé les factieux à traîner l’assemblée nationale à Paris.
3. La noblesse ne paroissoit pas s’agiter autant que le tiers-état. Celle de Paris envoya, à l’exemple du clergé, une députation aux électeurs du tiers-état. Elle étoit composée de huit gentilshommes. M. le duc de Liancourt qui porta la parole, assura les électeurs que la noblesse avoit des sentimens de fraternité pour ses concitoyens du tiers-état, et le plus grand desir que ces sentimens de concorde et d’union animassent aux états-généraux tous les représentans de la nation; il déposa ensuite sur le bureau l’arrêté de la noblesse conçu en ces termes.
«L’assemblée générale des électeurs représentans tous les citoyens nobles de la ville de Paris, voulant donner à ses concitoyens des deux autres ordres, une preuve de son affection et des principes de justice et dunion dont elle est animée, se fait un devoir de leur déclarer qu’elle a arrêté de protester en corps contre sa dispersion de la commune; que pour suppléer, autant qu’il est en elle, à cette réunion absolue de voeux et de travaux devenue impossible, elle a autorisé ses commissaires à donner respectivement à chaque ordre toutes les communications qui leur seroient offertes; qu’enfin elle a arrêté de faire porter aux états-généraux par ses députés, son vœu unanime pour la suppression des impôts distinctifs, et leur conversion en subsides communs, répartis également, proportionnellement, et dans la même forme, entre les citoyens de tous les ordres et de toutes les classes
La députation retirée, les commissaires chargés de la rédaction des cahiers, annoncèrent que leur travail étoit fixé; ils y avoient employé trois jours, et il est merveilleux qu’en aussi peu de tems ils eussent fini un ouvrage qui traitoit de toutes les branches d’administration, et auquel on attachoit la plus grande importance,
D’après cette agréable nouvelle, il fut décidé qu’on feroit une première lecture des cahiers qui seroit entendue avec patience, et sans être interrompue; et qu’on en feroit ensuite une seconde sur laquelle il seroit libre à chacun de faire ses observations,
Cette première lecture prolongea jusqu’à dix heures du soir la séance, qui n’offre rien de plus important.
4. Le lendemain il n’y avoit plus personne à Paris. Dès le grand matin, on s’étoit empressé de se rendre à Versailles pour y voir la cérémonie de l’ouverture des états-généraux. La route de la Capitale à la cour étoit couverte de piétons, de cavaliers, de voitures; jamais on n’avoit vu une telle affluence, et à moins d’en avoir été témoin, il est difficile de s’en faire une idée.
Les Parisiens sont naturellement curieux et avides de nouveautés, mais dans cette occasion leur empressement étoit pardonnable; ils alloient jouir d’un spectacle qu’aucun homme de la génération actuelle n’avoit vu, d’un spectacle le plus magnifique, le plus imposant qui pût jamais se montrer aux yeux d’un François.
Les trois ordres s’étoient assemblés à Versailles dans l’église Notre-Dame; le clergé ne se rendit pas dans l’église même; il se réunit dans la salle de la Mission, qui est contiguë; la noblesse remplissent le bas côté de l’église, et avoit la droite; le tiers-état étoit dans le bas côté à gauche.
Vers les dix heures, le roi arriva précédé de toute sa cour, de la cour la plus brillante, la plus majestueuse de toute l’Europe; il avoit à ses côtés la reine qui par sa beauté, ses graces, ajoutoit de l’éclat à cette fête. Le roi alla se placer dans le bas du coeur à droite, et la reine à gauche. Dès que leurs majestés eurent pris place, on chanta le Veni creator.
La prière finie le tiers état se mit en marche; il suivit le bas côté, passa derrière l’autel, vint traverser le choeur, et défila ainsi sous les yeux du roi et de la reine. Le roi étoit de bout, et rendoit à chaque député son salut; la reine étoit assise et faisoit également une profonde inclination a chaque député. Elle mettoit un tel charme, une telle sensibilité dans son salut, qu’elle eût adouci la férocité même des tigres. Infortunés princes! vos coeurs s’ennivroient dans ces beaux momens d’un espoir mensonger. Quel terrible réveil vous attendoit!
Le tiers-état avoit défilé sans distinction de bailliage; ses députés n’avoient pas voulu répondre à l’appel; il fut suivi de la noblesse qui elle-même fut suivie du clergé. Le Saint-Sacrement venoit ensuite; il étoit porté par M. l’archevêque de Paris. Monsieur, M. le comte d’Artois, MM. les ducs d’Angoulême et de Berry, portoient les cordons du dais. Le roi, la reine et toute la cour suivoient immédiatement.
Les personnes qui ont été témoins de cette pompeuse et majestueuse solemnité ne l’oublieront de leur vie, Les rues, les balcons, les fenêtres, les toits même étoient couverts de spectateurs. On eût dit que Versailles avoit été ce jour-là le rendez-vous de la France entière. Dès que le tiers-état se présentoit aux yeux des spectateurs, l’air retentissoit du bruit des applaudissemens, et toutes les bouches crioient vive le tiers-état. On cherchoit sur-tout à démêler dans cet ordre M. le comte de Mirabeau sure compte duquel l’opinion publique n’étoit pas encore bien fixée. Il avoit le costume du ti rs; son habit non étoit relevé par des brandebourgs en jay; son teint étoit pâle et livide; il marchoit avec une sorte ce nonchalence; ses yeux ternes, son front couverte rides, ses regards mal assûrés lui donnoient un air sombre et sévère. Un plaisant en l’appercevant, et Comme frappé de l’éclat de ses brandebourgs, s’écria: Eh mon dieu! cet homme est tout en jay. Cette plaisanterie fit sourire, parce qu’elle faisoit allusion à l’intimité de M. de Mirabeau avec une personne dont le nom est Legeay.
Dès que la noblesse paroissoit, les applaudissemens et les cris de joie cessoient; mais à la vue de M. le duc d’Orléans qui s’étoit confondu parmi les gentilshommes, comme député du bailliage de Villers-Cotterets, on battoit des mains, on lui prodiguoit les bénédictions, on ne cessoit de crier vive M. le duc d’Orléans.
Le silence recommençoit à la vue du clergé; ce silence étoit profond, et ce passage subit des acclamations les plus bruyantes à un recueillement universel inspiroit une sorte de consternation. M. le cardinal de la Rocbefoucault suivoit immédiatement son ordre; ni son grand âge, ni ses dignités, ni ses vertus n’obtinrent le plus léger applaudissement.
La présence du roi mettoit fin au silence; dès que cet excellent prince, le plus aimant, le plus sensible des hommes de son royaume, paroissoit, tous les coeurs alloient au-devant de lui, toutes les mains étoient en mouvement, tous les chapeaux en l’air, et toutes les voix se réunissoient pour crier, vive le roi. C’etoit une véritable ivresse. Et qui mérita jamais mieux d’ennivrer d’amour tous ses sujets, que Louis XVI? Il se montra extrêmement touché de tous ces témoignages; ses yeux s’humectoient de larmes; il rendoit à chacun son salut, et mettoit dans ces démonstrations d’intérêt encore plus d’affabilité, lorsqu’il s’adressoit à une personne du sexe. Quel moment pour ce bon roi! Pouvoit-il prévoir que deux mois après il seroit contraint de venir dans sa capitale, autoriser par sa présence la plus étonnante des insurrections, et que cent mille piques se croiseroient sur sa tête?
Hélas! même dans ce jour, dans ce beau jour de fête, Louis XVI ne fut pas plus heureux. On lui produigoit avec frenésie des marques d’attachement et de reconnoissance; mais on outrageoit, par un injuste et sacrilège silence, son auguste et vertueuse compagne. Que son front cependant, que tout son maintien étoient nobles et touchans! Ses yeux se fixoient avec intérêt sur la multitude, et sembloient appeler la vénération et la gratitude, mais la calomnie avoit glacé toutes les ames; pendant toute la duree de cette cérémonie le monstre enfonça tous ses poignards dans le coeur de la reine, et cette journée dut paroître encore plus cruelle à cette infortunée princesse, que celle du6octobre.
Les applaudissemens finirent à madame la duchesse d’Orléans ; ils étoient dûs sans doute à sa bienfaisance, à sa tendre compassion pour les malheureux, à son inaltérable douceur, à toutes ces qualités enfin qui, dans le premier rang, après celui de souveraine, la rendent le modèle des épouses et des mères; mais ce n’étoit pas à ses vertus qu’on accordoit cet hommage; elle le devoit aux sentimens qu’inspiroit la popularité du prince son époux.
Ce fut dans cet appareil, au milieu de ce peuple immense qui se livra sans détour aux différens mouvemens qu’on lui avoit inspirés, et qui l’agitoient, que les députés se rendirent dans l’église Saint-Louis, où la messe fut célebrée avec la plus grande pompe. M. de la Farre, évêque de Nancy, prononça un discours qui fit beaucoup de bruit dans le tems et qui est aujourd’hui oublié. M. de Mirabeau critiqua ce discours, parce qu’il contenoit un éloge mérité des intentions et des qualités de la reine; mais ce n’étoit pas par un tel éloge que ce discours prêtoit à la censure, parce qu’on ne doit pas en être frappé quand on est juste.
Il y avoit un reproche plus grave à faire à M. de la Farre; il auroit du dans la chaire de la religion se renfermer dans l’exercice de son ministère, exhorter les députés à l’union et au respect pour les vérités les plus saintes; il auroit dû en un mot faire un discours chrétien; le lieu, la circonstance, la célébration des saints mystères, tout le demandoit, et il eût fait sagement de réserver pour la tribune des états-généraux, les discussions politiques.
Mais M. l’évêque de Nancy se laissa séduire par le désir si naturel de montrer de grandes vues dans une grande occasion. Il n’eut dû parler qu’en orateur chrétien, et il voulut parler en législateur, Il se répandit en invectives contre le despotisme, le luxe des cours, la prodigalité des princes, les déprédations des ministres. Il exagéra le mal au lieu de l’adoucir; et un ministre de paix, bien loin d’ajouter à l’effervescence populaire, bien loin de la justifier, devoit au contraire la modérer, et ne pas imiter nos novateurs, qui, pour nous porter à détruire l’arbre, ont voulu nous persuader que toutes ses branches, que son tronc même, ne recevoient plus qu’une sève empoisonnée.
Il est à remarquer au reste que la célébrité dont jouit M. l’évêque de Nancy, est fondée sur d’autres titres que sur ce discours; il a l’esprit cultivé, clair méthodique. S’il a échoué en prêchant nos législateurs dans la chaire de la religion, il leur a fait entendre dans la tribune aux harangues des vérités qui, si elles eussent été accueillies, eussent ramené en France le calme et le bonheur, et nous devons tous de l’estime aux principes, aux lumières, et au courage héroïque de M. de la Farre.
La cérémonie avoit commencé à dix heures du matin, et le discours de M. l’évêque de Nancy la prolongea jusqu’à quatre heures après midi. Le roi fut accompagné au château et jusques clans ses appartemens, par la foule qui se pressoit sur ses pas, et qui répétait les cris de vive le roi, dont elle avoit fait retentir l’air pendant la procession. Le nom de la reine fut mêlé dans ces nouvelles acclamations; le spectacle de patience, d’affabilité qu’elle avoit donné dans tout le cours de cette longue cérémonie, desarma un instant l’injustice. Aux cris vive le roi, on ajouta ceux vive la reine.
De retour à Paris, les curieux firent une telle relation de tout ce qu’ils avoient vu à Versailles, qu’elle accrut considérablement l’impatience de ceux qui ambitionnaient d’être députés du tiers-état de la capitale, d’aller se réunir aux autres députes. Il s’en falloit de beaucoup que la rédaction des cahiers fut terminée; on n’avoit irrévocablement arrêté que le premier article qui traite de la constitution. M. Target à qui ce mot donnoit un pressentiment ne la part qu’il devoit avoir à l’enfantement de celle de tout le royaume, brûloit de commencer le grand oeuvre. Il regrettoit que ses fonctions le tinssent aussi longtems parmi les électeurs. Il leur représenta qu’on etoit au4mai, et qu’en procédant tout de suite à l’élection des députés, ils ne pourroient encore être tous rendus à Versailles que le11mai. Il voulut donc les engager à y procéder sur-le-champ, à leur donner ce premier article pour pouvoir, et à continuer cependant l’assemblée pour travailler à la confection des autres cahiers, pour les corriger, les perfectionner à loisir, et les envoyer ensuite aux députés comme instruction.
On repoussa ces instances qui avoient déjà été présentées une fois sans succès, et il fut décidé que la lecture, la vérification des cahiers seroit continuée et achevée avant de passer à la nomination des députés.
5. Il ne se trouva donc aucun représentant de la capitale dans la première séance des états-généraux. Quel avenir! Quel nouvel ordre de choses va se présenter à nous! Quelle époque pour nos fastes, que celle du5mai1789! Epoque que Louis XIV redoutoit, dont le duc-régent ne voulut pas, à laquelle Louis XV ne songea jamais, et que Louis XVI ramenoit après175ans d’interruption.
Cette séance, sur laquelle la postérité fixera ses regards avec tant d’intérêt, et que nous-mêmes qui en avons été témoins, raconterons avec complaisance à la génération qui commence, se tint à Versailles dans la salle qu’on appelloit des Menus, et qu’on avoit indiquée pour être la salle des trois ordres. On la rencontroit en venant de Paris, sur l’avenue à gauche, vis-à-vis les écuries de Monsieur. Beaucoup plus vaste que le manège, elle offroit un emplacement commode, et pouvoit, outre les représentans de la nation, contenir un grand nombre de spectateurs. De nombreuses issues en rendoient l’accès facile. Percée de plusieurs croisées sur toutes ses faces. et d’ouvertures avtistement pratiquées dans le platfond, l’air y circuloit librement, et étoit suffisamment rafraîchi dans les jours les plus chauds de l’été. Du côté de l’avenue, une vaste cour conduisoit au vestibule qui servoit d’entrée à la salle. Ou pouvoit à l’extérieur en parcourir les trois autres faces, par de larges rues que n’obstruoient jamais les voitures.
Les députés, dans cette première séance, furent introduits par l’avenue de Paris. On les faisoit attendre dans la cour; ils étoient appelles par bailliages, et c’est dans cet ordre qu’ils entroient. Arrivés à la porte de la salle, ils trouvaient M. le marquis de Brezé qui les plaçoit lui-même. Cette matinée fut extrêmement fatigante pour M. le grand-maître qui trouvoit beaucoup de peine à faire placer comme il l’entendoit, les députés du tiers-état. Les uns ne vouloient pas de cet appel par bailliages; d’autres suivoient le maître des cérémonies, mais lui faisoient des protestations verbales contre cette forme d’appel. Ceux-là disoient que leur tour avoit été avance; ceux-ci se plaignoient qu’il eût été reculé.
Le tour du bailliage de Villers-Cotterets étant arrivé, un curé à portion-congrue, et M. le duc d’Orléans se présentent ensemble a la porte de la salle. Le curé oublie dans cet instant que représentant le premier ordre de son bailliage, il doit avoir le pas; il recule et veut laisser passer le prince, mais M. le-duc d’Orléans se souvient qu’il n’est plus qu’un simple gentilhomme, qu’un membre du second ordre, et il ne paroît dans l’assemblée qu’à la suite de l’ecclésiastique.
Dès que l’on apperçut dans la salle M. le duc d’Orléans, des cris de vive M. le duc d’Orléans, se firent entendre, et se prolongèrent pendant un quart-d’heure.
Enfin, chacun étant placé suivant les desirs de M. de Brezé, le cierge à la droite du trône, la noblesse à gauche, et le tiers-état en face, le roi arriva environné de toute sa cour, et la reine marchant à côté de lui. Sa majesté monta sur son trône, et la reine vint prendre place à sa gauche dans un fauteuil qui étoit placé une marche plus bas que le trône. Les princes, les pairs et les grands qui n’etoient point députés, se rangèrent a la droite et à la gauche du roi, sur le premier gradin au-dessous du trône.
Dès que le roi fut assis, il fit approcher M. le duc d’Orléans, et lui demanda pourquoi il n’étoit point auprès de sa personne; il semble qu’ eu effet, dans une telle circonstance, le premier prince du sang ne pouvoit point abandonner le roi. M. le duc d’Orléans répondit que sa naissance lui donnoit toujours le droit de se rendre auprès de sa majesté, mais qu’il croyoit devoir, dans ce moment, se placer au rang de son bailliage.
Il devoir pourtant paroître assez indifférent aux commettans de M. le duc d’Orléans, qu’il se confondit dans la foule, ou qu’il vînt se mettre à la tête des princes du sang. Les cahiers ne lui avoient pas marqué sa place clans cette cérémonie, et ses pouvoirs ne lui avoient pas commandé cette sorte de scission; mais elle lui donna un air de popularité qui n’ajouta pas peu à la faveur qu’il s’étoit acquise auprès des apôtres de l’égalité.
Le roi au reste n’insista pas; il laissa M. le duc d’Orléans reprendre son rang dans son bailliage; il n’ajouta à sa demande aucun reproche, quoiqu’on ait dit, dans le public, qu’il avoit témoigné beaucoup de mécontentement à ce prince. Ou vouloit que ces reproches eussent été suggérés au roi par les autres princes, qu’on prétendoit mortifiés de n’être pas aussi députés. Je relève ce mensonge, parce qu’il se trouve consigné dans tous les journaux du tems. Ceux qui se le permirent ne voulurent pas faire attention que les princes ne pouvoient pas être mortifiés de ne pas jouir d’une faveur qu’il leur eut été si aisé d’obtenir. Tout le monde sait que M. le comte d’Artois, entrautres, ayant été nommé député par la noblesse du duché d’Albert, et étant vivement sollicité de la représenter, refusa de se rendre à son désir, par une lettre dans laquelle il témoignoit combien il étoit flatté do cette marque de confiance, et combien il regrettoit de ne pouvoir l’accepter.
M. le duc d’Orléans revenu à sa place, le roi se leva; à son exemple la reine et toute l’assemblée se lévèrent. Le silence le plus profond règna dans la salle. Chacun se recueilloit, et ne vouloit perdre aucune des paroles qui alloient sortir de la bouche du roi. Debout et découvert, il prononça d’une voix ferme, claire, sonore, et avec beaucoup d’intelligence, ce discours, que des personnes à portée d’être très-instruites, m’ont assuré qu’il avoit composé lui-même.
«Messieurs, ce jour que mon cœur attendoit depuis long-tems, est enfin arrivé, et je me vois entouré des représentans de la nation, à laquelle je me fais gloire de commander».
«Un long intervalle s’étoit écoulé depuis les dernières tenues des états-généraux, et quoique la convocation de ces assemblées parût être tombée en désuétude, je n’ai pas balancé à rétablir un usage dont le royaume peut tirer une nouvelle forme, et qui peut fournir à la nation une nouvelle source de bonheur «.
«Ladette de l’état, déja immense à mon avénément au trône, s’est encore accrue sous mon règne; une guerre dispendieuse, mais honorable, en a été la cause; l’augmentation des impôts en a été la suite nécessaire, et a rendu plus sensible leur inégale répartition».
«Une inquiétude générale, un desir exagéré d’innovations, se sont emparés des esprits, et finiroient par égarer totalement les opinions, si on ne se hâtoit de les fixer par une réunion d’avis sages et modérés».
«C’est dans cette confiance, Messieurs, que je vous ai assemblés, et je vois avec sensibilité qu’elle a déja été justifiée par les dispositions que les deux premiers ordres ont montrées à renoncer à leurs priviléges pécuniaires. L’espérance que j’ai conçue de voir tous les ordres réunis de sentimens, concourir avec moi au bien général de l’état, ne sera point trompée»
«J’ai déja ordonné dans les dépenses, des retranchemens considérables. Vous me présenterez encore à cet égard des idées que je receverai avec empressement; mais malgré la ressource que peut offrir l’économie la plussévere, je crains, Messieurs, de ne pouvoir pas soulager mes sujets aussi promptement que je le desirerois. Je ferai mettre sous vos yeux la situation exacte des finances; et quand vous l’aurez examinée, je suis assuré d’avance que vous me proposerez les moyens les plus efficaces pour y établir un ordre permanent, et affermir le crédit public. Ce grand, et salutaire ouvrage qui assurera le bonheur du royaume au dedans, et sa considération au dehors, vous occupera essentiellement».
«Les esprits sont dans l’agitation; mais une assemblée des représentans de la nation, n’écoutera sans doute que les conseils de la sagesse et de la prudence. Vous aurez jugé vous-même, Messieurs, qu’on, s’en est écarté dans plusieurs occasions récentes; mais l’esprit dominant de vos délibérations répondra aux véritables sentimens d’une nation généreuse, et dont l’amour pour ses rois a toujours fait le caractère distinctif; j’éloignerai tout autre souvenir».
«Je connois l’autorité et la puissance d’un roi juste au milieu d’un peuple fidèle et attaché de tout tems aux principes de la monarchie: ils ont fait la gloire et l’éclat de la France; je dois en être le soutien, et je le serai constamment».
«Mais tout ce qu’on peut attendre du plus tendre intérêt au bonheur public, tout ce qu’on peut demander à un souverain, le premier ami de ses peuples, vous pouvez, vous devez l’espérer de mes sentimens».
Puisse, Messieurs, un heureux accord régner dans cette assemblée, et cette époque devenir, à jamais mémorable pour le bonheur et la prospérité du royaume! c’est le souhait de mon cœur, c’est le plus ardent de mes voeux; c’est enfin le prix que j’attends de la droiture de mes intentions et de mon amour pour mes peuples».
«Mon garde des sceaux va vous expliquer plus amplement mes intentions; et j’ai ordonné au directeur général des finances, de vous en exposer l’état».
Le roi, en commençant ce discours, avoit invité la reine à s’asseoir; mais cette princesse demanda la permission de rester debout; ce fut dans cette attitude, les yeux baissés, avec l’air du plus profond recueillement qu’elle entendit son auguste époux; on vit même quelques larmes s’échapper de ses yeux; la noblesse de son maintien, la douce majesté répandue sur son front, la modestie de sa contenance, la décence de ses vêtemens, tout cet ensemble fit la plus vive impression sur l’assemblée; on étoit ravi, on étoit ému, toutes les ames étoient pénétrées d’un sentiment tendre et respectuex, et je peux certifier, sans crainte d’être démenti par ceux qui éprouvèrent cette religieuse motion, que dans cette séance, tous les coeurs furent à la reine.
Le discours du roi fut suivi de longs applaudissemens, et il fut aisé de juger qu’ils étoient sincères. Ces témoignages d’amour, la douce reconnoissance répandue sur tous les visages, émurent ce bon prince; il ne put retenir ses larmes; il en répandit à trois reprises différentes. Quel tableau! quel moment! François, il ne reviendra plus ce moment, il est perdu pour toujours. Ah! si vos représentans en eussent profilé pour tomber aux genoux de votre ami, de votre père, pour s’en rapporter aveuglement à lui, sur la décision dé la terrible question de l’opinion par tête ou par ordre, qui alloit tout bouleverser, tout confondre, tout perdre, vous seriez les plus heureux peuples de la terre?
Le bruit s’étoit répandu avant que la séance s’ouvrit, que c’étoit en effet l’ intention des trois ordres, de donner cette juste marque de confiance au roi; mais on se trompoit; cette intention n’a jamais été celle de la majorité du tiers-état.
Le roi ayant fini de parler, et s’étant assis sur son trône, se couvrit, tous les gentilshommes suivirent son exemple, et se couvrirent. Quel coup d’œil que celui qu’offrirent alors tous ces panaches flottans! Mais ce brillant spectacle fallit élever un orage dans le sein de la plus auguste assemblée. Quelques membres du tiers-état voulurent, comme les gentilshommes, se couvrir; on entendit un bruit sourd, au travers duquel on distinguoit confusément, quelques voix qui disoient, couvrez-vous, d’autres au contraire qui disoient, découvrez-vous.
Le roi qui s’apperçut de cette rumeur, eût recours pour la faire cesser, à un moyen qui fait honneur, à sa prudence et à sa présence d’esprit; il feignit d’être incommodé par la chaleur, et ôta son chapeau. C’étoit un ordre à toute l’assemblée, de se découvrir; elle le comprit, et l’orage se dissipa.
M. le garde-des-sceaux prit donc la parole; on étoit encore imbu du discours du roi, on attendoit impatiemment celui du directeur des finances; M. le garde-des-sceaux d’ailleurs, avec un bel organe, avec un extérieur avantageux, ne put vaincre la timidité que lui inspira sans doute la majesté de l’assemblée devant laquelle il parloit; il prononça son discours d’une voix tremblante qu’il ne lui fut jamais possible d’élever; il fut entendu avec dégoût de l’assemblée. Cette impression fâcheuse se répandit dans le public.
On auroit tort d’en conclure que ce discours méritoit le jugement peu honorable qu’on en porta; il étoit écrit avec sagesse et avec dignité, et très-bien adapté à la circonstance pour laquelle il avoit été composé; mais je dois dire aussi qu’il ne mérite pas d’être recueilli par l’histoire, parce qu’il ne contenoit aucune vue particulière d’administration; il se bornoit à présenter les intentions paternelles du roi.
Ce seroit également une injustice de concevoir du peu de succès qu’eut M. de Barentin dans cette circonstance une idée désavantageuse de ses lumières. Il avoit rempli avec gloire ses fonctions d’avocat-général au parlement de Paris, et il s’étoit acquis beaucoup de considération par la manière dont il avoit rempli celle de premier président de la cour des aides. Je ne veux pas donner mon opinion particulière, mais on verra bientôt que M. de Barentin étoit plus homme d’état qu’aucun des ministres modernes. Il devoit les sceaux à M. le comte d’Artois qui avoit su l’apprécier. Ce fut là son crime, et la véritable cause de l’injustice qui le poursuit encore.
Après M. le garde–des-sceaux, M. le directeur des finances prit enfin la parole. Les détails dans lesquels je vais être obligé d’entrer sur le long et étrange discours de M. Necker exigeant un certain développement, j’invite mes lecteurs à prendre un instant de repos, et je renvoie ces détails au chapitre qui suit.