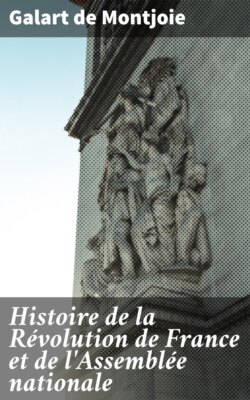Читать книгу Histoire de la Révolution de France et de l'Assemblée nationale - Galart de Montjoie - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE XVI.
ОглавлениеTable des matières
Suite de la première séance des états-généraux; discours de M. Necker; réflexions sur ce discours; raisonnemens du public sur la séance; fable sur le discours; séance des électeurs du5; députés du clergé de Paris; journal de M. de Mirabeau; arrivée de nouvelles troupes; première séance de chacun des trois ordres; particularités de cette séance; mouvemens que s’y donne M. de Mirabeau; séances des 7, 8, 9, 10, 11et12mai; première motion de M. Mounier; dispositions des esprits parmi le peuple et à la cour, sur les débats entre le tiers-état et les deux premiers ordres.
Mai1789.
5. LORSQUE M. Necker n’étoit encore connu dans le monde, que par des banquiers et quelques écrivains, il ambitionnoit la réputation d’homme d’état; et lorsque par un enchaînement de circonstances qu’il ne prévoyoit peut-être pas lui-même, les rênes de l’empire se sont trouvées dans ses mains; il a semblé ne plus desirer que la réputation d’homme de lettres. Ses discours, comme ses mémoires sont d’une prolixité fatigante; ils n’en sont pas plus lumineux; les phrases en sont sonores, les périodes contournées avec effort; on les croiroit plutôt sortis dune académie, que du cabinet d’un ministre.
Ce n’est pas ainsi que parloit et qu’écrivoit Colbert; je me plais quelquefois à lire les comptes que ce grand homme rendoit à Louis XIV. Quelle différence, grand Dieu! ce sont des modèles de précision et de clarté. Quelles vues! quel style! Dans une seule page de ces écrits, je trouve plus de pensées que dans aucun de ces volumes in–folio, dont M. Necker a encombré nos bibliothèques.
Les promesses de M. Necker sont emphatiques; il annonce des plans merveilleux, des systêmes sublimes, dont l’exécution va restaurer, régénérer le royaume, et y faire couler des fleuves d’or. Sa présomption est extrême. Il aborde les difficultés avec une assurance qui étonne le vulgaire; mais ensuite comme ces commentateurs impudens qui laissent dans l’obscurité les difficultés qu’ils s’étoient engagés d’éclaircir, il ne jette pas un seul rayon de lumière sur le point qu’il importoit le plus de connoître. Il verse quelqnes fleurs oratoires sur la question à résoudre, s’exhausse d’une manière gigantesque, et tout essoufflé de cet effort, il prend un lieu commun de morale pour la solution d’un problême de politique.
Dans aucune occasion, il ne se peignit mieux sous tous ces rapports, que dans la première séance des états-généraux. Lorsque M. le garde des sceaux eût fini de parler, M. le directeur des finances se leva, tenant à sa main un cahier de papier, dont le volume étoit effrayant; il enfla le son de sa voix, et lit sa prose du ton dont un héros de tragédie répète ses vers. Il faut convenir que M. Necker dans cette attitude, ressembloit moins au ministre d’un grand roi, qu’à un de ces hommes qui, monté dans un carrefour sur des tretaux, font sourire les passans par l’assurance avec laquelle il prêchent à la foule qui les environne, qu’ils ont trouvé la médecine universelle.
Bientôt l’organe de M. Necker se fatigua, sa langue s’embarrassa, et il fut obligé de donner son volume à lire à un médecin appellé M. Broussonet secrétaire perpétuel de la société d’agriculture, qu’il avoit amené aux états-généraux pour y remplir cette fonction. Elle dût paroître bien pénible à celui qui s’en acquitta; car la lecture de ce discours dura trois mortelles heures. C’étoit manquer aux convenances d’occuper l’élite de la nation à entendre le secrétaire d’une académie, lire l’ouvrage d’un ministre, un ouvrage qui, quelques heures après, devoit être entre les mains de tout le monde. Le directeur des finances n’auroit pas dû se contenter comme le roi, comme le garde des sceaux, d’un simple discours d’apparet, en se réservant de déposer dans le sein des états-généraux ses plans sur les finances? N’avoit-il pas à craindre de fatiguer, par la longueur de cette lecture, le roi, la reine, la cour, tous les députés? Et pour qui pauvoit-elle être intéressante, puisque chacun avoit la certitude qu’il auroit incessamment le discours sous les yeux? En manquant a cet égard, M. Necker pouvoit donner à croire qu’il étoit jaloux de venir recueillir personnellement des applaudissemens au milieu de l’assemblée la plus éclairée, et c’étoit une puérilité qu’il ne falloit pas laisser soupçonner.
Dès que M. Necker se proposoit de parler si longuement sur la chose publique, il étoit évident qu’il n’oubliroit pas de traiter les deux questions qui intéressoient essentiellement les états-généraux. Si la première de ces questions ne se fut jamais élevée, ils n’eusssent jamais été convoqués, et de la solution de la seconde, dépendoit leur réunion ou leur dissolution.
Le directeur des finances avoit donc à répondre à ces deux questions: comment comblera-t-on le déficit? opinera-t-on par ordre ou par tête?
Je laisse de côté tout le verbiage philosophique, toutes les triviales sentences de morale, et je m’attache à la substance de son discours. Il établit d’abord comme une vérité qu’on devoit croire sur sa parole, que le déficit étoit de cinquante-six millions. On avoit tant de fois varié sur le montant réel de ce déficit, qu’il falloit une autre preuve que la simple assurance de M. Necker, pour croire à la nouvelle assertion. Il n’y avoit qu’un seul moyen pour lui, de démonter invinciblement cette proposition, c’étoit de l’énoncer, de la débattre en présence de M. de Calonne, qui ne cessoit de solliciter ce combat singulier.
Si au surplus, le déficit n’étoit réellement que de cinquante-six millions, la première partie du discours de M. Necker finissoit là: il n’avoit plus rien à ajouter; la playe de là France n’étoit pas incurable; les offres généreuses du clergé et de la noblesse la refermoient à l’instant.
M. Necker cependant entreprit de prouver que le déficit étoit tel qu’il l’annonçoit, et sa manière de le prouver est si étrange, qu’aujourd’hui en lisant son discours, j’ai peine à croire mes yeux. Tel est en effet son raisonnement: le déficit est de cinquante-six millions, car il n’est pas de soixante-quinze. Il ne peut pas être de soixanre-quinze, parce que les retenues imposées sur les pensions en octobre
| 1787, ont rendu. | 5,000,000 l. |
| Les économies faites au département de la guerre | 9,000,000 |
| Celles de la marine, environ... | 4,000,000 |
| Celle du département des affaires étrangères | 1,800,000 |
| TOTAL | 19,800,000 |
Aujourd’hui que tout notre engouement pour M. Necker a cessé, s’il venoit nous présenter un pareil raisonnement, ne dirions-nous pas, ou qu’il est en démence, ou qu’il insulte a la nation? Cest pourtant à ses représentans, sous les yeux de son roi, qu’il a présenté un pareil tableau, et qu’il en a conclu que les dettes de l’état se montoient à cinquante-six millions.
Ayant ainsi indiqué le mal aux états-généraux, il voulut aussi indiquer le remède; il épuisa son imagination en ressources; et voici celles qu’il leur désigna pour combler le déficit.
| Augmentations sur les fermes générales, à l’expiration du bail | 18,000,000 l. |
| Pour l’administration des postes, domaines, aides et revenus casuels. | 6,000,000 |
| Abolition de l’abonnement pour les droits d’aides, connus sous le nom de droits réservés | 7,000,000 |
| Une autre ressource étoit bien plus lucrative encore ; le roi, disoitle ministre, en se chargeant des dettes du clergé, réunira à son revenu quatre millions cinq cent mille livres, et obtiendra cinq millions de rentes, en assignant l’entretien des hôpitaux sur les revenus ecclésiastiques, ci | 9,500,000 |
| A prendre sur le droit d’industrie à accordé à la compagnie des Indes, et dont elle se désistera, si on lui accorde la continuation de son privilége ; 1o. 1800 mille livres ; et 2o. un million deux cent mille livres qu’il est à desirer qu’on n’accorde plus pour favoriser le honteux et barbare trafic des noirs | 3,000,000 |
| 43,500,000 |
| D’autre part | 43,500,000 l. |
| En assujettisant la Bretagne à recevoir le tabac rapé, le produit de cette ferme augmenteroit de douze cent mille livres ; d’autre part, huit cent mille livres à reprendre sur le droit d’entrée des mousselines et toiles peintes, et l’extinction de quinze cent mille livres de rentes viagères chaque annee, donneroient, | 3,500,000 |
| Monsieur, en supprimant cinq cent mille livres des dépenses de sa maison, et Monseigneur le comte d’Artois, quatre cent mille livres, ont offert un sacrifice pratiotique, dont les représentans de la nation ont témoigné leur reconnoissance, et ont senti vivement le prix. Il est difficile de concevoir comment la nation n’étant pas encore représentée, ses représentans avoient pû témoigner leur reconnoissance pour ce sacrifice patriotique, évalué à | 900.000 |
| L’abolition des priviléges des bourgeois de Paris, et celle du francsalé, monteroient à environ Les quatre deniers perçus pour les huissiers-priseurs, et qui devoient l’être pour le compte du roi, allant à six cent mille livres, et le revenu des dons gratuits du clergé à trois millions deux cent mille livres, formeroient enfin près de | 800,000 4,000,000 |
| 32,700,000 | |
| Le déficit actuel étant de..... | 56,000,000 |
| Les ressources de | 52,700,000 5 |
| La dette de l’état n’étoit plus que de | 3,300,000 |
On conviendra qu’avec de tels moyens de restaurer les finances, et une si légère calamité à guérir, ce n’étoit guère la peine de soulever le royaume entier, et d’appeller de toutes parts ses représentans. En supposant les calculs de M. Necker à l’abri de toute censure, les députés ne devoient-ils pas s’étonner qu’on les eut appelles pour faire disparoître une misérable dette de3,300,000liv.?
Mais M. Necker ne se contenta pas d’avoir ainsi débarrassé de toute entrave l’administration des finances, il voulut encore ne rien laisser à faire aux états-généraux pour leur amélioration, car il dit encore: «Si, à ces bonifications, on ajoute dix à douze millions, produit de la contribution commune, l’état verra sa recette égaler sa dépense, le crédit public renaître, et le bonheur de la France reposer sur une base invariable». Il avoit donc raison, lorsqu’en quittant pour toujours la France, il rappella à l’assemblée nationale, qu’au mois de mai 1789, la restauration des finances étoit un jeu d’enfant. Mais les députés de l’empire devoient-ils s’attendre qu’ils n’étoient convoqués que pour s’occuper d’un jeu d’enfant? Ah! quelles sont, cruelles les pertes que la nation a faites à ce jeu!
Après avoir ainsi rassuré nos députés sur le sort de leur patrie, M. Necker dit des choses si flatteuses sur l’honneur et la loyauté des François, qu’il obtint les plus vifs applaudissemens. Il vouloit peut-être, par ces cajoleries, adoucir l’amertume des tristes vérités qui lui restoient à dire, et qui détruisoient absolument les riantes espérances qu’il venoit de donner. Il se proposa ces trois terribles questions:
Comment doit-on remplir les engagemens et les besoins de cette année, et supplèer à ceux de1790 et1791?
Quelle est l’étendue des anticipations?
Quels moyens à adopter pour leur remboursement?
Le directeur des finances ne vit d’autre solution au premier problême, qu’un emprunt de quatre-vingt millions. Il fit à la seconde question une réponse effrayante: il apprit que les anticipations consommées d’avance sur l’année actuelle se montoient à quatre-vingt-dix millions, et il évalua à l’énorme somme de cent soixante-douze millions celles sur les huit derniers mois de l’année. Quel cahos! et quel perfide contraste avec le riant tableau qui n’avoit brillé qu’un instant aux yeux de l’assemblée! Enfin le ministre ne vit pour réduire, pour rembourser ces anticipations, que le moyen incertain, insuffisant, des extinctions graduelles des rentes viagères et des pensions.
Il venoit d’affliger l’assemblée en lui présentant cette nouvelle perspective; il la mécontenta en voulant lui tracer l’ordre de ses travaux. Persuadé qu’elle établiroit dans tout le royaume les administrations provinciales; projet auquel il tenoit beaucoup, parce qu’il croyoit l’avoir conçu; il tira entr’elles et les états-généraux, une ligne de démarcation; il donna à ceux-ci pour objets des délibérations: les dispositions relatives à établir l’ordre des finances ; les principes qui doivent assurer l’égale répartition des impôts; les disproportions dans les impositions qui existent entre diverses provinces; les modifications de certains impôts, et le remplacement de certains autres; le réglement sur le commerce, sur les compagnies exclusives de négoce, et les opérations de la caisse d’escompte; l’amélioration des domaines, dont le produit annuel se trouvoit alors réduit à seize cens mille livres; l’administration des forêts, et l’examen des questions sur les engagemens domaniaux; les dispositions réglémentaires sur la police et le commerce des grains; le tirage de la milice, loterie de malheur, dit le ministre, qu’il faut ou remplacer ou adoucir; l’entière abolition de la corvée.
«Et si, ces deux mots, ajouta M. Necker, loterie et corvée sont rayés pour toujours des registres de l’administration des finances et du code françois; cette seule délibération suffiroit pour signaler honorablement les états-généraux de1789».
«Enfin, dit encore M. Necker, on pourra porter à ces derniers, ou à ceux qui doivent les suivre, l’examen de la cause des nègres, de ces hommes semblables à nous par la pensée et par la triste faculté de souffrir....»
Il termina cette partie de son discours par une exclamation qui déceloit de tristes pressentimens: «Ah! combien, s’écrioit le ministre, de sortes de satisfaction, combien d’espèces de gloire sont réservées à cette suite d’états-généraux qui vont reprendre naissance au milieu d’un peuple éclairé! Malheur, malheur et honte à la nation françoise, si elle méconnoissoit le prix d’une telle position, si elle ne cherchoit pas à s’en montrer digne, et si une telle ambition étoit trop forte pour elle!»
Tel est le cercle dans lequel il voulut renfermer les états-généraux qui n’en ont pas parcouru un seul rayon, qui n’ont pas même banni de nos dictionnaires le mot loterie. Il réservoit à l’administration particulière de chaque province: la conversion des aides et autres droits locaux, par d’autres moins onéreux, la répartition des impositions territoriales et personnelles entre les communautés et leurs individus; l’entretien des chemins et la confection des nouvelles routes; les encouragemens à donner à de nouveaux genres d’industrie, de commerce et de culture; la surveillance des hôpitaux, des enfans-trouvés, des prisons et dépôts de mendicité; enfin, l’inspection sur les dépenses des villes et communautés, et une infinité de biens partiels et de réformes locales à exécuter,»
Tel fut le plan de travail que M, Necker présenta $.ux états-généraux; plan informe, sans liaison comme sans méthode, qui ne pouvoit ni guider ni éclairer les représentans de la nation. Et n’y avoit-il pas tout-à-la-fois de la présomption et de la mal-adresse à leur annoncer, dès la première séance, l’intention d’influer sur leurs délibérations?
La question la plus épineuse, celle de l’opinion par ordre ou par tète restoit à résoudre. Ce que M. Necker dit à cet égard est si peu intelligible, qu’il me seroit difficile d’en présenter même le sens, de dire qu’elle étoit son opinion personnelle sur la manière dont ce grand procès devoit être décidé. Tout ce qu’il fut possible de recueillir des phrases énigmatiques dans lesquelles il enveloppa la question, c’est qu’il y avoit des occasions où il falloit délibérer par ordre, et d’autres où les opinions devoient être recueillies par tête; et que pour laisser aux deux ordres privilégiés le mérite de renoncer eux-mêmes à leurs exemptions pécuniaires, ils pourroient commencer par se séparer.
Etoit-ce bien sérieusement que M. Necker ouvroit un tel avis? Il savoit, d’après les intentions qu’avoient manifestées les deux ordres privilégiés, que les exemptions pécuniaires ne pouvoient pas les diviser d’avec le tiers-état. Il n’ignoroit pas non plus que la première opération à laquelle les trois ordres devoient procéder, c’étoit la vérification des pouvoirs respectifs, car nul ne pouvoit se dire député avant que ses pouvoirs fussent vérifiés.
Quand-donc M. Necker disoit qu’il falloit laisser les deux premiers ordres se séparer, pour leur donner le mérite de renoncer à leurs exemptions pécuniaires, il élevoit un doute injurieux au clergé et à la noblesse, dont on ne pouvoit plus soupçonner les intentions, d’après les offres qu’ils avoient tant de fois répétées. Ce doute n’étoit pas seulement injurieux, il étoit encore impolitique, parce qu’il justifioit et nourrissoit la méfiance du tiers-état.
M. Necker, en outre, posoit mal la question, et éludoit la difficulté: il ne s’agissoit point, dans ce moment, d’exemptions pécuniaires; il s’agissoit de vérification de pouvoirs. Il auroit donc dû se demander, les pouvoirs seront-ils vérifiés en commun ou séparément? La réponse n’étoit peut-être pas bien difficile, mais M. Necker, ou ne voulut pas, ou ne sent pas la donner. La circonstance étoit favorable: le roi étoit présent; il avoit, dans ce moment, toute la plénitude de l’autorité royale; et jamais il ne fut plus à propos d’appliquer le principe de M. le comte de Mirabeau, que le monarque étoit le législateur provisoire. Il n’y avoit point encore, à proprement parler, d’états-généraux; il n’y avoit point de députés, puisque leur mission n’étoit pas légalement prouvée, A qui appartenoit-il donc de décider si les pouvoirs devoient être vérifiés en commun ou séparément, si ce n’est au seul législateur, à la seule autorité que l’on reconnût alors en France?
Il valoit mieux s’attacher à développer ce principe, à le rendre bien évident, que de s’enfoncer dans des calculs dont une lecture rapide ne pouvoit que lasser l’assemblée sans l’instruire. Le principe étant démontré, le roi devoit du haut de son trône prononcer la décision. Si les trois ordres s’y fussent conformés, l’état étoit peut-être sauve; s’ils eussent désobéi, c’étoit évidemment une insurrection de la part de celui ou de ceux des trois ordres qui auroient donne l’exemple de la désobéissance; elle ne dépouilloit le roi d’aucun de ses droits, et une insurrection alors n’étoit pas encore sans remèdes.
La péroraison du discours de M. Necker fut touchante; c’étoit un hommage aux vertus du roi; il ne dit rien qui ne se trouvât gravé dans tous les coeurs des membres de l’assemblee; aussi applaudit-on avec transport à la justice que rendoit à Louis XVI, un ministre qui lui devoit lui-même tant de reconnoissance. La séance, après ce long discours, fut levée, et le roi retourna au château avec le même cortège, la même pompe qui l’avoient accompagné aux états-généraux. Les plus riches voitures avoient été destinées à cette cérémonie; les harnois des chevaux étoient de la plus grande somptuosité; le nombre, , la tenue des troupes, l’éclat des broderies, tout étoit de la plus grande magnificence. Le luxe des rois asiatiques peut à peine être comparé à celui qui, dans ce grand jour de fête, accompagnoit Louis XVI. Au milieu de tout ce faste, la modestie de la reine, et la simplicité de ses vêtemens offroient un contraste qui frappoit tous les yeux, et ce contraste etoit a son avantage.
Dès que la relation de cette mémorable séance parvint à Paris, chacun en raisonna à sa manière, mais ce fut sur-tout dans les clubs, dans les cercles démocratiques, qu’on entendoit les propos les plus extraordinaires, et qui peignent bien la disposition où étoient alors les esprits. Si M. Necker, disoient les plus modérés, n’a pas besoin d’argent, comme il l’a fait entendre dans son discours, si la plaie de l’état est si aisée à guérir, pourquoi a-t-il agité tout le royaume? Pourquoi a-t-il convoqué les états-généraux? On se récrioit sur la longueur de ce discours; on n’y trouvoit ni plan, ni ordre, ni méthode, ni les conceptions d’un homme de génie. On sourioit du style académique qui l’embellissoit; on se plaignoit de ne rien comprendre aux articles dont le développement interessoit le plus; on se demandoit où sont donc les vues, les projets, les systêmes de ce ministre. Quoi! disoit-on encore: dans un discours d’une aussi mortelle longueur, pas un seul mot de la constitution devant une assemblée dont les membres sont appelles pour constituer le royaume! On trouvoit enfin indécent qu’il eût voulu tracer à l’élite de la nation, la marche qu’elle devoit suivre.
Les plus ardens alloient bien plus loin encore: ils lui faisoient un crime de ses ménagemens pour les ordres privilegiés, pour l’autorité même du monarque; ils lui reprochoient de n’avoir pas dévoilé, avec franchise et sans détour, les sentimens qu ils lui siipposoient pour le tiers-état; ils osoient regreter que le roi lui-même n’eût pas déposé, en présence de la nation, le sceptre et la couronne pour les recevoir de ses mains.
La confiance que M. Necker inspirait au tiers-état n’étoit donc pas universelle, même dans cet ordre. Par une de ces singularités, dont sa vie ministérielle offre tant d’exemples, il avoit dans son discours donné au tiers-état le nom de communes, et quatre jours après, les journalistes de Paris reçurent des reproches amers d’avoir employé le même mot pour désigner le troisième ordre. Les journalistes étoient justifiés par l’exemple du ministre; mais le ministre lui-même n’étoit pas excusable d’avoir le premier, dans des circonstances orageuses, fait entendre un mot qui réveilloit des idées républicaines et sembloit inviter le tiers-état de France à s’assimiller aux communes d’Angleterre.
Ceux qui vouloient conserver à M. Necker tout le crédit dont il jouissoit auprès du tiers-état, l’excusoient de n’avoir point, dans son discours, donne un libre essor au penchant qui l’entraînoit vers cet ordre. Ils composèrent à ce sujet une histoire qui trouva peu d’incrédules: ils racontèrent que deux jours avant la première séance des états–généraux, la reine l’avoit fait inviter à se rendre dans son appartement, avec les discours qu’il devoit lire dans l’assemblée. On disoit que madame Necker, prévoyant que le motif de cette entrevue étoit d’obtenir qu’il fit des changemens à ce discours, mit tout en oeuvre pour engager le ministre à imaginer un prétexte qui l’exemptât de se rendre à l’invitation de la reine; mais M. Necker crut qu’aucune raison ne pouvoit le dispenser d’obéir au désir de la reine; il se rendit donc chez elle; là il trouva les princes triumvirs, et tous les grands qui avoient adopté leurs principes. On circonvint le ministre, on le flatta, on le caressa, on lui fit lire sa harangue, on lui désigna les corrections qu’on souhaitoit qu’il fit, et on parvint à obtenir qu’à l’instant même il raturât les articles qui déplaisoient, et qu’il leur substituât ceux qu’on lui présentoit.
Madame Necker cependant, impatiente de la longueur de cette conférence, et redoutant les manèges du triumvirat, se rendit chez le roi, et lui témoigna ses inquiétudes sur l’absence de son mari. «Soyez tranquille, madame, lui répondit le roi, dans un instant vous allez voir M. Necker.» Le roi entre en effet chez la reine, il y trouve son ministre au milieu d’un cercle nombreux, dont toutes les personnes qui le composoient paroissoient fort échauffées; il s’adresse au directeur des finances, et lui dit: Allons donc, M. Necker, vous oubliez donc que c’est l’heure où vous m’avez promis d’être chez moi; il le prend par la main, l’emmène et le rend à son épouse. Mais le mal étoit fait; les corrections étoient adoptées, et les engagemens qu’avoit pris le ministre ne lui permettoient plus de faire revivre les endroits effacés.
Telle étoit l’histoire, ou plutôt la fable dont on amusoit les crédules adorateurs de l’idole du jour; et il ne faut pas s’étonner de la facilité avec laquelle elle étoit crue, car les Parisiens ne voyoient pas même ce qu’ils avoient sous les yeux. Ils soupçonnoient du mystère dans le retard que leurs électeurs mettoient à nommer les députés. On leur persuadoit que ce retard étoit encore un effet des intrigues des triumvirs. A la porte, dans les cours de l’archevêché, on vous disoit qu’il ne régnoit. aucun accord parmi ces électeurs, qu’ils étoient divisés, que le désordre troubloit leurs délibérations, et que les aristocrates, car le mot étoit déjà à la mode, influoient tellement sur ces délibérations, qu’on n’en verroit jamais la fin, et que jamais Paris ne verroit ses députés aux états-généraux. Il n’y avoit pas plus de réalité dans ces nouveaux complots aristocratiques, que clans la fable qui avoit dénaturé le discours du directeur des finances. Les électeurs étoient très-unis; et s’ils avançoient lentement dans leur travail, c’est que la nature même de ce travail ne leur permettoit pas une marche plus rapide. Ils employèrent encore leur séance du5à la lecture des cahiers; et quoiqua l’ ordinaire elle finît fort tard, la lecture se borna à l’article de l’agriculture, et à une partie de celui du commerce. Ils nommèrent ce jour-là des députés pour aller complimenter la noblesse, et qui étoient chargés de lui offrir la communicationdes cahiers. Ils rapportèrent pour réponse que l’offre avoit été acceptée, et que le président de la noblesse faisant allusion à un mot d’Henri IV, leur avoit dit: «Nous allons vous précéder comme vos frères aines, dans la carrière où nous entrons tous.»
La noblesse n’avoit cependant pas encore nommé ses députés; elle fut devancée, ainsi que le tiers-état, par le cierge, dont les représentans furent M. l’archevêque de Paris, MM. l’abbé de Montesquieu de Chevreuil, chancelier de l’Université: Gros, cure de Saint-Nicolas-du-Chardonnet; dom Chevreux, général de l’ordre de Saint-Maur; Du-mouchet, recteur de l’Universiie Legros, prévôt de Saint-Louis-du-Louvre; de Bonneval, chanoine de l’église cathédrale de Paris; Veytard, curé de Saint-Gervais; Perrotin de Barmond, conseiller au parlement.
Les suppléans furent MM. le général de Saint-Lazare–, Berardier, grand-maître du collége de Louis-le-Grand; dom Frennelet, pvoviseur du collége des Bernardins; l’abbé de Damas; Bernière curé de Saint-Pierre de Chaillot.
La tranquillité avec laquelle se fit cette députation, le calme qui régnoit dans les assemblées des deux autres ordres, ne pouvoient pas même laisser soupçonner qu’il existat aucune cabale pour porter obstacle à l’élection des représentans de Paris. Mais il falloit supposer une conjuration contre les états-généraux; et, comme on ne pouvoit faire croire à sa réalité que par des mensonges, il falloit bien employer même les plus grossiers. Ils entretenoient d’ailleurs la fermentation, et ce n’étoit qu’en la portant à son comble qu’on pouvoit enfin déterminer les bourgeois à un soulevement.
M. de Mirabeau accrut beaucoup cette fermentation: il imagina de joindre à son rôle de législateur, celui de journaliste. C’étoit vouloir combattre non-seulement pour la république, mais encore pro domo suâ. Il fit paraître le premier numéro d’une feuille périodique, dans lequel il annonça qu’il rendrait un compte exact de tout ce qui se passerait dans les états-généraux. La réputation qu’il s’étoit faite lui attira un nombre infini de souscripteurs. On dévora cette première feuille. M. de Mirabeau s’y décliaînoit avec emportement contre M. l’évêque de Nancy, et s’y conformoit au goût du parti dominant, en s’y montrant injuste et sévère envers la reine. il y releva également, avec exagération, une foule de minuties auxquelles personne n’avoit pris garde dans les cérémonies de la présentation des trois ordres au roi, lors de l’ouverture de la première séance des états-généraux. En retournant ces bagatelles de tontes les manières, il les présenta comme injurieuses au tiers-état, et comme supposant des intentions perfides, de la part de la cour, Contre cet ordre. C’étoit ajouter à la persuasion qu’il s’étoit formé une conjuration dans le palais du roi, pour écraser le tiers-état.
Ecrire dans ce sens, c’étoit réellement agiter le flambeau de la discorde; si tous les écrivains eussent été sages ils eussent, au contraire, réuni leurs efforts pour adoucir la crise qui agitoit la masse du corps politique, pour calmer le peuple au lieu de l’aigrir. Indifférent sur l’opinion que ferait naître la périodique attaque qu’il commençoit, M. de Mirabeau voulut du moins justifier le parti qu’il prenoit de se ranger, quoique député de la nation, dans la classe des journalistes. Il prétendit qu’il devoit compte de sa conduite à ses commettans, et que c’étoit là le but de sa feuille. Mais lui convenoit-il de faire de ce compte une spéculation d’intérêt? Ses commettans étoient à Aix en Provence, et pour les instruire, que falloit-il de pius qu’une correspondance par lettres? Ne pouvoient-ils être bien informés, si le royaume entier n’étoit instruit de ce qu’on vouloit qu’ils sçussent? C’étoit d’ailleurs une assez plaisante manière de rendre compte de sa conduite personnelle, que d’exercer une censure amère sur les personnes de la cour, et sur quiconque ne voudrait pas s’enrôler sous les drapeaux de la démocratie.
M. de Mirabeau, en s’élançant dans cette carrière, donna un funeste exemple; comme lui plusieurs députés ont abjuré leurs nobles fonctions pour se mettre aux gages des libraires. Il n’est rien de plus scandaleux et de plus affligeant, que de voir dans chaque séance plusieurs de nos législateurs, ne prendre d’autre part aux délibérations, que pour en faire note, en faire un sordide trafic. Le nombre en est plus considérable qu’on ne croit; car outre ceux dont les feuilles sont imprimées; il en est qui rédigent des bulletins à la main, qu’ils vendent ensuite bien chérement. C’est faire argent de tout, mais c’est aussi avilir le caractère de député. Et est-ce pour écrire des feuilles périodiques, ou pour débattre les intérêts de ses commettans, qu’on a accepté la plus honorable des missions? Cet abus est funeste à la chose publique; il est étonnant que les peuples n’en ayent pas demandé la suppression. C’est à cette cause qu’ils doivent principalement attribuer l’indifférence de tant de députés pour l’arrivée d’une nouvelle législature. Celui, par-exemple, à qui les propriétaires du journal de Paris donnent annuellement cinq cens louis pour le prix de sa rédaction, ne doit-il pas plutôt appréhender que desirer la fin de la session actuelle? Il faut un désintéressement héroïque pour que dans le combat d’un grand intérêt personnel contre l’intérêt général, le premier ne l’emporte pas, et les peuples devroient préserver leurs représentans de cette tentation.
Ce qui étoit plus propre encore que les écrits de M. de Mirabeau à alarmer le tiers-état de Paris, c’etoit l’arrivée journalière de nouveaux régimens. Les hussards d’Esthérazy et Royal, dragons, vinrent accroître le nombre de ceux qui étoient déjà dans la capitale; deux furent mis en garnison à Saint-Germain-en-Laye, deux à Saint-Denis, et quatre aux environs de Versailles.
Le voisinage de tant de troupes ne répandoit cependant pas encore un grand effroi; ou étoit un peu rassure par l’ouverture des états-généraux; on se disoit que les choses étoient trop, avancées pour que la cour put reculer. Quelle apparence en effet que le roi voulut retirer à la nation, le bienfait qu’il lui avoit accordé au moment où elle s’en saisissoit? Le garde-des-sceaux avoit, dans la première séance, ajourné les trois ordres pour le lendemain. Une proclamation du roi, affichée dans les rues, et publiée par un hérault d’armes, fixa l’ajournement à neuf heures du matin.
6. L’heure venue, le tiers-état se rendit dans l’a salle des menus; le clergé et la noblesse se retirèrent dans les chambres qui leur avoient été préparées. Une foule de curieux qui attendoit aux portes le tiers-état, entra avec lui dans le lieu de l’assemblée. Il seroit difficile de se faire une idée d’une telle cohue. Qu’on se figure environ500députés confondus avec des hommes qui ne l’étaient pas; qu’on se représente tous ces individus allant, venant dans la salle, s’accostant mutuellement . se demandant êtes-vous député? L’un répondant, je le suis, l’autre, je ne le suis pas. Ceux qui se connoissoient formoient divers groupes; on s’interrogeoit; on eût voulu savoir le nom de tous ceux qu’on voyoit. On s’exhortoit ensuite à prendre un parti, à se donner une forme d’assemblée, chacun alors prétendoit dire son avis, et personne ne pouvoit se faire entendre.
Parmi tous ceux qui montroient plus de zèle pour débrouiller cet informe cahos, M. de Mirabeau se faisoit distinguer. Il invitoit à prendre place, imposoit silence à l’un, faisoit asseoir l’autre, agitoit les bras, frappoit des pieds; il remplaçoit le marquis de Brezé. Quelques députés, frappés de l’air sévère dont il s’acquittoit de ses fonctions, demandèrent à leurs, voisins: Quel est cet homme qui se donne tant de mouvemens? Est-il députe?–Eh! oui, leur répondit-on, c’est le comte de Mirabeau.–Oh! oh! répliquérent les premiers, ce comte de Mirabeau nous paroît un homme bien, dur, bien brutal.
Enfin, un député doué d’une forte poitrine, d’un organe de stentor, arrange des bancs, monte dessus, et d’une voix plus éclatante que le tonnerre, heurle ces mots: Il nous faut un chef, un président, un doyen qui règle les rangs de parler.
Descendu de ce théatre, ce député y est aussi-tôt remplacé par un autre. Celui-ci balbutie une motion qui déplaît; on murmure, on se lève avec fureur, on le hue. L’orateur étonné, et vraiment effrayé de cette forme de délibération, se précipite de la tribune, fend la presse, et comme s’il eût craint, pour sa vie, crie avec effroi, à la garde, à la garde.
Dans un tel tumulte, il étoit impossible de s’arrêter à aucune résolution. Quel parti faut-il prendre, demandoit l’un? Vérifiera-t-on les pouvoirs séparément, disoit un autre? Il faut, jmoposoit un troisième, recourir à l’autorité du conseil. Après avoir ainsi perdu beaucoup de terns, on décida par acclation et sans aller aux voix, ce qui n’étoit pas possible, qu’il ne fallait rien faire du tout; et c’est par cette décision que la séance se termina.
Le clergé et la noblesse procédèrent avec plus d’ordre, mais ils se divisèrent sur la question de la vérification des pouvoirs en commun ou séparément. Dans: le premier ordre, présidé par M. Le cardinal de la Rochefoiicault, cent trente-trois voix furent pour la vérification dans l’ordre, et cent quatorze pour la vérification dans l’assemblée générale.
Dans le second ordre, présidé par M. de Montboissier, on agita si les pouvoirs dévoient être vérifiés par des commissaires pris exclusivement dans l’ordre de la noblesse, ou s’ils doivent l’être par des commissaires pris dans les trois ordres. Cent quatre-vingt-huit voix furent pour le premier avis, et quarante-sept seulement pour le second.
Ainsi, dès cette première séance, la scission se manifesta entre le tiers-état et les deux premiers ordres, et ceux-ci se trouvèrent eux-mêmes divisés. Sa minorité, dans l’un et dans l’autre, étoit pour la vérification en commun; mais cette minorité pouvoit faire des conquêtes: n’en eût-elle fait aucune, le tiers-état fut assuré, par l’issue de cette première séance, d’attirer à lui une partie du clergé et une partie de la noblesse. Cette division fut donc pour lui le présage de la victoire, parce qu’elle lui promettoit l’avantage de présenter une niasse importante qui étant composée des membres des trois ordres, auroit toujours embarrassé et le gouvernement, et la portion du clergé et de la noblesse qui n’auroit pas voulu se réunir à lui.
7, 8, 9, 10et II. Le tiers qui dès-lors prit et se fit donner, par les écrivains qui étoient à sa dévotion, le nom de communes, mit un peu plus d’ordre dans sa seconde séance. Il ne vouloit ni chef, ni président; il pria M. Leroux, ancien maire de la ville d’Amiens, et qui étoit le plus ancien d’âge, de recueillir, comme il le pouroit, les suffrages, en se faisant aider de six personnes les plus âgées. L’assemblée n’en fut pas moins tumultueuse, à cause sur-tout de l’affluence d’étrangers qui se trouvoient confondus parmi les députés, et qu’on ne pouvoit pas distinguer d’entr’eux. M. Leroux eut constamment, pendant toute la durée de ses fonctions, à côté de lui un jeune commis du bureau de la guerre, que la seule curiosité attiroit chaque jour dans la salle. Il écrivoit sur la table même qui étoit devant M. le doyen, un bulletin de la séance.
Le systême du moment étoit de ne rien faire du tout, et de combattre avec la seule force d’inertie, les deux premiers ordres qui, par peu d’accord que chacun d’eux voyoit régner dans son sein, donnoient beaucoup d’avantage au troisième. On convint d’inviter, par une députation, le clergé et la noblesse, à procéder en commun à la vérification des pouvoirs et aux importantes délibérations qui devoient la suivre, et on regarda cette invitation comme une honnêteté et une déférence.
La réponse du clergé portée par six ecclésiastiques, au nombre desquels étoient MM. de Mande, évêque de Montpellier, et du Tillet, évêque d’Orange, fut que cet ordre avoit nommé des commissaires pour conférer avec ceux de la noblesse et du tiers, sur la proposition que celui-ci faisoit.
On murmura beaucoup de cette sage réponse; on ne vouloit point de commissaires; on etoit impatient d’engloutir les deux premiers ordres. Tout ce qui tendoit à reculer leur défaite, ne pouvoit que déplaire.
Comme M. le doyen auroit bien voulu pouvoir se faire entendre au milieu du tumulte qui se faisoit autour de lui, il proposa de rédiger un réglement provisoire, pour la police intérieure de l’assemblée. Ce n’étoit pas assez de faire une proposition; l’embarras étoit de recueillir les voix. On appelloit d’abord les bailliages, mais cette forme entraînoit des longueurs qui ne permettoient jamais d’avoir une décision.
Ce fut dans cette confusion et dans cette inaction, que se passèrent les six premières séances. Enfin, dans la septième, M. Mounier qui devoit paroître avec tant d’éclat sur le nouveau théâtre, proposa ce mode de police qui fut adopte par acclamation; car il fut encore impossible de prendre les voix individuellement.
«Nommer une personne dans chaque gouvernement, pour huit jours, à l’effet de se réunir à M. le doyen pour mettre de l’ordre dans les conférences, compter les voix, connoître la majorité des opinions sur toutes les propositions qui seront faites pour accélérer la réunion des ordres dans la salle des états-généraux, et tenir note de tout ce qui sera déterminé provisoirement, en évitant tout ce qui pourront faire supposer que. les communes consentent à la séparation des ordres, et en leur conservant soigneusement le caractère d’assemblée non constituée, dont les membres n’ont point fait vérifier leurs pouvoirs, et qui n’ont d’autre, but que de préparer à la formation.»
Autant le tiers-état étoit immobile, autant la noblesse mettoit d’activité dans sa marche. Elle s’étoit déclarée suffisamment constituée. Cependant, elle ne refusa pas l’invitation qui lui fut faite par le clergé, comme au troisième ordre, de nommer des commissaires pour se concerter avec ceux des deux autres ordres.
Cette lutte devenoit infiniment intéressante pour la France entière. On en attendoit l’issue avec la plus vive impatience, et on ne savoit trop ce qui arriveroit, si le clergé et la noblesse, fidèles aux lois constitutionnelles jusqu’alors connues, et jaloux de conserver un privilége dont ils ne pouvoient se dépouiller sans ébranler la monarchie, refusoient de se réunir au tiers-état, et persistoient à vouloir la délibération par ordre.
Mais l’inertie du tiers-état n’étoit qu’apparente, et la fermeté de sa contenance venoit uniquement de la certitude qu’il avoit de remporter une victoire entière. Ses membres intriguoient dans les deux autres chambres: dans la première, ils flattoient les cures des plus belles espérances; et dans la seconde, ils étoient assurés de M. le duc d’Orléans.
Le peuple entier prenoit le plus grand intérêt à la querelle, et tous ses voeux étoient pour son ordre; il n’étoit point admis aux séanees du clergé et de la noblesse, tandis qu’on l’accueilloit avec empressement dans la salle des communes; il les encourageoit, et leur rendoit, avec impétuosité, les mouvemens qu’il en avoit reçu.
Quel sujet de réflexions pour la cour! Elle étoit véritablement embarrassée. Jamais peut-être ministre ne s’étoit trouvé dans une conjoncture aussi périlleuse que M. Necker. Quel parti alloit-il prendre? Flottoit-il entre l’autorité du roi, qu’il avoit tant de fois promis de conserver intacte, et les gigantesques prétentions du tiers-état? On croiroit peut-être qu’il sentoit lui-même tout le danger de sa position; il n’en étoit rien. Habile dans la science des calculs, profond dans les spéculations d’une société de banque, il n’étoit point fait pour gouverner un empire. Sonmallieur, comme le nôtre, c’est qu’on lui ait cru de l’aptitude pour jouer ce grand rôle. Il n’a jamais pu saisir que quelques détails de l’administration publique. L’ensemble en est trop vaste pour que son génie étroit pût l’embrasser. Incapable de soupçonner aucun inconvénient à des opérations qu’il avoit conçues, et qu’il regardoit toujours comme de subl îmes conceptions, il ne craignoit pas les événemens, parce qu’il ne savoit pas les prévoir.
Il étoit réellement sans inquiétude sur le fond de l’importante contestation qui divisoit le tiers-état d’avec les deux premiers ordres. Il regrettoit seulement que les longueurs qu’entraînoit cette contestation, retardassent l’exécution des plans de finance qu’il méditoit, et qu’il croyoit que les états-généraux recevroient aveuglément et préalablement à toute autre opération. Les besoins énormes de l’état pour l’année courante la pénurie du trésor royal, tels étoient les seuls objets de sa sollicitude. Ainsi, quand les vents impétueux rembrunissoient l’horison de la France d’épaisses nuées, quand les vagues en fureur poussoient le vaisseau de l’empire contre les écueils, celui qui en tenoit le gouvernail n’avoit d’autre crainte que de manquer de vivres.
Il tardoit à M. Necker, d’obtenir des fermes et des postes, l’augmentation qu’il desiroit; il se promettoit de demander à la nation assemblée, un emprunt qui ayant été cautionné par elle, eût été facilement rempli. A la demande de cet emprunt, il se proposoit d’ajouter celle d’un impôt qui eût sur-le-champ rempli le déficit.
Tels étoient les projets, telles étoient les sollicitudes de M. Necker, au moment où la monarchie étoit menacée d’une entière dissolution. On parloit aussi des ce temps-là de la création d’un papier-monnoie; d’autres prétendoient que l’impôt le plus aisé à percevoir, et le plus efficace pour faire disparaître avec promptitude le déficit, serait une taxe sur les croisées une fois payée. On se perdoit en raisonnemens, en conjectures; chacun se croyoit devenu homme d’état, enfantoit des systêmes d’économie politique, et avoit la prétention d’éclairer par ses idées, la marche de l’assemblée qui alloit naître. Cest avec douleur que je jette les yeux sur les premiers jours de sa naissance, et que je me vois conduit par la suite de mon récit, à en présenter l’ histoire, car je n’ai plus que des erreurs et des désastres à raconter?