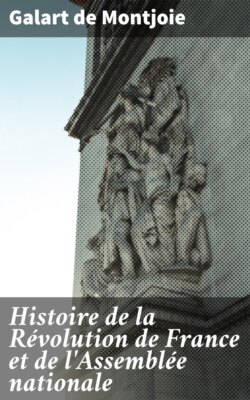Читать книгу Histoire de la Révolution de France et de l'Assemblée nationale - Galart de Montjoie - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE X.
ОглавлениеTable des matières
Détails sur la préexistence d’un plan de révolution ; part qu’ont eue aux changemens MM. d’Orléans et de Mirabeau ; élection de ce dernier par le tiers-états de Marseille et d’Aix; bruits étrangers qui se répandent sur son compté; opinion sur son élection; mort du marquis de Mirabeau; soulèvement effroyable en Provence; excès contre M. l’évêque de Sistéron; conduite de M. de Mirabeau dans les insurrections populaires; scène atroce à Auch; attentats contre MM. de la Fare; de Peynier, de Pujet; éclaircissemens sur la manœuvre des grains; trait touchant de la bonté du roi; production infâme flétrie par le parlement; liberté et gêne de la presse.
Mars1789.
PARMI tous ceux qui briguèrent la qualité de représentant de la nation, je distingue sur-tout Messieurs d’Orléans et Mirabeau. Tous les deux firent jouer des intrigues qui toutes furent orageuses. Tous les deux entrent en même tems dans la carrière; le premier arrive au but par des circuits; le second s’y élance. Celui-là joue un rôle subalterne, il est l’instrument timide des factieux: celui-ci joue le rôle d’un chef de parti; lors même qu’il ne se montre pas, il est l’ame de la faction sur laquelle il règne despotiquement. Pour qu’on comprenne bien toute la part que chacun d’eux a eue aux scènes qui se sont passées jusqu’à ce moment, je dois dire ce qu’on n’a jamais voulu croire.
J’ai fait pressentir dans l’introduction à cette histoire, et je repète que le plan de la révolution existoit depuis long-tems, tel à-peu-près que nous le voyons aujourd’hui exécuté. La conduite qu’a tenue l’assemblée nationale, la marche qu’elle a suivie dans ses travaux, l’enchaînemeut, la progression de ses entreprises, doivent convaincre aujourd’hui qu’elle n’a point agi par l’impulsion que lui ont donnée les circonstances où elle s’est trouvée placée. Ces différentes situations iront point été amenées par le hasard. Comme la série des décrets à rendre étoit enfantée long-tems avant l’ouverture des états-généraux, tous les événemens qui devoient suivre cette époque étoient aussi prévus d’avance. On a vu en effet l’assemblée, du moment où les trois ordres se sont trouvés à Versailles, travailler à un édifice dont tous les matériaux se trouvoient sous la main à mesure qu’on en avoit besoin; ils avoient donc été recueillis avant qu’il fut nécessaire d’édifier. Le systême en un mot qui nous étonne, est un ouvrage antérieur à l’existence de rassemblée nationale; elle n’y a eu d’autre part que d’en procurer l’exécution.
Ceux qui avoient connoissance de ce plan ont employé un grand art pour le faire adopter par le plus grand nombre. Aux hommes nourris d’idées républicaines, ou dont l’imagination se repaissoit de projets de vengeance contre la cour, on le montroit dans son ensemble; à ceux qui tenoient davantage aux formes monarchiques, et qui n’avoient pas de grands ressentimens contre l’ancien gouvernement on n’en laissoit entrevoir qu’une partie; à ceux-là on adoucissoit les conséquences; à ceux-ci on cachoit le but; on encourageoit les aines timides, on caroissoit lambition, on flattoit la haine, on embrasoit de nouveaux feux les coeurs ardens. C’est ainsi qu’on a insensiblement entraîné la majorité des esprits, qu’on a plupart se sont trouves dans le parti sans connoître la marche qu’ou vouloit leur faire tenir.
Je me souviens que dans ma jeunesse, un homme engoué de toutes les rêveries du philosophisme moderne, et en relation avec tous les écrivains qui le professoient, me développa un plan de révolution tel, a peu de chose près, que celui qui s’exécute, enm’assurant que tôt ou tard on en obtiendroit l’accomplissement. Je me souviens également très-bien que le feu président d’Eguilles qui, maigré ma jeunesse, m’accordoit son amitié et sa confiance, me montra un projet qui différoit très-peu du premier, et qu’il avoit dénoncé au feu roi et à toute sa famille; niais le président étoit persuade que les parlemens concouroient à l’exécution de ce plan, et en cela il erroit; ces compagnies ont fait des fautes; elles s’alarmoient peut-être trop des dangers de l’autorité arbitraire; elles ne redoutoient pas assez les excès de la licence; mais il est aisé, en lisant leurs derniers arrêtés, de se convaincre que ces masses étoient de solides appuis de la monarchie.
Enfin je me rappelle que dans les deux plans on proposoit, comme un moyen nécessaire et infaillible de leur exécution, de contraindre à une abdication le roi actuellement régnant, et de donner à la nouvelle république un chef qui concourût de bonne foi à asseoir l’édifice sur ses bases.
M. de Mirabeau est venu aux états-généraux avec un pareil plan dans son porte-feuille. Il ne l’avoit pas concu. Où en avoit-il donc fait l’acquisition? Seroit-Ce parmi les papiers du marquis de Mirabeau son père, qu’il l’auroit trouvé? Le fait n’est pas vraisemblable, parce qu’il n’a pas plus hérité des manuscrits que des qualités personnelles de l’ami des hommes. D’ailleurs le marquis de Mirabeau, dans ses spéculations sur l’économie des états, supposoit toujours un gouvernement monarchique.
Je ne puis donc porter le flambeau sur cette partie de l’histoire que j’écris; mais tout me porte à croire que ce plan conçu d’abord et rédigé par des calvinistes, saisi ensuite avec avidité par quelques philosophes qui y ajoutèrent leurs idées, fut perfectionné dans la société du feu baron d’Olbach, où on ne le confioit qu’aux prosélytes que plusieurs épreuves avoient fait juger dignes d’être initiés clans les nouveux mystères. Voltaire, oracle de cette société, qui ne s’attendoit pas à une prochaine tenue des états-généraux, et qui croyoit que les innovations arriveroient successivement, vouloit qu’on commençât la révolution par l’anéantissement du christianisme. De-là ce refrein de toutes les lettres qu’il écrivoit aux conjurés: Ecrasez, écrasez, vous dis-je, l’infâme. Tout le monde sait ce que cet écrivain entendoit par le mot l’infâme; personne n’ignore qu’avec de grandes connoissances et un esprit dont l’abondance et la facilité étonnent, il eut sur le divin auteur de notre religion des préjugés qui tenoient de la folie, réalisant en sa personne d’une manière toute particulière, cette vérité d’un ancien: Nullum magnum ingenium sine mixturâ dementioe fuit.
Le plan confié à tous ceux que leur haine pour les rois et les prêtres rangeoit parmi les conspirateurs, a reçu, comme on pense bien, en passant par tant de mains, différentes modifications. Ce plan fut connu au Palais-Royal; et en lisant les écrits de M. l’abbé Syeyes, on s’apperçoit aisément qu’il en est imbu, et qu’en y mêlant ses vues particulières, et en profitant avec habileté des circonstances, il a eu la prétention de se l’approprier et d’en paroître l’auteur. M. le duc d’Orléans n’a jamais connu et ne connoît point encore tout l’ensemble de ce projet; mais il en a vu suffisamment pour croire que son exécution favorisoit ses desseins particuliers.
M. de Mirabeau donc est arrivé aux états-généraux avec un plan; il n’a eu d’autre souci que de contraindre à l’accepter: tous ses moyens ont réussi, et les moyens sont à lui. M. Mounier est venu également a rassemblée nationale avec un plan; mais ce plan étoit son ouvrage, l’ouvrage d’une ame pure, d’un beau génie; c’étoit la vertu qui avoit conçu ce brillant reve, et ce fut aussi avec la vertu seule que M. Mounier voulut le réaliser. Aussi modeste que hardi et savant dans ses conceptions, il ne tint point à ses propres idées, il les communiqua à quelques hommes vertueux et éclairés de l’assemblée: tous ensemble donnèrent à l’ouvrage toute la perfection dont ils le crurent susceptible; ils formérent un parti qui fut toujours, et qui devoit, en effet, être le moins nombreux.
Je sais bien qu’on me reprochera de me livrer ici à des conjectures: cependant la suite des évènemens les change en vérités incontestables; et si l’on perd de vue, dans la suite de mon récit, ce que je viens de dire sur la préexistence d’un plan de révolution, on ne comprendra rien ni aux diverses scènes qui se sont passées, ni aux mouvemens que se sont donnes les principaux acteurs, et l’on n’expliquera jamais comment la forme de gouvernement qui nous a été donnée, a pu être imaginée au sein des assemblées les plus tumultueuses; il est évident qu’avant même d’en proposer un seul article à la délibération, il falloit que tout le plan de l’ouvrage fût dessiné.
En admettant, au contraire, comme une vérité, que le dessein de l’édifice nouveau étoit crayonne avant la convocation des états-généraux, tout s’explique; les évènemens arrivent dans l’ordre prévu, ils ne sont plus que les effets naturels et nécessaires d’une cause que l’on connoît: les moyens étonnent; mais quand on apperçoit le but où tendent les personnages, on les voit avec intérêt parcourir les différentes routes qui y conduisent. M. le duc d’Orléans s’y laisse entraîner par des routes qu’il ne connoît pas bien; M. de Mirabeau y marche ouvertement; les obstacles mêmes qu’il rencontre semblent accélérer sa marche.
M. le duc d’Orléans donc voyant la tournure que commençoient à prendre les affaires, voila moins ses desseins: flatté de l’effet qu’avoit produit dans le monde l’instruction à ses bailliages, il en fit répandre dans les provinces cinq à six mille exemplaires. On disoit en même-tems que ce premier écrit seroit bientôt suivi d’un second infiniment plus important, qui avoit été également rédigé par M. l’abbé Syeyes, et qui paroîtroit sous l’égide et la signature, non-seulement du duc d’Orléans, mais encore de deux autres princes. Je ne sais ce que ce bruit pouvoit avoir de réel; mais il ne parut dans ce tems-là aucun écrit revêtu de cette triple signature.
Si l’instruction du prince plut au peuple, elle ne fut point accueillie aussi favorablement à la cour, et M. d’Orléans y remarqua du réfroidissement à son égard. S’étant montré, quelques jours après sa publication, au spectacle de la comédie italienne, le public qui, depuis long-tems étoit muet à sa présence, l’applaudit avec transport, et à diverses reprises. Avant paru également aux promenades de LongChamp avec toute sa famille, il y recueillit les applaudissemens et les bénédictions de la multitude. On ne s’en tint pas à ces stériles marques de faveur: un bailliage qui n’étoit pas même de son apanage, s’empressa de le nommer pour son représentant; mais il refusa, soit qu’il craignît de montrer trop d’empressement, soit qu’il eût encore intérêt à ménager la cour, où il est certain qu’on ne se formoit pas une idée avantageuse des vues qu’il manifestoit. Il s’y disoit même dès-lors que le mariage projetté entre la princesse sa fille et M. le duc d’Angoulême n’auroit pas lieu.
Le prince se montroit peu inquiet de l’opinion qu’on se faisoit de lui à Versailles, et continuoit à Paris et dans ses apanages à répandre des libéralités auxquelles les Journalistes donnoient le plus grand éclat. Sa sollicitude pour la classe infortunée se faisoit remarquer jusques dans ses plaisirs. On étoit alors au milieu de mars, et l’on sortoit d’un hiver extrêmement rigoureux et long. La température de l’air faisoit espérer qu’on touchoit à la fin de cette cruelle calamité; mais le prince paria, au profit des pauvres, que le mois ne se passeroit pas sans que la rivère portât des glaçons; il perdit la gageure. M. d’Orléans avoit pris en Angleterre le goût des paris; mais jusqu’à ce moment les pauvres n’y avoient point été intéressés.
A l’exception au reste d’un très-petit nombre de personnes attentives, le public ne paroissoit point remarquer la conduite de M. le duc d’Orléans; mais les yeux de la France entière étoient fixés sur M. de Mirabeau. Les bruits les plus étranges et les plus contradictoires se répandoient sur son compte; en s’en tenant à la simple vérité, il y avoit encore du merveilleux dans la facilité avec laquelle il soulevoit et sa province et le reste du royaume.
Repousse par son ordre, il s’enfonça dans le tiers-état; et par cette démarche, il donna à notre malheureuse patrie une secousse qui eut des suites effroyables. On fit circuler, pendant qu’il s’agitoit pour obtenir les suffrages du peuple, une brochure qui, sous le facétieux titre de correspondance entre MM. le Diable et le comte de Mirabeau, contenoit une prédiction que le tems n’a que trop vérifiée. Le gentilhomme répondoit au compliment que lui adressoit l’esprit infernal sur son grand talent à tout bouleverser, et à répandre par-tout la discorde: «Ce que vous avez vu n’est rien en encore, et vous en verrez bien d’autres».
Personne ne doutoit qu’il ne fût l’auteur de l’atroce libelle intitulé: Correspondance secrète de Berlin. Ce libelle fut dénoncé au parlement, et remis au procureur-général par le roi lui-même. M. de Mirabeau démentit avec arrogance l’opinion où l’on étoit généralement, qu’il avoit lui-même publié cet ouvrage; opinion qui parut d’autant plus fondée, que le livre fut distribué par son libraire. Plusieurs personnes cependant, en ne doutant point que les lettres écrites de Berlin, ne fussent de lui, pensèrent qu’un de ses ennemis, pour altérer la confiance que le peuple commencoit à lui porter, étoit parvenu à soustraire ces lettres du département des affaires étrangères; et pour mieux persuader que cette infamante publication n’étoit due qu’à lui seul, s’étoit servi du nom de son libraire. Cette conjecture paroissoit d’autant plus vraisemblable, que les propres lettres de M. de Mirabeau ne lui étoient pas plus honorables que leur publication. J’ai entendu attribuer cette manoeuvre à M. l’abbé de Périgord: on répandit aussi que M. de Mirabeau avoit écrit d’Aix au ministre chargé du départemeut de Provence, pour s’en plaindre, et lui avoit, avec son assurance ordinaire, donné commission de reprocher à celui des affaires étrangères, et d’avoir violé le secret de son chiffre, et d’avoir laissé échapper de son département cette correspondance.
Quoi qu’il en soit de cette manoeuvre, elle ne retarda en rien la marche de M. de Mirabeau. La réputation dont il jouissoit dans la saine partie de la nation, ne pouvoit pas en être ternie, et ce n’etoit pilus l’opinion de la noblesse qu’il lui importoit de conquérir; il n’avoit plus d’autre ambition que de subjuguer la multitude, et la multitude est aveugle; elle reçoit l’impulsion sans considérer la main qui la donne.
M. de Mirabeau s’étoit donné de grands mouvemens à Marseille et à Aix, pour obtenir les suffrages du tiers-état d’une de ces deux villes; il réussit d’abord sur le premier théâtre, et certain qu’il auroit le même succès sur le second, il préféra celui-ci, et remercia les Marseillois. On disoit à Paris, que pour convaincre le troisièmè ordre de la sincérité de ses intentions, il s’y étoit aggrégé formellement, en abandonnant à jamais la qualité de gentilhomme, et en se livrant à une profession mercantile. On vouloit même qu’il eût acheté un magasin de draperie, et qu’il y eût installé son épouse. Ce n’étoit là qu’une fable; ce n’est pas que M. le comte de Mirabeau ne fût capable de cette bizarrerie; mais il n’avoit pas besoin de cette précaution, puisque le règlement permettait au tiers-état de prendre des députés hors de son sein. Ce qui put accréditer ce conte, c’est le départ de son épouse, qui arriva à Aix quelques jours avant son élection.
A peine fut-il nommé, que le bruit se répandit que le parti dont il étoit l’ame, le croyoit déja si retourné, qu’il étoit question de le punir de cette apostasie. On prétendoit encore qu’il devoit être décrété par le parlement de Paris; et on disoit à ce sujet qu’on avoit trouvé une feuille entière des épreuves de la fameuse correspondance, corrigée, augmentée de sa main: on ajoutoit que deux imprimeurs avoient déposé que trois ou quatre mois avant la publication de cet ouvrage, M. de Mirabeau le leur avoit offert, et qu’ils n’avoient pas voulu en faire l’acquisition, à cause du prix énorme qu’il y mettoit.
On disoit encore, que le parlement avoit acquis toutes ces connoissances, avant même que M. de Mirabeau se rendit à Aix, et que cette compagnie en avoit suffisamment pour lancer un décret. Sur cela, on étoit persuadé que M. de Mirabeau ne pourrait paraître aux états-genéraux, qu’après avoir purgé son décret; car on ne pensoit pas qu’en matière criminelle, les députés fussent à l’abri d’un décret.
Tous ces faits, eussent-ils été vrais, il n’étoit plus tems de frapper du glaive de la justice un homme qui avoit des armées à ses ordres, et qui pouvoit dicter des lois. Le parlement eût-il lancé un décret, il n’eût jamais ni osé, ni pu le mettre à exécution.
Je ne puis mieux faire connoître ce qu’on pensoit à Aix même, de la nomination de M. de Mirabeau, qu’en rapportant en entier la lettre suivante qui, à cette époque, fut écrite de cette ville.
«Je crois devoir vous instruire, Monsieur, du résultat ultérieur de la députation pour le tiers-état de la sénéchaussée d’Aix».
«M. Servant, un des quatre députés nommés, a refusé. On a nommé, pour le remplacer, M. Pascails, avocat, qui a également refusé: après la nomination et refus de M. Verdolin, etc., etc, etc.
«Les électeurs fatigués, ennuyés de la longueur, de la multiplicité et de l’inutilité des scrutins, ont cru se tirer d’embarras, en nommant M. Pochet, avocat, qui se trouve à Paris; mais, en conformité du réglement, il a fallu lui nommer un suppléant, de même qu’à M. Bouche, qui se trouve aussi à Paris. Même embarras, et plus grand encore pour l’acceptation des suppléans, que pour celle des députés titulaires. Enfin, on a trouvé deux personnes qui ont surmonté toute pudeur. Vous les nommer, ce n’est pas vous les faire connoître; à peine sont-ils connus ici; l’un s’appelle Philibert; c’est un bourgeois du hameau de Saint Julien; l’autre se nomme Verdet; il est avocat... Ils seront certainement députés en chef, parce qu’il n’est pas possible de douter du refus de MM. Pochet et Bouche: ils n’accepteroient qu’autant qu’ils ignoreraient les circonstances de leur nomination, et on aura eu soin de les en instruire»
«Le comte de Mirabeau, qui ne peut se méprendre sur le motif du refus, est fâché de n’avoir pas opté pour la députation de Marseille. M. Au... qui est entièrement dévoué au comte de Mirabeau, se trouve humilié de se voir ainsi à découvert à côté d’un homme dont tous les honnêtes gens s’éloignent».
«La cabale, les manœuvres, les intrigues se sont manifestées de la manière la plus indécente dans la nomination des députés; menaces, promesses, on. a tout employé pour réunir la pluralité des suffrages sur le comte et sur ses adhérans, ou plutôt ses complices».
«Qu’on ne juge pas à Paris la Provence d’après le choix de pareils députés. Nous serions couverts de honte et de ridicule, si on n’étoit instruit de ce qui s’est passé dans cette circonstance».
«Je me suis empressé de vous en faire part, pour prévenir votre étonnement ou votre indignation, en apprenant quels sont nos représentans».
Quelques jours avant sa nomination, M. de Mirabeau apprit la mort de son père qui s’est acquis le glorieux surnom d’Ami des hommes. Il mourut à Paris, dans son hôtel, rue de Seine. Quoiqu’il fût avancé en âge, on crut que tout ce qu’il apprenoit de son fils, avoit abrégé ses jours, en mettant le comble aux chagrins dont il étoit abreuvé depuis long-tems. On dit même que ce fut après avoir lu une lettre qu’il Venoit de recevoir du comte, qu’il fut frappé du mal qui le mit au tombeau. Père infortuné dont les soucis domestiques avoient toujours empoisonné la vie, et qui, par la douceur et l’urbanité de ses mœurs, méritoit de ne trouver autour de lui que l’image du bonheur!
Quelques jours après la mort de l’Ami des hommes, on fit circuler dans Paris que le comte de Mirabeau lui-même avoit perdu la vie à Marseille, et qu’il y avoit été tué par un officier prussien. Il s’en falloit de beaucoup que cette fable eût aucun fondement, et la vie de M. de Mirabeau en Provence étoit plus protégée que celle du plus puissant potentat. L’enthousiasme du peuple pour lui, étoit monté par degré au plus haut point. Cent jeunes-gens armés le gardoient nuit et jour, le suivoient par-tout, lui offroient de le suivre jusqu’à la porte des états-généraux, et de ne plus l’abandonner jusqu’à leur dissolution.
La Provence étoit en feu: des légions de brigands parcouroient les campagnes, le fer d’une main, la torche de l’autre. De toutes parts, dans cette malheureuse province, on n’entendoit parler que de pillage, d’incendies, d’assassinats; et les citoyens paisibles se demandoient, avec étonnement, d’où pouvoient sortir de si nombreuses troupes de meurtriers. Une fermentation extraordinaire agitoit aussi l’intétérieur des villes. Celle d’Aix vit tout-à-coup une assemblée tumultaire d’environ six cens particuliers. Ils se réunirent à l’occasion d’une petite brochure qu’on attribuoit au président de Peynier; ils prétendirent qu’elle étoit injurieuse au tiers-état; cinquante d’entr’eux ensuite se détachèrent, allèrent chercher l’exécuteur de la justice, et le contraignirent de brûler cet écrit.
Les routes n’étoient pas plus sûres que les rues et les campagnes. M. l’évêque de Sisteron allant d’Aix à Manosque, se vit environné d’une foule de paysans armés de fourches qui, aux plus grossières invectives, ajoutèrent la violence. Les glaces de sa voiture furent brisées; il courut le plus grand danger pour sa vie, et fut blessé à la joue, par le tranchant d’un caillou qui lui fut lancé. On n’imputoit d’autres crimes à ce prélat, que de ne pas favoriser les prétentions du tiers-état. Arrivé à Manosque, il se vit exposé à de nouveaux périls. La plus grande partie des habitans et les paysans des environs se soulevèrent; bloqué et retenu prisonnier dans les murs de la ville, il attendoit la mort à tout instant. Enfin M. de Mirabeau lut appellé, et il dissipa cette insurrection.
M. de Mirabeau en effet étoit le seul en Provence, qui eut la puissance de diriger, de réprimer, ou d’appaiser les mouvemens qui agitoient cette province. Il s’y étoit acquis sur les esprits une autorité qui tenoit de l’enchantement; il obtenoit une obéissance aveugle; il étoit roi; par-tout on le couronnoit. Dans une entrée qu’il fit à Marseille, on tira le canon; on sonna toutes les cloches; on l’ensevelit lui et sa voiture sous des tas de lauriers; enfin on l’idolâtroit; jamais il n’y eut d’exemple d’un tel engouement. Le commandant même de la province, M. de Caraman, fut obligé de recourir à son influence sur le peuple, et il reçut, de M. de Mirabeau, une réponse où celui-ci donnoit clairement à entendre qu’il connoissoit tous ses avantages.
La Provence ressembloit alors à une mer dont les flots se soulevoient et s’entrechoquoient avec fureur, et M. de Mirabeau à un pilote qui, sans effroi de l’orage, dirigeoit avec sécurité le navire au milieu des vagues écumantes. Le soulévement fut effroyable à Toulon. Tout le peuple s’ameuta, se révolta; il se montra intraitable; ne voulut écouter ni prières ni représentations; il parut prêt à tout oser et à tout entreprendre; il menaça d’égorger tous les gens en place; on se porta chez l’intendant, et comme on n’y trouva personne, ses chevaux furent la victime de cet accès de rage, on les massacra. Il ne restoit plus qu’une ressource à M. de Caraman, il eut recours à M. de Mirabeau; celui-ci quitte Marseille, vole à Toulon, harangue le peuple, lui promet que sous trois jours il sera content; et sachant que le prétexte de cette effervescence étoit la cherté du pain, il s’engagea, sur son honneur, à en procurer la diminution. Il force, en effet, les magistrats à le diminuer d’un sol par livre, fait publier à son de trompe cette diminution, la fait afficher par-tout, et jusques dans les salles de spectacle de Toulon et de Marseille, Par ses soins, en un mot, le calme renaît. On l’admiroit, on l’adoroit, on le regardoit comme un ange tutélaire, et jamais peut-être aucun homme n’avoit conquis un plus grand ascendant sur ses semblables. Tous les cœurs alloient au-devant de lui; il n’y avoit personne parmi ceux à qui il inspiroit cet enthousiasme, qui n’eût mis sa fortune à ses pieds.
Dans la petite ville d’Aups, il se passa une scène atroce: la populace se jetta sur le magistrat qu’alors on appelloit consul, et qu’aujourd’hui on appelle maire, et lui fit subir un supplice dont les cannibales eux-mêmes frémirent; il fut écorché vif. Le parlement d’Aix, effrayé des scènes d’horreurs qui menacoient d’ensanglanter toute la province, et ne les attribuant qu’à la disette des grains, nomma des commissaires qui furent chargés de parcourir les différentes villes, pour prendre connoissance des dépôts de bled et de farine, et contraindre ceux à qui ils appartenoient à venir vendre, dans les marchés, ce qui étoit nécessaire pour la consommation journalière.
Pour dissiper cependant les émeutes, on fut obligé, dans quelques endroits, d’employer la violence; à Toulon, à Marseille, à Aix, on fit feu sur les attroupemens; dans les deux premières villes ce ne fut qu’à poudre, et simplement pour effrayer; mais à Aix ce fut à balle, et plusieurs personnes furent tuées.
Toutes ces précautions n’étoient que des palliatifs, et le mal devenoit tous les jours plus grand. A Marseille, la consternation étoit générale parmi les habitans tranquilles; ils croyoient leur patrie à la veille d’une subversion générale. Les commissaires du parlement firent saisir dans le port de cette ville un bâtiment chargé de grains; cette conquête fut agréable au peuple. On diminua le prix du pain, mais un pareil bienfait étoit toujours suivi d’une nouvelle convulsion, parce que la rareté des grains ne cessant d’être la même, ceux qui le vendaient ne pouvoient se fixer long-tems à la modération accordée. Le peuple donc qui croyoit qu’on manquoit à la parole qu’on lui avoit donnée, n’en devenoit que plus violent dans ses emportemens.
Par-tout, dans la province, ces emportemens furent extrêmes; les séditieux portoient leur fureur a l’excès; le carnage suivoit de près le pillage; il n’étoit pas une ville, pas un bourg qui ne se crut a la veille d’être mis à feu et à sang. A Toulon, une maison fut pillée et dévastée; à Marseille, plusieurs furent démolies jusqu’aux fondemens. A Aix, des brigands ayant à leur tête un garçon boucher, menacèrent les bourgeois; on l’arrêta lui et quelques-uns des rebelles, mais la tranquillité ne fut pas pour cela rétablie.
Les habitans de cette dernière ville firent parvenir à MM. Necker, de Villedeuil et Beauveau, un procès-verbal des malheurs qui les menaçoient. On y lit que M. de la Fare avoit failli perdre la vie dans une émeute, et qu’il l’eût perdue infailliblement, si un homme de bien, appellé Gabriel, en se jetant entre lui et ses assassins, ne lui eût donné le tems de se retirer à l’hôtel-de-ville. Le crime de M. de la Fare, comme de tant d’autres, étoit de ne pouvoir répondre aux cris de ceux qui demandoient que le prix du pain fût diminué.
M. de Peynier, président au parlement, fut assiégé dans son propre château, par une foule de scélérats qui le contraignirent à signer un acte pardevant notaire, dans lequel on lui faisoit abandonner, en faveur du tiers-état, ses droits, ses priviléges et la plus grande partie de ses biens. A Marseille, six têtes, parmi les personnes les plus importantes, furent mises à prix, et clans tout le reste de la province on s’attendoit à une épouvantable révolution.
Dans un désordre qui alloit toujours croissant, M. le comte de Caraman ne vit d’autre remède que de repousser la force par la force. Il envoya son fils en cour et le chargea de solliciter des ordres qui l’autorisassent à réprimer avec vigueur les mutins. On lui envoya trois régimens suisses ou allemands, dont deux étoient de cavalerie.
Gomme on ne comprenoit rien à Paris à une telle fermentation, et qu’on ne lui connoissoit pas même de prétexte, puisque, le tiers-état de cette province avoit, comme celui de toutes les autres, obtenu ce qu’il desiroit, on supposoit que la ville de Marseille étoit décidée à secouer le joug de la domination françoise, et à s’ériger en république indépendante.
Le feu de là sédition, en circulant, s’étoit glissé dans les montagnes les plus inaccessibles, et par-tout la cherté du pain étoit le cri de guerre; on y mettoit, comme dans les plaines, les seigneurs à contribution. M. de Puget, entr’autres, fut bloqué dans son château, et se rendit après avoir obtenu des assiégeans une capitulation où, comme l’on pense bien, tout étoit à son désavantage; de-là cette horde se jeta sur un magasin de farine, et le pilla. Le parlement, toujours fidèle aux formes anciennes, ne connoissoit d’autres armes à employer contre ces attentats, que des décrets et des informations, foible ressource contre un fléau qui devoit engloutir le parlement lui-même. Enfin la bourgeoisie de Marseille prit les armes, et c’étoit ce que l’on demandoit. M. de Mirabeau quitta aussi la province pour se rendre aux états-géneraux, et insensiblement elle se calma.
En racontant les désordres de la Provence, j’ai tracé l’image de presque toutes les autres provinces, au moment, où se faisoient les élections; j’ai peint sur-tout ce que nous avons vu à Paris, dans chaque occasion où il s’est agi de frapper un grand coup aux bases de l’ancien édifice. On a vu, dans mon récit, que la Provence étoit tranquille lorsque M. de Mirabeau y est arrivé, qu’elle n’a cessé d’être agitée pendant tout le séjour qu’il y a fait, et qu’elle n’ a recouvré la tranquillité que lorsquil l’a quittée. On y a vu encore que la seule cause de l’effervescence etoit la disette des grains. La disette des grains a été aussi par-tout ailleurs, et plus particulièrement dans la ca pitale, le fléau qui a engendre tous les autres fléaux; il n’a cessé que lorsque le roi est venu habiter le château des Tuileries.
Cette calamité eut pu paroître un événement naturel, si les récoltes qui l’avoient précédée eussent été moins abondantes; si elle n’eût pas redouble chaque fois qu’il falloit porter la multitude à de grands excès; si, enfin, elle n’eût pas cessé tout-à-coup, et comme par miracle, au moment même où l’ on sembloit n’avoir plus rien à attendre du peuple. Il est donc indubitable, et cette vérité résulte avec évidence, de toute la suite de cette histoire, qu’il se faisoit, sur les grains, une perfide manœuvre, que les effets de cette horrible machination étoient d’inquiéter, d’allarmer le petit peuple, de le porter aux murmures, aux plaintes, à l’insurrection, et enfin à des accès de fureur.
Quel jour ne répandroit donc pas sur l’histoire de la révolution, celui qui, tirant le voile sur les auteurs de cette infernale menée, les montreroit à découvert? Faut-il en rendre responsables les parlemens, et tous ceux que depuis on a appellé aristocrates? On a bien pu amuser le peuple des fauxbourgs de ce conte; mais comme rien n’a été plus fatal pour eux que cette menée, il faudroit supposer qu’ils ont eux-mêmes, de gaieté de cœur, creusé l’abîme où on les a ensevelis. D’ailleurs on a vu, dans les détails que j’ai racontés, les efforts des compagnies souveraines, pour déjouer les monopoleurs. Ces efforts attestent tout-à-la-fois et la témérité des parlemens, et leur impuissance à trouver le premier fil de la trame.
Dire que M. de Mirabeau étoit l’auteur de ces intrigues, ce seroit et une injustice et une absurdité. Il n’avoit dans l’empire, ni caractère, ni mission, ni autorité, et ce n’étoit pas à la voix d’un simple particulier, que les greniers pouvoient ou s’ouvrir ou se fermer.
Des accapareurs, disoit-on, engendrent tous ces désordres. Eh! oui, je vois bien là des complices, mais je ne vois pas le misérable qui se les est associé, et quand ces complices sont en si grand nombre, je m’étonne que le peuple, dans ses emportemens, ne s’adresse jamais à aucun d’eux; et que si, par hasard, la tête d’un de ceux qui pouvoit nous éclairer tombe, son secret s’ensevelisse avec lui dans le même tombeau. A Dieu ne plaise que j’inculpe la mémoire de M. Berthier, mais qui, plus que lui, eût pu nous donner d’utiles renseignemens? Il n’est plus, et son porte-feuille nous a été dérobé avec une affectation suspecte.
D’ailleurs ces monopoleurs, dont on ne dit pas le nom, pouvoient-ils échapper à la vigilance du gouvernement? Pourquoi M. Necker, qui avoit une influence exclusive sur les mouvemens de la circulation des grains, n’a-t-il livré aucun de ces accapareurs au glaive des loix? Pourquoi M. Necker?.... Je laisse aux événemens même que j’ai à raconter, à dire le reste. Ce ministre, en quittant pour toujours la frontière de France, a dit que la vérité, s’il vouloit la révéler, seroit pour lui le cheveu de Samson. Cette histoire la révélera, et cette histoire sera pour lui, comme pour la postérité, le cheveu de Samson; mais il est essentiel que le lecteur en lisant, dans la suite de celte narration, tout ce qui aura quelque trait à la manœuvre des grains, se rappelle les considérations que je viens de présenter; elles seront pour lui une source de lumières. Je ne regarde donc point comme une digression, les considérations que je viens de présenter, parce que c’est sur-tout lorsqu’on touche encore à la source des événemens, qu’un historien doit s’attacher à développer leurs causes; et s’il n’est pas contredit par ses contemporains, ses conjectures même se rangent dans la classe des faits; ces détails d’ailleurs montrent une grande vérité qu’il importe de ne pas perdre de vue, c’est que ceux-là ont réellement opéré la révolution, qui, avant et dans tout son cours, ont effrayé le peuple d’une famine
L’impulsion étoit donc donnée à la Provence comme au reste du royaume; le tiers-état connoissoit ses forces; l’essai qu’il en faisoit achevoit cle le convaincre qu’il étoit, et qu’il seroit tout ce qu’il voudroit. Les écrivains de cet ordre ne dissimuloient plus qu’il composoit à lui seul le royaume. L’un d’eux donna à sa brochure ce titre peu énigmatique: ce projet de mille et une réformes à proposer aux états-généraux, dédié au tiers-état, c’est-à-dire à la nation.
Ses députés arrivoient en foule à Paris, et la malignité jetoit un coup-d’œil curieux sur chacun d’eux; ceux de la Rochelle furent des premiers dans la capitale, et y trouvèrent en arrivant une lettre qu’on faisoit circuler, offensante à deux d’entr’eux, et qu’on disoit être de leurs commettans. Il y avoit eu dans les élections du clergé de ce bailliage de grands débats; les curés s’y étoient livrés à beaucoup d’animosité contre les chanoines et le haut-clergé.
En Bretagne, les élections furent plus tardives; ce ne fut que le18Mars que M. de Thyard pût quitter la cour, avec les ordres nécessaires pour la convocation des assemblées primaires de la province. Il n’étoit resté à Versailles que six députés du tiers-état de la Bretagne; leur départ précéda de quelques jours celui de M. de Thyard. Avant de quitter la cour, ils obtinrent une audience du roi. En entrant dans le cabinet du monarque, un sentiment profond d’amour et de respect saisit ces six bourgeois; ils ne purent proférer aucune parole, et se précipitèrent aux pieds du roi. Sa majesté, entraînée par ce sentiment de bonté qui lui est si naturel, s’empressa de les relever, en souleva même un par les bras, et leur dit à tous: «Je vous ordonne de vous relever; ce n’est pas-là la place de mes enfans.» Paroles adorables qui peignent bien l’a me de notre monarque. Les bourgeois, confondus par tant d’amour, et le cœur oppressé par la reconnoissance, ne purent trouver d’expressions pour la témoigner; ils quittèrent l’audience fondant en larmes. Ce fut leur seul langage, et ce langage qui faisoit si bien l’éloge de leur sensibilité, étoit le seul digne d’un roi qui n’a jamais eu d’autre ambition que d’inspirer de l’attachement pour sa personne.
Quoique de pareils témoignages du tendre intérêt que Louis XVI prenoit à la cause du tiers-état, quoique presque par-tout l’élection des députés fut faite, on ne laissoit pas de se tenir en garde contre les intentions de la cour, et de douter encore si réellement il y auroit des états-généraux. On épioit les mouvemens des ministres, les démarches du parlement, et on les interprétoit avec malignité. Le parlement tenoit, de tems à autre, des assemblées de chambres, et on répandoit que les délibérations se termineroient par une déclaration qui étonneroit tous les esprits. Il faut convenir que cette compagnie, effrayée des progrès que faisoient les nouvelles opinions, n’avoit plus une marche assurée: son dernier combat fut contre les libellistes. Ne pouvant sévir contre toutes les brochures incendiaires, il s’attacboit au moins à flétrir celles qui étoient plus particulièrement marquées du sceau de la rébellion. Tel étoit un petit écrit intitulé: La Passion, la More, et la Résurrection du peuple, imprimé à Jérusalem. Il étoit terminé par cet horrible souhait: Per evangelica dicta doleantur carnifices magistratus et nobilitas. Amen.
La réflexion suivante terminoit tout l’ouvrage: «La Bretagne, la Franche-Comté et les autres provinces à parlemens, doivent bien se tenir sur leurs gardes, et surveiller sans cesse les démarches des robins et des ignobles. On doit affermir le roi et son ministre dans leurs louables projets, par un dévouement et une reconnoissance sans bornes; on doit haïr et mépriser bien profondément tous les Conti, les Lenoir, (ancien lieutennant de police), les Cagneux, (conseiller au parlement), les Fréteau (il a prouvé depuis qu’il étoit digne de l’estime de pareils écrivains) et les Barrabas d’Eprémesnil du monde. Les citoyens de Nantes, de Rennes et de Besançon, méritent d’être déclarés traitres à la patrie, s’ils ne vengent l’affront sanglant fait à leurs compatriotes, en exterminant leurs assassins et les esclaves de ces lâches, en brûlant, sans délai, dans une place publique, toute la robinaille sacrilège et la noblesse insolente, etc., etc., etc.
» Au nom de Louis XVI, du comte de Provence et de Necker. Ainsi soit-il».
On reconnoît bien là le style de ces sanguinaires journalistes qui, dans ces derniers momens encore, font tous leurs efforts pour transformer le peuple françois en un peuple de bourreaux. L’insouciance du gouvernement sur l’effet qu’il étoit nécessaire que de tels écrits produisissent, ne peut se concevoir, à moins de supposer à quelqu’uns des ministres, le coupable désir d’une insurrection générale.
Le parlement proscrivit et condamna au feu cette infâme production. Le jugement fut exécuté, et cet acte de justice fit sourire non-seulement la cohorte des libellistes, mais le petit peuple lui-même. Les crieurs publics, en annonçant l’arrêt du parlement, par une affectation peut-être commandée, et qui fut impunie, ne faisoient entendre que ce cri: Arrêt du parlement qui condamne à être brûlé, la Passion, la Mort et la Résurrection. On étoit au tems de carême: cette burlesque et indécente proclamation prêta à des illusions sur les sentimens religieux du parlement, et étoit regardée par d’autres personnes comme une sorte de prédiction des affronts que la religion auroit bientôt à souffrir.
On se tromperoit cependant, si on croyoit que ceux qui tenoient les rênes du gouvernement, tolérassent la liberté indéfinie de la presse. La vérité veut que je dise que cette liberté ne fût indéfinie que pour les écrits qui attaquoient l’autorité du roi, qui soulevoient les peuples contre l’autorité légitime, le clergé, la noblesse, les parlemens, et contre toute espèce de subordination; cette liberté, comme j’ai déjà eu occasion de le dire, fut également indéfinie, à l’égard des estampes qui outrageoient les deux premiers ordres, ou qui faisoient l’apotéose du ministre actuel des finances. Mais cette liberté ne s’étendoit pas sur toutes les sortes d’ouvrages; et voici une liste exacte de quelques-uns de ceux qui, à cette même époque furent saisis et enlevés chez les libraires.
Io. Réflexions d’un provincial sur la première production du nouveau ministre des finances. Ces lettres écrites avec beaucoup de modération, n’étoient pas avantageuses au ministre.
2o. Réflexions où l’on lui prouvoit que ses opérations suspendoient pour plus de cent millions des. paiemens échus; ce qui faisoit alors plus du tiers de la dette annuelle.
3o. Réflexions où l’on lui reprochoitde n’avoir pas encore saisi ce qu’on appelle le style législatif, ni ce que c’étoit qu’un arrêt du conseil, et d’avoir substitué à l’ancien langage du conseil, ses propres raisonnemens.
4o. Réflexions où l’on lui recommandoit de faire parler le roi avec clarté, avec dignité, sans amphigouri, et sans le mettre sans cesse en contradiction avec lui-même. L’auteur qui disoit avoir vielli dans l’habitude de respecter la majesté du trône, jusques dans son style, gémissoit de voir qu’il parût impossible de faire une seule page des lois, ou d’arrêts du conseil, dans laquelle le roi s’exprimât en législateur et en souverain.
5o. Réflexions où l’on disoit que M. Necker auroit rempli l’attente de la nation, s’il se fût montré plus assuré des ressources promptes et puissantes qu’on trouve toujours dans un grand royaume, quand on sait les attirer par une fidélité inaccessible à tout motif d’exception, plutôt que d’employer tous les moyens de séduction à former l’esprit de division et de révolte.
Dans ce dernier écrit, on faisoit à M. Necker, les reproches les plus graves; on lui attribuoit tous les maux dont le royaume étoit menacé.
6o. Lettre amicale à M. Necker; cette lettre ne laissa pas d’être publique, parce que l’ordre de l’arrêter n’arriva que lorsqu’il y en avoit deja plusieurs exemplaires de délivrés.
7o. Maximes politiques de M. Necker, tirées de ses propree écrits, et comparées avec les maximes politiques de Fénelon, tirées de même de ses propres écrits.
8o. Brochure qui instruisoit le public qu’il s’étoit tenu-un comité sur la liberté de la pressse, où il’avoit été dit que, dans les circonstances actuelles, c’étoit à M. le garde des sceaux, et à M. Necker, à décider des livres qu’on pourroit délivrer au public.
9o. Brochure où l’on témoignoit des regrets de ce que la publication trop prompte de l’écrit de M. de Calonne avoit empêché celle d’un pamphelet destiné à le déjouer, et à prévenir le public contre les maximes de l’écrit du ministre réfugié.
10o. Brochure où l’on faisoit remarquer que M. Necker, quoiqu’il eût beaucoup d’esprit, sembloit cependant frapper d’une aveugle stupidité tous ses partisans, et on lui ridiculisoit le culte que lui vendoient ceux de sa secte.
11o. Enfin, brochure où M. Necker n’étoit pas même nomme, et dont l’auteur se contentoit de prouver que si le plan de M. de Calonne eût été adopté, la Flance eut été le pays le plus libre, le plus heureux de l’Europe, parce qu’il auroit eu tous les avantages d’un gouvernement monarchique, sans les inconvéniens d’un gouvernement mixte, démocratique ou aristocratique.
Cette dernière brochure étoit remarquable par l’esprit de sagesse avec laquelle elle étoit écrite. L’auteur n’y recommandoit aux François que l’union, et ne leur prêchoit que les principes d’une sage subordination.
Telle etoit la liberté dont la presse jouissoit alors: les maximes de l’indépendance, les calomnies les plus incendiaires contre les soutiens de la monarchie, les panégyriques du mininistre des finances, circuloient sans effort; mais les ouvrages qui censuroient quelque partie de son administration, ou quelques-unes des nouvelles opinions, étoient étouffés dès leur naissance.
Je ne dissimule point que dans quelques-uns de ces derniers écrits, une ironie amère et étonnante pour M. Necker, se mêloit à la discussion; et c’étoit un tort, parce que le respect pour ceux que le roi honore de sa confiance, doit être un devoir pour tout homme sage; mais la sollicitude de M. Necker pour repousser le flambeau que des mains peu respectueuses, si l’on veut, approchoient de sa personne, et son insousciance sur les effets que pourroient produire les coups portés au trône par les libellistes, offre un contraste qui peut ajouter aux lumières que l’on a deja sur la part qu’il a eue à la révolution. A mesure que j’avancerai dans mon récit, je ferai remarquer tout ce qui se rapportera à cette influence.
Mes lecteurs doivent s’appercevoir qu’à mesure aussi que j’approche de l’époque du27avril, je m’appesantis danvantage sur les détails, parce qu’avant de les transporter sur le grand théâtre des états-généraux, je dois, leur donner une connoissance intime, et des moindres démarches des principaux acteurs qui vont s’y montrer en spectacle, et des intrigues qui ont préparé le dénouement d’une pièce dont on ne peut bien connoître la marche, si on n’en a davance bien compris le plan.
Je vais donc avant de parler de l’ouverture des états-généraux, me livrer encore à quelques détails qui l’ont immédiatement précédée, et que je ne pourrais passer sous silence, sans tomber dans l’inconvénient de navoir pas fourni toutes les lumières qui peuvent éclairer qur la route que nous parcourons aujourd’hui.