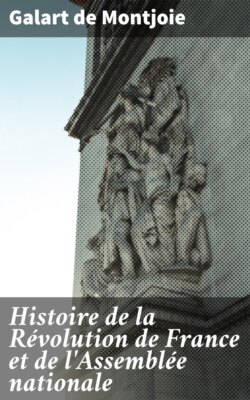Читать книгу Histoire de la Révolution de France et de l'Assemblée nationale - Galart de Montjoie - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE XVIII.
ОглавлениеTable des matières
Enthousiasme que produit le discours de M. Necker; mauvais effet des critiques de M. de Mirabeau; conduite de M. le duc d’Orléans; nouvelle découverte sur la manoeuvre des grains; situation de la cour; mort de M. de Lamoignon; son portrait; dernières séances des électeurs; députés et suppléans de Paris; prorogation de l’assemblée des électeurs; réflexions sur cette prorogation et sur le cahier du tiers-état de Paris; premières motions de MM. Laborde et Target; singulière motion de MM. Liniere et de Mirabeau; relation de la conférence entre les commissaires conciliateurs; conduite du clergé et de la noblesse après la conférence.
Mai1789.
LE spectacle que présentoit l’élite de la nation réunie à Versailles, méritoit d’intéresser l’Europe entière. Et qui n’eût pas attendu avec impatience l’issue du combat qui s’étoit élevé entre les trois ordres? Le tiers-état vouloit la délibération par tète, la noblesse la délibération par ordre, le clergé offroit sa médiation, et se flattoit de trouver un moyen de concilier deux prétentions diamétralement opposées.
M. Necker qui avoit provoqué ce combat, en accordant la double représentation, n’en paroissoit point encore affecté, et il etoit peut-être le seul homme en France qui en fut spectateur indifférent. Ses partisans eux-mêmes n’avoient d’autre soin que d’arrêter les progrès que faisoient sur l’opinion les sarcasmes que M. le comte de Mirabeau decochoit contre le ministre. Celui-ci ne doutant point que le discours qu’il avoit prononcé à l’ ouverture des états-généraux, ne fut un chef-d’oeuvre qui s’élevoit au-dessus de Colbert, le donna pour aliment a l’admiration publique. Les exemplaires en furent multiplies avec la plus grande profusion; il n’y eut pas un journaliste qui ne reçut l’ordre d’en enrichir sa feuille. C’étoit sur-tout dans les lieux où se rassemblent les oisifs de la capitale, que des enthousiast es le proposoient à la vénération de la foule, et malheur à ceux qui, imbus des critiques de M. de Mirabeau, osoient refuser leurs applaudissemens.
Un jour qu’on en faisoit la lecture dans le caffé du caveau, un des auditeurs ne put maîtriser son impatience, il se récria sur la longueur du discours; d’ailleurs, ajouta-t-ii, ce n’est point-là celui qu’a composé M. Necker. Il eût à peine proféré ces paroles, qu’on se jetta sur cet imprudent, et ce ne fut point sans danger pour sa vie qu’il put se retirer de cette cohue d’enthousiastes.
Dans un caffé voisin, où l’on faisoit également brûler l’encens en l’honneur de la divinité tutélaire du tiers-état, il se trouva un particulier qui non-seulement refusa son hommage, mais qui même insulta l’idole. «Ce M. Necker, osa s’écrier l’incrédule, est un arabe, un juif, il vous trompe, il vous trahit; vous devriez, non pas le lapider, ce qui est trop barbare, niais l’envoyer au-delà des frontières». Je n’ai pas besoin de dire que le blasphêmateur vit au même instant mille bras levés sur lui, mais meurtri de coups, il mêloit aux cris de la douleur, cette prophétie: «N’importe, disoit-il, frappez, mais un jour, vous reconnoîtrez que je disois la vérité, et alors je viendrai vous demander une juste réparation.
Comme on croyoit que tous ces détracteurs étoient des émissairns de M. de Mirabeau, on se tenoit en garde contre ce député, et cette opinion publique qu’il devoit un jour conquérir, avec laquelle il devoit à son tour régner despotiquement, n’étoit point encore pour lui. Elle était toute entière au rival qu’il attaquoit, et M. de Mirabeau, en s’opiniâtrant à la combattre, voyoit insensiblement sa gloire s’éclipser. Sa réputation même d’homme éloquent en souffroit; on trouvoit à faire dans le sein de l’assemblée des comparaisons qui lui étoient humiliantes ;on disoit qu’il étoit très-inférieur à MM. Thouret et Rabaud; on avoit même exprimé, par un pitoyable jeu de mots, le résultat de la comparaison qu’on en faisoit avec ce dernier, car on séparoit dans la prononciation la première syllabe du nom de celui-ci, et l’on disoit qu’il étoit réellement Mi-rabaud. Son journal étoit suspendu, et la majeure partie du public voyoit avec plaisir cette suspension. Les électeurs eux-mêmes regrettèrent d’en avoir demandé la continuation, et ils convinrent entr’eux de ne donner aucune suite à leur arrêté.
C’étoit donc en vain que M. de Mirabeau tentoit d’arracher à M. Necker la faveur du peuple. Le parti du ministre étoit plus nombreux, et plus bruyant encore. Dans quelque société qu’on se transportât, on se voyoit environné d’une horde de fanatiques qui exigeoient impérieusement qu’on pliât le genoux devant le grand homme, qui vous disoient sans détour qu’ils étoient prêts à se battre, à verser tout leur sang pour le maintien de sa gloire; qu’il étoit le sauveur, le père, le plus honnête homme de la France; et que si, par l’effet des intrigues qui se formoient contre lui, il venoit à abandonner le ministère, il faudroit fuir le royaume comme une terre infortunée d’où la vertu s’étoit exilée.
M. le duc d’Orléans venoit avec moins de bruit et d’éclat se placer sur l’autel d’où M. de Mirabeau ne pouvoit précipiter le directeur des finances. Le jour où le prince fut député aux états-généraux par la noblesse de Paris, fut un jour de fête pour la multitude. Les tambours, les fifres, tout le peuple des halles vint environner son palais, et lui témoigner sa joie. La lettre par laquelle il remercia ses commettans et refusa de se rendre à leur voeu, fut connue du public, et fit honneur à sa modestie.
Quelques jours après, il se transporta à Crépy en Valois, pour y faire emprisonner un sieur Dumouron, procureur du roi de ce bailliage. Le crime de cet homme étoit, disoit-on, d’avoir accaparé des grains, et d’avoir osé abuser du cachet du prince, pour faire ce monopole. Le crime étoit grave sans doute, et méritoit bien que M. le duc d’Orléans livrât le coupable à toute la sévérité de la justice; mais depuis il n’a plus été parlé de cette affaire; si elle eût été suivie, elle eut peut-être donné quelques éclaircissemens sur le manége des monopoleurs. Mais chaque fois qu’il s’est échappé un rayon de lumière du sein des ténèbres où se tenoient enfoncés ces malheureux, il a été au même instant étouffé,
On justifioit encore la sévérité du prince, par un autre reproche qu’on faisoit à ce sieur Dumouron, et ce reproche portoit sur un délit qui, dans les circonstances, etoit impardonnable. On prétendoit qu’ayant été enarge de reunir tous les articles du cahier de son bailliage, il s’étoit permis de les altérer, de les modifier d’une manière contraire aux intérêts du tiers-état. On ajoutoit que la fraude ayant été reconnue, le faussaire avoit été ignominieusement chassé de l’assemblée des électeurs. La conduite de M. le duc d’Orléans envers un tel homme étoit une preuve de plus de son attachement pour le peuple, qui ne pouvoit voir qu’avec plaisir que quiconque étoit son ennemi, étoit aussi celui du prince. On n’en doit pas moins regretter que toute cette affaise n’ait pas mieux été éclaircie, et je n’aurai que trop souvent occasion de faire remarquer que dès qu’il s’est élevé un homme qui pouvoit donner des renseignemens sur la manoeuvre des grains, l’homme et son secret ont disparu.
Revenu à Versailles, M. le duc d’Orléans ne s’y confondit plus parmi les courtisans. Assidu aux séances de sa chambre, il y prenoit ouvertement le parti des communes, et leur faisoit des partisans. Il étoit le seul des princes que le peuple crut lui être entièrement dévoué. On débitoit à ce peuple, sur les triumvirs, tant de fables odieuses, qu’il ne doutoit point qu’ils ne conspirassent contre son bonheur.
En jettant cependant un coup-d’oeil sur la situation où se trouvoit alors la cour, je ne vois dans tous les contes qu’on faisoit circuler, que de la perfidie, et que l’intention bien décidée de vouer à la haine et aux vengeances de la multitude abusée, quiconque entreprendroit de modifier, dès leurs premiers pas, la fougue des révolutionnaires. La calomnie se taisoit sur le compte de Monsieur, parce que ce prince vivoit très-retiré, se montroit rarement en public, et ne s’attachoit ni à l’un ni à l’autre parti. M. le comte d’Artois au contraire, toujours environné d’une cour nombreuse, toujours lié avec MM. les princes de Condé et de Conty, et avouant avec sa franchise ordinaire, qu’il croyoit les prétentions de la noblesse légitimes, étoit représenté comme le plus dangereux ennemi du tiers-état. Sa sincérité et ses liaisons donnoient au moins une ombre d’apparence à cette atroce calomnie. Mais la reine qui s’abbreuvoit de ses larmes, qui voyoit son fils et son frère aux portes du tombeau, qui avoit elle-même appel lé M. Necker à l’administration des finances, devoit-elle aussi être représentée au peuple comme oubliant sa douleur pour conspirer contre un ministre dont l’élévation étoit son ouvrage? On vouloit cependant qu’elle présidât les prétendus conciliabules où se méditoit, disoit-on, la chûte du directeur des finances.
M. Necker ne faisoit rien pour détruire ces impostures; il se tenoit également éloigné de tout le monde, parloit avec circonspection et en mots insignifians, des débats élevés entre les second et troisième ordre, et n’admettoit personne à sa table.
Les autres ministres n’avoient rien retranché des usages de la représentation, et de cette sorte de magnificence qui, jusqu’alors, avoit été un des devoirs de leurs places; leurs tables, ainsi que celles dès princes, étoient à l’ondinaire ouvertes aux prélats, aux gentilshommes.
Il n’y avoit rien là qui dût étonner, parce qu’il n’y avoit rien là qu’on n’eût toujours vu pratiquer; mais on transforma ces repas d’étiquette en autant de conseils de conjurés; et quiconque était admis a a table ou des ministres, ou de quelque grand de la cour, ou de quelqu’un des princes, conspirent contre les communes. Ce moyen servit admirablement les calomniateurs, et eut le plus grand succès contre MM. l’archevêque de Paris, d’Epremesnil et Malouet. La haine s’acharnoit avec d’autant plus d’opiniatreté contre ces trois députés, qu’on s’attendoit que tous les trois auroient une grande influence sur leur ordre; le premier, parce qu’il étoit généralement reconnu pour le plus honnête homme de son siècle; le second, parce que son éloquence pouvoit faire de nombreuses conquêtes et le troisième, entroit dans La carrière avec une contenance qui le rendoit formidable aux factieux.
De nouvelles troupes qui s’approchoient journellement de Paris, accréditaient beaucoup les mensonges et les conjectures sur tous ces complots, dont on vouloit que le tout fût de contraindre les communes à accepter les conditions qui lui seroient imposées par la cour. Outre les régimens déja arrivés, ou fit encore approcher successivement celui de Salis-Samade suisse, les hussards de Berchini, les chasseurs d’Esterasy, et ceux de Lorraine. On parloit dès-lors de donner le commandement de toutes ces troupes à M. le maréchal de Broglie, et de former dans la plaine de Sèves un camp de douze mille hommes.
Ce fut dans ces premiers jours d’orage, au moment où la fermentation menaçoit tous les corps de l’état, que M. de Lamoignon qui, de concert avec M. de Brienne, avoit donné le premier ébranlement, mourut à Baville d’une manière misérable. On crut que cette mort n’étoit pas naturelle: on se trompa. Levé de grand matin, à son ordinaire, il visita sa famille et ses ouvriers; Madame de Lamoignon le quitta, pour se rendre dans un petit pavillon du parc, appelle le café. Il sortit quelque tems après son épouse, suivi d’un valet-de-chambre; il etoit botte, éperonné, parce qu’il comptoit ce jour-là monter a cheval avec Madame la comtesse de Caumont sa fille. Il tenoit sous le bras un fusil d’enfant qu’il portait ordinairement dans ses promenades, et avec lequel il s’amusoit à tuer des pies. Il cueillit beaucoup de chevre-feuille pour les dames, et entra dans une grotte. S’y étant assis, il se fit apporter une bouteille de petit lait, en but; mit à ses pieds la bouteille et le verre, et tira de sa poche une brochure de M. l’evêque de Langres, qu’il attendoit ce jour-là même à dîner. Le valet-de-chambre le quitta, lorsqu’il commença sa lecture. Une demie-heure après, on entendit un coup de fusil, on n’en eut aucune inquiétude, parce qu’on crut que M. de Lamoignon avoit tiré sur un oiseau; mais bientôt après, on vit accourir au château un ouvrier, qui annonça qu’il avoit vu cet infortuné baigné dans son sang. Ses trois fils étaient réunis dans le même appartement. Le chevalier de Lamoignon, le plus jeune des trois, courut vers ce terrible spectacle, le marquis, qui étoit incommode d’une entorse, s’y traina appuyé une main sur le bras de son frère aîné, et de l’autre sur celui du comte de Vibraye. Arrivés dans la grotte, le chevalier de Lamoignon se jette sur son malheureux père, et le serre dans ses bras. Sa cervelle et son sang avoient jailli sur les murs de la grotte. Il étoit assis et dans la même attitude où l’avoit laisse son valet-de-chambre; seulement son fusil avoit glissé le long de ses jambes. Il parut évident qu’en s’agitant, un des éperons avoit fait partir la détente ou fusil. La charge avoit fracassé une machoire, et était sortie par la tempe opposée. Ses trois enfans, suivis, du comte de Vibraye, vinrent apprendre ce cruel accident à leur mère et à leur soeur qui les attendoient à déjeûner. Les circonstances de cet événement ne permettent point de douter qu’il ne fut naturel.
Ainsi périt M. de Lamoignon à l’instant où commençoit cette révolution, que ses opérations avoient tant avancée. Il est un exemple frappant du changement qu’apportent bien souvent, dans les principes d’un homme, les différentes situations où il se trouve placé. Magistrat au parlement, il fut l’adversaire le plus zélé, le plus opiniâtre des plans de M. de Maupeou. Ministre, il devint le fléau de son corps. Il est vrai qu’il combattit d’abord le projet de la cour plénière; mais il finit par adopter toutes les vues de M. de Brienne, il y ajouta les siennes, et pressa l’exécution des unes et des autres, avec une impéritie et une rapidité qui font, à sa mémoire, une tache ineffaçable. Il disoit souvent: mon ministère. sera court, mais on s’en souviendra long-tems.
M. de Lamoignon avoit d’ailleurs des qualités estimables: il soutint sa disgrace avec assez ferme te; il ne lui échappa aucune plainte, ni contre l’archevêque de Sens qui avoit fait violence à ses principes, m contre le public qui l’accabla de tout le poids de sa haine; il ne murmura point de la perte de sa charge de président à mortier, à laquelle il était fort attaché. Et il est à remarquer qu’après sa disgrace, non-seulement il recouvra tous ses amis, mais que ceux même qui s’étoient éloignes de lui pendant son administration, vinrent le retrouver à Baville. On a osé dire qu’il avoit contribué à la déprédation des finances, et qu’il avoit, sans pudeur, sollicité et obtenu de la cour des bienfaits innombrables. Jamais calomme ne fut plus grossière, ni moins vraisemblable. Il est notoire que M. de Lamoignon est mort accable de dettes; il n’étoit point joueur, et n’avoit aucun de ces défauts qui dérangent les fortunes; il a cependant ruiné sa famille; mais sa femme et ses enfans ne l’en ont pas moins pleuré, et ceux même qui ne l’aimoient pas conviennent qu’il fut bon père, bon mari, bon ami. On dit que deux jours avant de mourir, il écrivit pour toute réponse à M. de Montmorin qui lui demandoit son avis sur quelques nouveaux plans: ma tête n’est point assez forte. Je ne suis plus de ce siécle.
Si c’étoit, en effet, bien sincérement que M. de Lamoignon, pendant son ministère, avoit voulu donner à l’autorité du roi plus d’étendue et d’indépendance, ce devoit être pour lui un grand sujet d’étonnement que cette explosion, si je puis parler ainsi d’idées républicaines qui exaltoient toutes les têtes. Son imagination devoit s’effrayer en contemplant l’avenir que présageoit la querelle qui s’étoit élevée entre le tiers-état et les deux premiers ordres.
il étoit assez singulier que le tiers-état de la capitale fût le seul de tout l’ empire qui ne pût influer, par ses députés, sur ces premiers débats, dont les suites dévoient si fort l’ intéresser. Ces députés n’étoient point encore nommés. L’aforme d’élection qu’avoient adoptée les électeurs rendit cette nomination lente et fastidieuse. Il fallut vingt mortelles séances pour consommer ce travail. Les électeurs ne prirent pas tous les députés parmi eux. Au sixième scrutin, la pluralité des suffrages se déclara pour M. Tronchet, qui n’avoit paru dans aucune des assemblées primaires. Une députation lui en porta la nouvelle. Il vint dès le lendemain remercier l’assemblée de cet honorable témoignage de confiance, et lui dit que s’il n’avoit considéré que ce que cette commission avoit de flatteur, il ne l’auroit point acceptée; mais que considérant qu’elle étoit en même tems une dette du citoyen, le choix des électeurs lui imposoit la loi de s’en acquitter, et de s’y dévouer tout entier. Il en fut de même de M. Leclerc, libraire, et de M. Garnier, conseiller au Châtelet, qui obtinrent également une pluralité de suffrages, quoiqu’ils ne fussent point membres l’assemblée.
Ces nominations n’avoient rien d’extraordinaire, puisque le choix tomboit sur des sujets qui avoient toutes les qualités requises pour être éligibles. Mais le vingtième scrutin offrit une véritable bizarrerie: il se déclara pour M. l’abbé Syeyes qui, par son état, étant aggrégé au premier ordre ne pourvoit représenter celui qui avoit arrêté de ne point prendre de député dans le clergé. Il sembleroit que cette nomination avoit été prévue, car à peine fut-elle proclamée que quelques membres déposèrent sur le bureau, une protestation dont voici la substance:
«Par une délibération qui a lie tous les membres de l’assemblée, les ecclésiastiques et les personnes nobles ont été déclarés non éligibles pour la dénutation.»
«Dix-neuf scrutins ont consacré le principe de cette délibération. L’exception en faveur de M. l’abbé Syeyes, est injurieuse aux personnes très-éclairées et très-distinguées des ecclésiastiques et des nobles qui depuis dix-neuf scrutins, ont été exclus des suffrages, en les mettant en opposition offensante avec un ecclésiastique dont le mérite, quel qu’il soit, peut lui être un titre qu’autant qu’il ne seroit pas isolé et sans concurrent.»
On lit encore dans cette protestation, que M. l’abbé Syeyes avoit été nommé en l’absence d’une partie notable de l’assemblée; ceux qui la signèrent furent MM. Dumangin, Marguet, Rives, Luciot, de Bussac, Osselin, Guenon, Langloys, receveur-général des domaines et bois. Ces huit électeurs exigèrent que leur protestation fut annexée au procès-verbal, et se réservèrent de se pourvoir aux états-généraux, contre la nullité de la nomination.
Cette protestation n’empêcha point que M. l’abbé Syeyes ne fut déclaré bien légitimement député. Il vint, avant la fin même de la séance, en faire ses remerciemens à l’assemblée. Il lui témoigna qu’il étoit d’autant plus sensible à l’honneur qui lui étoit déféré, qu’il avoit moins droit de s’y attendre; que tenant au tiers-état par sa naissance, la carrière qu’il avoit suivie sembloit l’en séparer; mais que revêtu de la confiance d’une classe de citoyens à laquelle il appartenoit toujours, il feroit ses. efforts pour y répondre par son zèle et par son dévouement.
Je joins ici les noms de tous les députés de Paris, suivant l’ordre de leur nomination: MM. Bailly, des trois académies; Camus, avocat au parlement; Vignon, ancien consul; Bévière, notaire; Poignot, négociant; Tronchet, avocat au parlement, de Bourges, grand garde de l’ épicerie; Martineau, avocat au parlement; Germain, négociant; Guillotin, docteur en médecine; Treilhard, avocat au parlement; Berthereau, procureur au Châtelet; Démeunier; Garnier, conseiller au Châtelet; Leclerc, libraire; Hutteau, avocat au parlement; Dosfand, notaire; Anson, receveur-général des finances; Lemoine, l’aîné, orfèvre; et l’abbé Syeyes, grand-vicaire et chanoine de Chartres.
Le sort dans l’élection de ces députés, ne fut pas favorable aux procureurs au parlement; ils n’ont pas eu un seul d’entre eux aux états-généraux. Les avocats ont été plus heureux; le quart de la deputation de Paris fut prise dans leur ordre. De ces vingt députes, dix environ se sont fait remarquer dans l’assemblée nationale, et les autres y sont absolument nuls. Parmi ces dix, il en est qui par leurs travaux ou leurs harangues, ont plus particulièrement fixé sur eux l’attention publique: tels sont MM. Bailly, Camus, Tronchet, Martineau, Treilhard, Anson, l’abbé Sieyes.
La séance où l’on mit fin au travail sur l’élection des députés, se termina gaiement. Les fruitieres-orangères, et d’autres dames de la halle, entrèrent dans l’assemblée, et lui chantèrent des couplets en l’honneur du tiers-état. M. Camus, qui présidoit, répondit gravement à toutes ces chansons. Il dit aux dames, qu’on avoit beaucoup de satisfaction à les recevoir; quon s’étoit occupé très-particulièrement de leurs intérêts; que les députés étoient chargés de s’en occuper aux états-généraux, et qu’enfin elles avoient des amis et des frères dans l’assemblée du tiers-état.
L’élection des députés terminée, il fallut procéder à celle des suppléans; on convint d’en nommer vingt; mais on étoit si fatigué de dépouiller, d’interroger des scrutins, qu’il fut décidé qu’on adopteroit enfin la méthode de la noblesse. On fit donc le scrutin en une seule fois, et par une seule liste de vingt noms. Voici ceux qui obtinrent la pluralité des suffrages. MM. Vauvilliers, professeur au collège royal; de la Vigne, avocat au parlement; Baudouin, imprimeur-libraire; Garan de Coulon, avocat au parlement; Garnier, secrétaire du cabinet de madame Adelaïde; Brousse des Faucherets, avocat en parlement; Trochereau, conseiller au châtelet; Boscary, négociant; Thouin, de l’académie des sciences; Agier, avocat au parlement; Perrier, de l’académie des sciences; Levacher de la Terrinière, avocat au parlement; Parisot, avocat au parlement; la Cretelle, avocat au parlement; Duveryer, avocat au parlement; Duclos du Fresnoy, notaire; Tassin, banquier; Piuvinet, négociant.
Lorsqu’on eut enfin irrévocablement terminé toutes ces élections, les trois ordres se réunirent, et leurs députés aux états-généraux prêtèrent serment entre les mains de M. le prevôt de Paris, de remplir bien, fidèlement, et dans toute son étendue, la mission qui leur étoit confiée.
Les électeurs du tiers, avant de se séparer, arrétèrent de proroger leur assemblée pendant la tenue des états-généraux, afin, dirent-ils, de donner a ses députés, les instructions ultérieures, que la précipitation forcée de ses opérations, ne lui avoit pas permis de leur donner. En conséquence de cet arrêté, l’assemblée s’ajourna pour le mercredi suivant 7juin.
Les électeurs, en prenant cet arrêté, neprévoyoient pas jusqu’où iroient les fonctions qu’ils se donnoient; ils n’imaginoient pas que leur assemblée seroit, deux mois après, une assemblée de rois. Cette prorogation étoit évidemment une nouveauté inconstitutionnelle, et il est étonnant que le gouvernement n’en ait conçu aucune jalousie. Les électeurs n’avoient d’autre pouvoir, d’autres fonctions, que de nommer des députés aux états-généraux; cette nomination faite, ils n’avoient plus ni pouvoir, ni fonctions. Toute assemblée ultérieure ne pouvoit donc plus être regardée que comme illégale. De qui les électeurs tenoient-ils le droit de rester assemblés? Ce n’étoit certainement pas du seul législateur qu’on pût reconnoître alors en France les états-généraux n’étant pas encore constitués. Etoit-ce de leurs commettans? Mais ceux-ci pouvoient-ils donner ce qu’ils n’avoient pas? Ils n’avoient eux-mêmes été convoqués que pour nommer leurs électeurs; leur activité se bornoit à cette seule fonction, et elle s’y borna en effet, car je ne lis dans aucun des cahiers des assemblées primaires que les électeurs prorogeroient leur assemblée pendant toute la durée des états-généraux.
Les électeurs de Paris, en restant assemblés, méconnoissoient donc l’autorité du légistateur, et outre-passoient leurs pouvoirs. Ils n’avoient sans doute pas la prétention de croire que le droit qu’ils s’attribuoient, leur appartenoit par cela même qu’ils se l’attribuoient; car un tel raisonnement légitimeroit toute usurpation qui seroit suivie du succès. S’ils ne vouloient pas reconnoitre l’autorité du roi, ils ne pouvoient du moins récuser celle de leurs commettans; ils devoient donc, après avoir rempli la mission qui leur avoit été confiée par ceux-ci, se confondre parmi eux, et les laisser constituer eux-même une assemblée aux membres de laquelle ils auroient donné les instructions qu’ils auroient jugé nécessaires. Ne pouvant pas prévoir que les électeurs iroient au-delà du cercle qui leur avoit été tracé, ils n’avoient songé à leur confier que des pouvoirs relatifs à la commission qui leur étoit donnée. Ces électeurs étoient censés avoir les lumières et les instructions suffisantes pour se bien acquitter de leur mission; mais il pouvoit très-bien se faire qu’ils n’eussent aucune capacité pour les nouveaux travaux qu’ils alloient entreprendre. Leur conduite et l’insouciance du gouvernement sur cette conduite, sont d’autant plus remarquables, que c’est par de telles erreurs, par l’oubli des premiers principes de toute société bien ordonnée, que nous sommes arrivés au comble du désordre, et il ne pouvoit en être autrement, parce qu’en politique, comme en morale, comme dans toutes les sciences exactes, les conséquences qu’on tire d’un principe erronné, ne sont elles-mêmes que des erreurs.
Pour justifier leur usurpation, les électeurs disoient qu’ils avoient des instructions à donner à leurs députés; cela ne pouvoit ni ne devoit être: les instructions des députés, étoient dans leur cahier; ils n’en avoient plus d’autre à recevoir que de leur conscience.
Le cahier remis aux députés du tiers-état de Paris, ne fit pas une grande sensation; il ne mérite pas moins d’être lu. MM. Target et Camus y jettèrent, le premier dans les articles constitution et législation, le second dans l’article, religion, clergé, les germes des opinions que nous leur avons entendu prêcher dans la tribune, et mettre en pratique dans les comités. Par exemple, dans ce second article, il étoit dit: il sera pris des mesures pour faire revivre la discipline primitive de l’église, c’est-à-dire, le rétablissement des élections aux prélatures. On reconnoît bien là M. Camus, on le reconnoît encore mieux à cette philosophique maxime: la religion est reçue librement dans l’état, et à cette maxime injurieuse pour le clergé, parce qu’elle étoit susperllue: les ecclésiastiques doivent l’exemple et la leçon de toutes les vertus. Cependant, quoiqu’il régnât une pédantesque sévérité, dans la rédaction de l’article clergé; on y reconnoissoit que l’ordre public ne souffroit qu’une religion dominante, et que la religion catholique étoit la re-religion dominante.
En général l’esprit qui présida à la composition de ce cahier, ne fut pas celui de la modération, mais il ne fut pas non plus celui de la destruction; car dans toutes les réformes qu’on y demande, on suppose toujours le maintien des anciennes formes constitutronelles, et le respect pour les propriétés des corps, comme des particuliers. Mais ce qui distingue le cahier des députés de Paris, des instructions données pour le reste du tiers-état du royaume à ses représentans, c’est le chapitre qui lui sert d’introduction. Les électeurs de Paris voulurent, à l’instar des états-unis d’Amérique, faire aussi une déclaration des droits, et donner ce bel exemple aux états-généraux. Ce chapitre donc, intitulé, déclaration des droits, est remarquable, non pas par la sagesse ou la clarté, mais par l’incohérence et le désordre des idées. On y confond la nation avec les individus, l’homme social et policé avec l’homme purement sauvage, qui lui-même a des devoirs à remplir, et des droits à respecter. Je ne m’arrêterai point à examiner les bizarres assertions de ce chapitre, parce que comme elles se trouvent reproduites dans la fameuse déclaration des droits décrétée par l’assemblée national, il sera tems d’en faire voir l’impolitique absurdité, lorsque j’en serai à cette seconde déclaration.
On pense bien que les députés du tiers-état de Paris, n’eurentrien de plus pressé, dès qu’ils furent nommés, que de se rendre sur le grand théâtre où les rôles les plus importans à jouer, commençoient à se distribuer. Ceux qui étoient relatifs à la conférence, ouverte avec les deux premiers ordres, étoient déja donnés; et à cet égard il n’y avoit plus rien à faire jusqu’au dénouement. Les commissaires que la noblesse choisit, furent MM. le Marquis de Bouthillier, le duc de Luxembourg, ce courageux Marquis de la Queille, qui le premier a offert son sang à la religion et à la patrie, ce chaleureux comte d’Antraigue, qui s’exagéra peut-être les abus de l’ancien régime, mais dont l’âme vertueuse s’indigna de l’audace de la licence, le duc de Mortemart, le vicomte de Pouilly; ce héros du siècle, cet intrépide Cazalès, l’ornement de son ordre, l’espoir de la patrie fiere de compter parmi ses défenseurs un gentilhomme, qui aux vertus des Bayard, des Montausier, réunit l’éloquence des plus grands orateurs de la Grèce et de Rome; enfin M. de Bressay.
Le clergé, le jour même où le tiers-état consentit à la conférence, arrêta qu’il reonnçoit a ses priviléges pécuniaires; cette décision fut prise par acclamation; mais il fut stipulé que l’on n’avoit pu voter individuellement, parce que la chambre n’étoit point encore constituée. Préluder à la conférence par ce sacrifice, c’étoit se présenter au combat avec l’olivier de la paix.
En attendant l’issue de cette conférence, on ne savoit que faire dans les commuues où il régnoit toujours un grand désordre, tant par le défaut d’un réglement de police, que par la construction de la salle, et l’arrangement des sièges qui n’étoient point comme aujourd’hui en amphytheâtre. Ces sièges étoient toujours occupés par des étrangers et des députés mêlés sans aucune distinction: ceux qui n’étoient pas sur les premiers bancs, ne pouvoient ni voir ni être entendus.
2o. Le jeune M. de la Borde de Méréville, qui brûloit de se faire remarquer, et que M. de Mirabeau encourageoit beaucoup, proposa de passer le tems à rédiger des journaux, dans lesquels on rendroit compte de tout ce qui s’étoit passé depuis l’ouverture des états-généraux, et de tout ce qui surviendroit. M. de la Borde vouloit employer a ce travail vingt-quatre membres de l’assemblée. On craignit qu’ils ne devinssent les censeurs de leurs collégues, et on rejetta la proposition.
23. M. Target présenta la proposition sous une autre forme: il demanda qu’on nommât deux secrétaires pour rédiger un procès-verbal clair, simple et précis de chaque séance. On craignit que les rédacteurs ne se laissassent aller involontairement aux reflexions, et M. Target ne fut pas plus heureux que M. de la Borde.
Dans la chambre de la noblesse, on suivit à-peu-près l’exemple du clergé, on autorisa les commissaires qui deroient conférer avec ceux des deux autres ordres, à annoncer que la plus grande partie des cahiers dont étoient chargés les députés de la noblesse, portant renonciation aux priviléges pécuniaires; la chambre étoit dans la ferme résolution d’arrêter cette renonciation, après que chaque ordre délibérant librement, auroit pu établir les principes constitutionels sur une base solide.
Dès le soir, tous les commissaires se réunirent, mais il ne fut rien décidé dans cette première conférence qui fut longue et vive; on en renvoya la suite au25. Les communes attendoient avec d’autant plus d’impatience qu’elle se terminât, qu’on s’y voyoit dans l’inaction jusqu’au moment où on serait constitué. On demandoit donc toujours, à quoi devons-nous nous occuper? M. de Mirabeau répondoit; à rien. Mais comme il étoit à-peu-près impossible de passer le tems en conversations oiseuses, et que chacun étoit jaloux de s’annoncer avantageusement, chacun avoit une motion à faire. M. Moreau, entre autres, en fit une si singulière qu’elle mérite d’être rappellée: il demanda la suppression des spectacles. «Celui de Versailles–, dit il, coûte mille’ écus5ne vaut-il pas mieux donner cette somme aux pauvres? Les spectacles d’ailleurs, ajouta-t-il, ne peuvent procurer des amusemens dignes de la gravité et de la majesté d’une aussi auguste assemblée; ils sont faits pour un peuple corrompu; ils ne conviennent pas à un peuple qui veut régénérer ses moeurs et faire cesser les principes de la corruption.»
M. Moreau n’étoit pas le seul qui, en arrivant à Versailles, eût rêvé que le peuple françois étoit un peuple vierge, si je puis me servir de cette expression, que Dieu venoit de créer tout exprès pour que les états-généraux le façonnassent à leur gré.
La motion cependant de M. Moreau fut éconduite avec des murmures et des huées; il se plaignit, il insista: on lui répondit qu’on ne mettoit pas aux voix de pareilles rêveries.
La liberté avec laquelle on siffloit ceux dont on ne goûtoit pas les raisonnemens, étoit un des principaux motifs qui faisoit désirer un réglement de police. M. le doyen dit qu’on lui en avoit remis un, et demanda si on vouloit le mettre aux voix. Le premier aiticle portoit qu’aucun député ne pourroit entrer qu’en habit noir, ou du moins qu’il ne pourroit parler qu’en habit de couleur.
On repoussa d’abord ce réglement; on craignit que les discussions dans lesquelles il entraîneroit, ne pretassent aux plaisanteries des folliculaires. M. de Mirabeau, qui venoit de dire qu’il falloit rester dans l’inaction, soutînt alors qu’il falloit nommer des commissaires pour travailler à la rédaction d’un réglement, seul moyen, selon lui, de remédier au tumulte, et à la longueur des délibérations; il ajouta que la question le savoir s’il falloit être vêtu en noir, devoit essentiellement faire un article de ce réglement. –«Eh! Messieurs, s’écria M. Linière, il y a huit jours, je vous proposai cette même motion, et vous la rejettâtes sur l’avis de M. de Mirabeau, qui ne vous prêchoit que la force d’inaction.» Celui-ci se débarrassa de cette objection par une distinction. Il dit que le réglement, offert par M. Linière, devoit être définitif, au lieu que le sien n’étoit que provisoire. Le mot provisoire faisoit alors une grande fortune, et il sonnoit merveilleusement dans la bouche de M. de Mirabeau. Tout en France, jusqu’au roi, n’étoit plus que provisoire.
» Il s’agit bien ici, dit un autre membre, de l’haoit, de rangs, de dignités; y en a-t-il dans une assemblée d’hommes égaux? «M. de Mirabeau crut que par cette exclamation, on lui reprochoit de tenir à sa noblesse. Il se hâta donc de répondre qu’il attachoit si peu d’importance à son titre de comte, qu’il le donnoit à qui le voudroit, ajoutant que son plus beau titre, le seul dont il s’honorât, étoit celui de représentant d’une grande province, et d’un grand nombre de ses concitoyens.–«Je suis, repliqua un député, entièrement de l’avis de M. le comte de Mirabeau; je dis M. le Comte, mais j’attache si peu d’importance à un semblable titre, que je le donne gratis à qui voudra le porter.»
C’est par de pareils sarcasmes qu’on préludoit aux, coups qui alloient être portés à la noblesse; c’est en pareils dialogues que se consumoient les premieres délibérations des communes,
La séance des commissaires fut plus sérieuse, et infiniment plus importante par les suites qu’elle eut. On débattit d’abord les faits historiques; la noblesse rappella que dans les états-généraux de1614, de1588, de1576et de156o, la vérification des titres s’étoit faite séparément. M. Mounier, qui porta la parole pour les commissaires du tiers-état, ne put pas nier cette vérité; il ne lui resta pour y répondre, que la ressource qu’on peut, quand on veut, employer contre toute vérité, celle des raisonnemens et des conjectures. Il dit que si à ces différentes époques, les titres avoient été vérifiés séparément, c’est que des funestes haines, des querelles de religion, divisoieut et les ordres et les citoyens; c’est que ces différens états-généraux n’avoient pas eu l’objet de proposer en commun des lois générales pour le royaume; qu’ils avoient eu seulement en vue de porter au roi des doléances sur les malheurs qui affligeoient la France, et qu’alors il importoit peu aux trois ordres de faire entendre leurs plaintes séparément ou en commun; que très-souvent même, ayant eu à se plaindre les uns des autres, ils avoient été dans la nécessité de se diviser, leurs contestations rendant leur réunion impossible.
Ces raisonnement pouvoient être fort bons, mais ils n’infirmoient point le fait historique; ils l’expliquoient, et une explication bonne sur un fait douteux, n’anéantit pas celui qui est incontestable. M. Mounier en conclut cependant que si a ces diverses époques, les états avoient été divises, cela étoi arrivé, non par la constitution du royaume, mais par le concours des circonstances qu’il venoit de détailler. Outre que cette conséquence n’étoit pas dans les règles d’une exacte logique, elle etoit encore Vicieuse sous le rapport politique. Qui ne sait que les constitutions des empires se font par le concours des circonstances? La France avoit, en 1789une manière d’être; M. Mounier expliquoit fort bien, si l’on veut, comment elle l’avoit; mais l’explication même prouvoit qu’elle l’avoit, et que l’arrangement qu’on proposoit étoit une innovation.
M. Mounier sentit tellement cette difficulté, il Comprit si bien que ce qu’il étoit chargé de proposer, étoit contraire à la constitution que nous avions depuis deux siècles, qu’il voulut prouver qu’au delà de ces deux siècles, cette constitution n’étoit pas la même. Il dit que puisque la noblesse vouloit remonter au seizième siècle, pour y trouver des autorités en sa faveur, les communes avoient droit de remonter au quinzième, et étendant cette idée, il représenta que dans les états de1483, tout se fit en commun, et les vérifications, et les délibérations, et les décisions. Il ajouta qu’il en avoit été de même clans toutes les tenues des états-généraux depuis Philippe-le-Bel, qui ouvrit les premiers; que lorsque les ordres vérifioient leurs titres séparément, ils n’avoient point de juges dans les états-généraux sur les titres qu’un ordre contestoit, et qu’ils soumettoient alors les contestations de ce genre à l’autorité royale et à celle du conseil.
M. Mounier étoit trop éclairé, pour qu’il put être lui-même satisfait d’un tel argument. Les corps ne reposent plus sur aucune base, les individus ne sont plus assurés de leurs propriétés, si on peut prescrire contre une possession de deux siècles; et M. Mounier étoit convenu que depuis1588, la vérification des titres s’étoit faite séparément. Ne seroit-ce pas même aujourd’hui un pitoyable raisonnement de prétendre que la constitution qu’on veut donner à la France, ne vaut rien, uniquement parce qu’elle es avoit une différente il y a deux ans. Certainement, en supposant que la constitution actuelle se consolide et se perpétue, cette raison sera encore moins bonne dans deux siècles; car pour la combattre, on aura cette durée même de deux siècles.
Je ne conçois donc pas pourquoi M. l’abbé Coster, qui étoit un des commissaires du clergé, parut frappé de la réponse de M. Mounier. Il convient que chaque systême pouvant invoquer a son aide des faits, il falloit en conclure que plus ils étoient nombreux, moins ils pirouvoient, et qu’on devoit toujours en revenir à la justice et a la raison. Mais en politique, la justice et la raison peuvent-elles se prouver autrement que par des faits? Il ne me suffit pas de dire qu’il est injuste de me dépouiller de ma propriété, il me faut auparavant prouver qu’elle m’appartient. Le droit des nations ne repose également que sur des faits: plus les traités qui les lient sont nombreux, et plus ce droit est assuré.
Les faits étant reprouvés comme insuffisans pour décider la question, M. Target entreprit de la résoudre par le droit naturel; il avança que dans tous les systèmes de délibération, la vérification pour les intérêts des trois ordres, devoit se faire en commun; il en donna deux raisons. Il dit d’abord que si les ordres délibéroient séparément, et s’ils exerçoiens le veto les uns sur les autres, ils avoient le plus grand intérêt à s’assurer légalement que les députés de tous les ordres étoient vraiment les députés légalement élus de la nation, et qu’il pourroit se faire en effet, s’il en étoit autrement, que dans une circonstanc importante, le veto fut déterminé par une seule voix, et que cette voix fut celle d’un député dont l’élection seroit illégale.
On ne conçoit pas, en vérité, comment M. Target pouvoit appeller cela raisonner suivant le droit naturel; c’étoit raisonnner suivant des suppositions chimériques. Il ne s’agissoit du tout point de députés de la nation; il s’agissoit de députes du clergé, de la noblesse, du tiers-état. Chacun des trois ordres avoit le plus grand intérêt à ne garder dans son sein que des députés légalement élus, ils pouvoient donc s’en rapporter mutuellement l’un à l’autre sur cette légalité.
La seconde raison de M. Target fut que la vérification des titres des députés de la nation, étoit un droit national, qui par conséquent ne pouvoit être exercé que par tous les députés de la nation même.
Cette seconde raison étoit encore moins une raison-de droit naturel que la première, puisqu’il n’y étoi question que du droit national, et elle étoit fondée sur une mauvaise définition. Les trois ordres avoient envoyé leurs députés respectifs aux états-généraux. Quel étoit le droit, quel étoit l’intérêt de la nation C’est que les états-généraux fussent Composés des députés de chacun des trois ordres, légalement élus. Or dès que chacun de ces trois ordres donnent a la nation l’assurance qu’il n’avoit dans son sein que des députés légalement élus, falloit-il présumer qu’on cherchoit à l’induire en erreur? Et quel intérêt eût eu un des trois ordres à se permettre un mensonge? Supposer une telle chimère, et raisonner d’après cette supposition, n’étoit-ce pas une absurdité?
Lorsque les commissaires du tiers eurent fini de parler ceux de la noblesse proposèrent pour moyens de conciliation, que les pouvoirs fussent vérifies à part; mais que les contestations qui pourroient en dériver fussent soumises au jugement des commissaires nommés par les trois ordres, en reconnoissant cependant pour bonnes et légales toutes vérifications certifiées telles par les chambres distinctes et séparées.
Quant au clergé, voici les propositions qui furent présentées par M. le cure de Souppes.
«Les pouvoirs de l’ordre de la noblesse seront Portés dans les deux autres chambres, pour que vérification en soit confirmée; il en sera usé de même à l’égard des députes de l’ ordre du clergé, et de ceux du tiers-état. S’il s’élève des difficultés sur les pouvoirs des députés de quelque ordre, il sera nommé des commissaires dans chacune des trois chambres, selon la proportion établie, qui rapporteront leurs avis à leur ordre; et s’il arrivoit que les jugemens des chambres fussent différens; la difficulté sera jugée par les trois ordres réunis, sans que cela puisse préjudicier à la question du vœu par tête ou par ordre, et sans tirer à consequence».
26. Ainsi se termina cette conférence dont personne ne pouvoit attendre une autre issue. Ce fut M. Rabaud de Saint-Etienne qui en fit le rapport aux communes. Un peuple innombrable remplissoit ce jour-là leur salle; mais pour la première fois le silence le plus profond régna des que M. Rabaud ouvrit la bouche, et tout, le temps qu’il parla. Son rapport fini, il fut visible à chacun qu’il ny avoit plus rien à espérer des conférences; mais on ne prit aucun parti, on ne délibéra pas même sur la proposition du clergé.
Dans la chambre de la noblesse, le rapport de ses commissaires fut suivi de cet arrêté:
«La chambre de la noblesse, après avoir entendra les rapports des commissaires chargés de conférer avec ceux des autres ordres, délibération prise en conséquence, a arrêté, à la pluralité de deux cens voix, que pour cette tenue d’états-généraux les pouvoirs seront vérifiés séparément, et que l’examen des avantages ou des inconvéniens qui pourroient, exister dans la forme actuelle, serait remis à l’époque où les trois ordres s’occuperont des formes à observer pour l’organisation des prochains états-généraux».
Le clergé se trouva si divisé d’opinions, après avoir entendu ses commissaires, qu’il ne prit aucune détermination. La délibération cependant fut très-animée, et parmi les ecclésiastiques et parmi les noblès. Il y eut même des propos très-vifs entre deux gentilshommes, qui heureusement n’eurent aucune suite. Cette division etoit funeste aux deux ordres, et elle devoit nécessairement livrer à l’exécration du peuple, celui des deux partis qui ue viendroit pas se réunir au tiers-état. On va voir comment cet ordre accueillit l’arrête de la noblesse, et comment elle-même se trouva détournée de la. route qu’elle sembloit vouloir poursuivre avec persévérance.